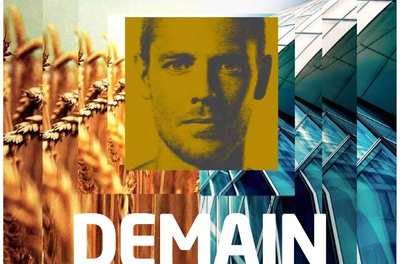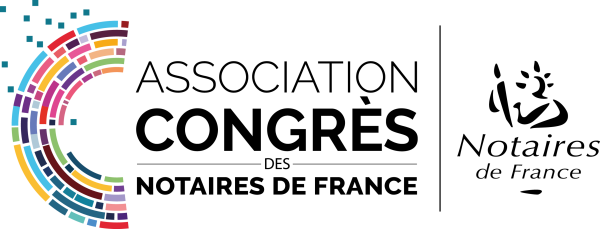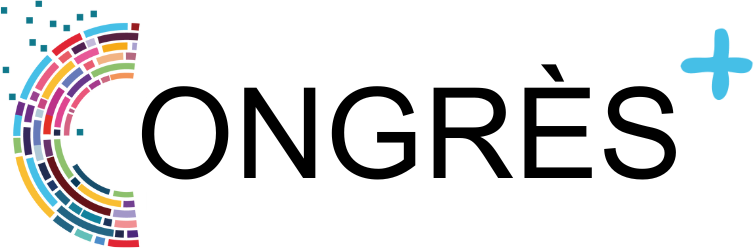Introduction générale - Le notaire et la loi : « Et voudriez-vous… »
Les apports des Congrès des notaires de France au droit
Plus de 200 textes législatifs et près de 130 règlementaires
inspirés des Congrès des notaires de France
Libéralités graduelles et résiduelles : des solutions à ne pas oublier pour les personnes vulnérables
102e Congrès des notaires de France, Strasbourg, 2006 | 96e Congrès des notaires de France, Lille, 2000
1 - Les atouts des libéralités graduelles et résiduelles. –« Ne pas oublier ! » Les notaires n’ont-ils pas un peu oublié ou négligé les atouts qu’offrent les libéralités graduelles et résiduelles, plus particulièrement en présence d’une famille comprenant une personne vulnérable ? Toutefois, plutôt que parler d’oubli, ne vaudrait-il pas mieux se demander si ces techniques ont été parfaitement intégrées par les praticiens ? Cela m’a fait penser à un remarquable article1 paru dans cette revue à l’occasion du dixième anniversaire de la loi ayant réformé les successions et libéralités. Il débutait ainsi : « Consacrées par la loi du 23 juin 2006, les libéralités graduelles et résiduelles s’écrivent « entre contrainte et liberté ». Cette antinomie semble expliquer le succès pratique contrasté de ces libéralités dix ans après leur mise à l’honneur. Pour autant, leur cause est loin d’être perdue ! Si quelques doutes restent encore à lever sur les libéralités graduelles, les libéralités résiduelles, par leurs utilités pratiques, ont vocation à être un outil important des transmissions ». Ses auteurs ont su parfaitement mettre en exergue à la fois les difficultés et les espoirs attachés à ces deux modalités particulières de libéralités, se demandant si les libéralités graduelles ne risquaient pas d’être condamnées au sommeil tandis que les libéralités résiduelles pourraient être en phase de réveil. Huit ans après la publication de cette contribution, j’ai l’impression que les choses n’ont guère évolué et que les praticiens restent frileux pour conseiller ces libéralités malgré les efforts de la doctrine2.
2 - Libéralités concernant les personnes vulnérables. – Je me limiterai ici à prolonger la réflexion en proposant de porter l’attention uniquement sur les libéralités susceptibles de concerner des personnes vulnérables. Leur situation particulière constitue, me semble-t-il, un motif spécifique de regarder les libéralités résiduelles et même graduelles avec plus d’intérêt.
Remarque
C’est en tout cas ce que l’équipe du 102e Congrès des notaires de France, que j’avais eu l’honneur de présider, avait pensé en 2006 en travaillant sur le thème des personnes vulnérables. Sous la houlette de son brillant rapporteur général, Philippe Potentier, elle avait décidé d’y consacrer une réflexion approfondie3, en s’appuyant sur l’Offre de loi4 dont elle avait apprécié, comme tant d’autres, la très grande qualité. Consciente de l’intérêt majeur pour les personnes vulnérables, ce sont deux propositions qui furent soumises à débat et à vote par la quatrième commission5, la première Pour une reconnaissance générale et adaptée des libéralités graduelles, la seconde Pour une pratique plus souple des libéralités résiduelles.
Fin remarque
3 - Il ne sera pas proposé ici de développements théoriques détaillés, la matière ayant été présentée par d’éminents universitaires de manière à la fois claire et complète6 et ayant fait l’objet de nombreux articles de doctrine ainsi que déjà rappelé. En revanche, nos familles sont riches de leur diversité et certaines situations familiales méritent une analyse plus poussée. Il apparaîtra ainsi que certains inconvénients ou défauts attribués aux libéralités substitutives se révèlent moins prégnants.
4 - Histoire de ces libéralités. – Au préalable, un bref rappel de l’histoire récente de ces libéralités et leur lien particulier avec le notariat est utile. Au seuil du XXIe siècle, on s’accordait pour constater un décalage important entre une législation restée figée depuis deux siècles sur certains sujets et les attentes de notre société. Les notaires, du fait de leur expérience ancienne de conseillers des familles, le ressentaient plus particulièrement. Or, comme cela a été parfaitement relevé, la technique substitutive manquait dans l’arsenal du « parfait notaire », spécialement lorsqu’il fallait assurer l’avenir patrimonial d’un enfant handicapé ou du conjoint survivant dans une famille recomposée. La réforme était souhaitée depuis longtemps par le notariat7.
5 - Le hasard du calendrier fait parfois bien les choses. Lorsque l’équipe du 102e Congrès des notaires de France a commencé à travailler en 2004, deux ans avant le déroulement du Congrès sur les personnes vulnérables, elle a immédiatement relevé tout l’intérêt qu’il y avait à approfondir la question des libéralités substitutives et d’utiliser ensuite l’écho traditionnel reçu par les congrès pour en faire la promotion8. Cela s’était d’autant plus imposé que venait depuis peu d’être publiée l’Offre de loi issue du formidable bouillonnement intellectuel d’un groupe exceptionnel composé de Jean Carbonnier, Pierre Catala, Jean Bernard de Saint Affrique et Georges Morin9. Comment être mieux aidé ! À la même époque, on n’avait aucune idée du moment où pourrait éventuellement intervenir une grande réforme du droit des successions et libéralités attendue depuis si longtemps. Et lorsqu’est enfin présenté en juin 2005 un projet de loi, force fut de constater que les libéralités substitutives avaient été laissées de côté, les propositions de l’Offre de loi n’ayant pas été reprises. Cela donnera à nos instances professionnelles et à notre équipe une motivation supplémentaire pour insister et, avec d’autres, chercher à convaincre la représentation parlementaire d’adapter sur ce point le projet de loi. L’Assemblée nationale a pris l’initiative de desserrer l’étau qui emprisonnait les substitutions permises. Pour justifier cette judicieuse révolution, la commission des lois mit en avant l’utilité de la technique substitutive pour protéger les droits de l’enfant handicapé et du conjoint survivant10. C’est l’occasion de saluer le rôle essentiel joué par M. Sébastien Huyghe, rapporteur qui, du fait de sa formation notariale, fut particulièrement à l’écoute. Le calendrier législatif a suivi son rythme tout comme la préparation du Congrès. Notre rapport fut rendu et publié avant le vote de la loi tout comme eurent lieu, au mois de mai 2006, les débats lors du Congrès autour de nos deux propositions. C’était pour nous l’occasion de tenter de faire bouger le législateur sur les points qui nous semblaient encore devoir être améliorés pour les libéralités substitutives, en soutenant certains éléments pratiques de l’Offre de loi que le législateur ne semblait pas vouloir intégrer. Nos deux propositions furent largement adoptées mais n’ont pas réussi à convaincre le législateur – et plus particulièrement le Sénat, resté frileux11. Avec le recul, on ne peut que le regretter, car les freins au développement des libéralités résiduelles et graduelles, constatés depuis et critiqués par une large part de la doctrine, ont confirmé que les auteurs de l’Offre de loi avaient raison.
6 - L’orientation de cette contribution, est d’essayer de voir pourquoi, en présence d’une personne vulnérable, les libéralités résiduelles et graduelles présentent un intérêt supplémentaire (1). Pour autant, au regard des insuffisances parfaitement identifiées par la doctrine, on ne peut nier certaines difficultés mais qui auront souvent moins de conséquences en présence d’une personne vulnérable (2) ?
1.Pourquoi conseiller, en présence d’une personne vulnérable, les libéralités graduelles et résiduelles ?
7 - Afin de tenter de répondre à cette question, il est utile de rappeler le contexte particulier lié à la présence d’une personne vulnérable hors d’état de manifester sa volonté parmi les enfants d’une fratrie mais également lorsqu’il s’agit d’un enfant unique (A). Ensuite, notre regard se portera sur les avantages des libéralités substitutives de son vivant (B) avant de voir leurs avantages après le décès de l’enfant (C).
A. -Un rappel du contexte particulier lié à la présence d’une personne vulnérable
8 - Présence d’un enfant handicapé. – Les notaires savent, lorsqu’ils sont consultés par des parents souhaitant préparer une transmission patrimoniale familiale, qu’une difficulté se révèle fréquemment dans une situation particulière : la présence parmi les descendants d’un enfant handicapé ne pouvant pourvoir seul à ses intérêts « en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté » (C. civ., art. 425, al. 1).
Une première interrogation est souvent soulevée par les parents à propos de ce que pourrait recevoir leur enfant handicapé. Notre confrère Jacques Motel l’avait parfaitement rappelé à Strasbourg lors des débats autour de la première des propositions rappelées plus haut en déclarant : « mon expérience, qui est certainement celle de la plupart d’entre vous, correspond aux interrogations des parents d’un enfant handicapé qui, dans une alternative douloureuse, s’interrogent sur la question de savoir s’il faut augmenter la part de leur enfant handicapé ou s’il faut au contraire, pour des raisons diverses, la réduire »12. On pourrait rajouter qu’une option supplémentaire est également envisagée, celle consistant à traiter à égalité tous les enfants.
9 - En complément de cette première interrogation, une seconde se pose naturellement : quel sera le devenir de ce qui reviendra à l’enfant handicapé de son vivant et après sa mort ?
Avant de tenter de proposer quelques réponses, il est nécessaire de rappeler une autre situation particulière, celle de parents n’ayant qu’un enfant, celui-ci étant handicapé. Dans ce cas, la première interrogation prend moins d’importance alors que la seconde se pose toujours.
Si le notaire intègre dans sa réflexion, et dans ce qu’il va proposer ensuite à ses clients, la technique des libéralités substitutives, on va s’apercevoir qu’il va pouvoir en partie répondre aux interrogations soulevées et rassurer les parents.
B. -Les avantagesdes libéralités substitutives au profit d’un enfant vulnérable de son vivant
10 - Les libéralités graduelles et résiduelles.– Les libéralités graduelles et résiduelles permettent de disposer à titre gratuit au profit de deux gratifiés successifs, que ce soit par donation ou par voie testamentaire. Au décès du premier bénéficiaire, le second est appelé à recevoir les biens qui ont été donnés ou légués. Dans la libéralité graduelle, le premier gratifié doit accepter la double charge de conserver et de transmettre les biens reçus. Avec la libéralité résiduelle, il s’engage seulement à transmettre les biens qui subsisteront à son décès. C’est une véritable libéralité à double détente13.
Du vivant de l’enfant vulnérable qui n’a généralement pas de descendant, cela permet de le doter sans chercher à réduire sa part au motif que l’on voudrait limiter une déperdition du patrimoine à son décès en raison d’une transmission alors lourdement taxée sur le plan fiscal. Après le décès des parents, l’enfant disposera de revenus et de biens de nature à mieux assurer son avenir sous le contrôle et avec l’aide de son curateur ou de son tuteur. Chez les parents s’estompe ainsi le sentiment de mauvaise conscience qu’ils ont généralement s’ils privent partiellement un enfant de ses droits.
Remarque
Dans de rares cas où les parents souhaiteraient au contraire augmenter la part de leur enfant handicapé et lui faire bénéficier de tout ou partie de la quotité disponible, le recours aux libéralités substitutives est de nature à permettre plus facilement de rétablir ultérieurement l’équilibre vis-à-vis des autres enfants.
Fin remarque
11 - Choix de la forme de la libéralité.– Ajoutons une observation à propos du choix à opérer entre une donation ou donation-partage et une disposition testamentaire. En cas de donation ou donation-partage, l’introduction d’une clause classique de droit de retour ne sera pas en opposition avec le caractère résiduel ou graduel de l’acte. Si l’enfant décède avant ses parents, le droit de retour s’exercera et les parents disposeront des biens au profit des autres enfants ou de toute personne de leur choix.
Ce point est non négligeable, notamment lorsqu’il y a plusieurs enfants et que les parents souhaitent faire bénéficier tous les enfants des avantages d’une donation-partage. S’il y a un seul enfant, en revanche, il apparaît souvent que les parents ne souhaitent pas donner de biens importants de leur vivant et qu’ils recourent de préférence à des dispositions testamentaires. Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients, ce que le notaire expliquera en détail à ses clients afin qu’ils se déterminent. S’il y a plusieurs enfants, rien n’écarte le recours à l’utilisation de la voie testamentaire et il suffira d’en comparer les conséquences par rapport à une donation-partage. C’est l’occasion de réfléchir au recours à un testament-partage qui est assez peu utilisé.
C. -Les avantages des libéralités substitutives au profit d’un enfant vulnérable après son décès
12 - Elles offrent une parfaite opportunité aux parents d’un enfant vulnérable, hors d’état de manifester sa volonté, d’organiser la transmission à son décès de ce qu’ils lui auront donné. Certes, il y a des limites qui seront présentées plus loin mais les avantages des libéralités graduelles et résiduelles sont d’un intérêt majeur.
13 - S’il y a un enfant unique handicapé sans descendant... – Lorsqu’il y a un enfant unique handicapé sans descendant, ses parents s’interrogent sur la qualité des héritiers présomptifs qui seront au mieux des collatéraux ordinaires. Parallèlement, il arrive qu’il y ait des proches, parents éloignés ou non-parents, portant un intérêt particulier à l’enfant handicapé. Ils le font de manière totalement désintéressée mais il serait souhaité les récompenser. Autre hypothèse constatée, relativement fréquente contrairement à ce qui avait pu être prévu au moment du vote de la loi14 : les parents souhaitent faire bénéficier une association reconnue d’utilité publique ou une fondation de ce qu’ils auront transmis à leur enfant handicapé et qui restera à son décès. Ils assurent ainsi la protection de leur enfant et un soutien à une structure associative leur tenant à cœur, structure ayant souvent pour objet l’aide de personnes handicapées. Quelle que soit la situation, le recours aux libéralités substitutives est de nature à apporter des réponses satisfaisantes ou, au minimum, les moins mauvaises.
14 - … ou s’il est membre d’une fratrie. – Lorsqu’il y a plusieurs enfants issus du couple, les frères et sœurs de l’enfant handicapé ont fréquemment des descendants. Dans une telle hypothèse, le recours aux libéralités substitutives va permettre d’organiser plus facilement la transmission successorale au décès de l’enfant handicapé des biens donnés ou légués au profit de frères ou sœurs ou de neveux ou nièces. L’avantage fiscal sera un élément essentiel à prendre en compte car une taxation en ligne descendante est nettement moins lourde qu’en ligne collatérale. Or, ici la taxation prendra en compte le lien de parenté entre les parents auteurs du don ou du legs et les bénéficiaires en second.
Enfin, il convient de rappeler un autre élément essentiel sur lequel il est important d’insister, celui des avantages des libéralités substitutives au niveau des risques de récupérations d’aides publiques perçues par l’enfant handicapé de son vivant. En effet, le régime juridique de ces libéralités aboutit à faire disparaître du patrimoine de l’enfant les biens dont elles étaient l’objet. Le second gratifié appréhende le residuum non pas dans la succession du premier gratifié mais directement de celle du donateur ou testateur d’origine. Dès lors, le défunt est censé ne les avoir jamais détenus et ils échappent ainsi totalement à tout risque de récupération15. Une telle récupération ne portera éventuellement que sur le patrimoine du défunt ne provenant pas des libéralités substitutives16.
Au total, en proposant d’opter pour des libéralités graduelles ou résiduelles, cela est susceptible de permettre aux parents d’écarter une hypothèse qu’ils auraient pu avoir envisagé, celle de réduire la part revenant à leur enfant handicapé. Certes, on verra que tout n’est pas réglé mais cela reste une piste à privilégier.
2.Relativiser les difficultés inhérentes aux libéralités substitutives en présence d’une personne vulnérable
15 - Plusieurs difficultés ont été relevées par la doctrine, plus ou moins importantes selon que la libéralité sera résiduelle ou graduelle. Cela concerne principalement les questions de respect de la réserve héréditaire (A) et la conservation éventuelle des biens (B). Suivant le recours à une libéralité graduelle ou résiduelle, le degré de difficultés sera différent mais il apparaîtra qu’il sera souvent moins sensible en cas de libéralité au profit d’une personne vulnérable. Par ailleurs, on a fréquemment tendance à considérer que l’on doit opter pour un type de libéralité et on ne réfléchit pas assez à la faculté d’avoir un cumul des deux types de libéralités (C).
A. -Relativiser, en présence d’une personne vulnérable, la question du respect de la réserve héréditaire
16 - Concernant les libéralités graduelles. – En matière de respect de la réserve héréditaire, il est utile de distinguer les libéralités résiduelles des graduelles car le législateur ne les a pas traitées de la même manière17.
En matière de libéralité graduelle, rappelons que si le grevé est l’héritier réservataire du disposant, ce qui sera le cas, la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible (C. civ., art. 1054, al. 1). Il est toujours possible pour le grevé d’accepter que la double charge de conserver et de transmettre empiète, en tout ou en partie, sur sa part de réserve. Et si ce n’est pas le cas, le grevé est en droit d’agir en cantonnement afin de faire réduire l’assiette de la charge.
17 - Si on applique ces règles au cas d’un enfant hors d’état de manifester sa volonté, il semble peu probable qu’une acceptation de la double charge soit acceptée, surtout en cas de tutelle où l’acceptation d’une libéralité avec charge nécessite l’accord du juge des tutelles ou du conseil de famille. Si le grevé est soumis à un régime de curatelle, il faudrait que l’acceptation émane de lui-même et de son curateur, ce qui est parfaitement envisageable. Reste la question de l’action en cantonnement pour laquelle il n’est pas certain que le représentant de l’enfant agira systématiquement. Très souvent, sa désignation a été faite en lien avec les parents de l’enfant handicapé qui ont une confiance en lui. Ils ont généralement fait part de leurs souhaits, et notamment celui de voir la libéralité graduelle respectée en l’état.
Dès lors qu’il n’y a rien d’automatique, on peut estimer qu’il n'y a pas d’obstacle insurmontable à une libéralité résiduelle portant sur la totalité. On verra toutefois un peu plus loin que l’on peut imaginer une autre solution plus raisonnable.
18 - Concernant les libéralités résiduelles. – Si on porte le regard sur la libéralité résiduelle, il n’apparaît pas une restriction semblable et elle pourra porter sur la réserve héréditaire. Il existe toutefois une limite, à savoir que le gratifié héritier réservataire conserve la possibilité de disposer entre vifs ou à cause de mort des biens donnés en avancement de part successorale. Le gratifié, et lui seul, peut demander le cantonnement la réduction de l’assiette de la charge. Dès lors, s’il n’utilise pas ce droit et s’il n’utilise pas son pouvoir de tester sur les biens donnés en avancement de part successorale, la libéralité résiduelle s’exécutera sans limitation.
Si on applique ces principes très brièvement rappelés, on constate que la présence d’une personne hors d’état de manifester sa volonté est susceptible d’atténuer les contraintes apparues. Dans de nombreux cas, l’enfant handicapé n’est pas en capacité de tester et les demandes d’autorisation de tester auprès du juge apparaissent assez peu nombreuses. Il est également constaté qu’il est assez peu réalisé de donations par une personne atteinte d’une perte de capacité. Il existe effectivement des possibilités mais elles restent peu utilisées. Au total, faire porter la libéralité résiduelle sur la totalité de ce qui est transmis à un enfant vulnérable ne pose pas de difficultés majeures. Et, dans les cas où cela pourrait s’avérer utile, l’action en cantonnement reste possible.
B. -Relativiser, en présence d’une personne vulnérable, les questions liées à la conservation des biens objet d’une libéralité substitutive
19 - À propos de la contrainte de conservation. – Rappelons brièvement que la libéralité graduelle implique, pour le premier gratifié, de conserver les biens donnés ou légués et de les transmettre, au jour de son décès, à un second bénéficiaire choisi par le disposant. Il s’agit d’une conservation en nature avec un léger assouplissement lorsque la libéralité porte sur des valeurs mobilières (C. civ., art. 1049). Il ne sera pas développé ici les hésitations relatives à ce type de libéralité pas plus que les critiques de la doctrine18.
Une technique permettant de contourner cette contrainte a été rapidement suggérée, celle de mettre les biens à transmettre sous forme sociétaire avant de consentir la libéralité graduelle19. L’exemple cité est celui de la mise en société civile d’un ou plusieurs immeubles puis d’une libéralité graduelle portant sur les parts sociales. L’obligation de conserver en nature concernera ces parts mais pas le patrimoine de la société qui pourra faire l’objet de mutations. Dans le cas d’une libéralité graduelle au profit d’un enfant handicapé, cette solution devra faire partie des options à proposer d’autant plus, lorsqu’il y a plusieurs enfants, qu’il est parfois intéressant d’attribuer à l’enfant handicapé des parts sociales d’une société dans laquelle seront présents les autres enfants et que ces derniers pourront gérer20.
20 - Pour autant, il est évident que la libéralité résiduelle est nettement préférable au regard de l’absence d’une obligation légale de conservation21. Il a été avec juste raison fait remarquer que l’attrait majeur de la libéralité résiduelle est de faire profiter le premier gratifié d’une très grande liberté22. Pour un enfant hors d’état de manifester sa volonté, cet avantage peut parfois sembler moins essentiel mais il mérite attention car cela s’avérera utile s’il devient nécessaire de disposer de biens pour faire face à des besoins de capitaux ou de ressources afin d’assurer son train de vie.
C. -Cumul des deux types de libéralités substitutives
21 - Combinaison des libéralités graduelle et résiduelle. –Les quelques réflexions qui précèdent conduisent à rappeler qu’un cumul des deux types de libéralités substitutives est un élément à prendre en compte. En pareil cas, la libéralité graduelle ne porterait que sur la quotité disponible, la libéralité résiduelle s’appliquant à la part de réserve héréditaire. Lorsqu’il y a un patrimoine important, on peut imaginer de consentir une libéralité graduelle portant sur des biens qui seront conservés mais dont l’auteur de la libéralité estime que le gratifié n’aura pas à en disposer. La libéralité résiduelle contiendra au contraire des biens dont le gratifié ou son représentant pourra disposer en cas de besoin. Il n’y a rien d’extraordinaire à concevoir cela, mais l’objectif est simplement de rappeler qu’il n’y a pas systématiquement un choix impératif à opérer et que l’on peut prévoir des libéralités de nature différente surtout en présence d’une personne hors d’état de manifester sa volonté. On parle souvent de la boîte à outils dont dispose le notaire pour conseiller ses clients. Elle est plus riche qu’on ne le pense parfois et il lui appartient de s’en saisir.
22 - En guise de conclusion, je souhaitais faire part d’un élément qui m’a surpris. En préparant cette contribution, j’ai effectué des recherches au sein de la doctrine. Il est apparu que les libéralités graduelles et résiduelles ont passionné les auteurs aussitôt après le vote de la loi du 23 juin 2006 puis cela s’est calmé surtout après 2012. Un regain d’intérêt s’est manifesté à l’occasion du dixième anniversaire de cette loi. Il n’a visiblement pas duré23. Le vingtième anniversaire qui se profile à l’horizon 2026 entraînera-t-il un sursaut ? Le relatif désintérêt constaté s’explique certainement par ce que j’indiquais dans l’introduction avec l’interpellation « ne pas oublier ! » qui s’adressait aux notaires. J’emprunterai, en sollicitant par avance leur indulgence, aux mêmes auteurs24 que dans mon introduction cette dernière phrase qui reste d’actualité, spécialement en présence d’une personne vulnérable : « àdéfaut de réveiller de jeunes princesses, le praticien peut ainsi à tout le moins contribuer à faire sortir de leur torpeur de belles demi-endormies en leur faisant gagner leurs lettres de noblesse ».▪
L'essentiel à retenir
- Pour les parents d’un enfant handicapé ne pouvant pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, que cet enfant soit unique ou membre d’une fratrie, le recours aux libéralités graduelles ou résiduelles est une piste de réflexion à ne jamais oublier.
- Elles sont de nature à rassurer ces parents qui se posent naturellement la question du devenir de ce qui reviendra à l’enfant handicapé, de son vivant ou après sa mort. En y recourant, une opportunité est offerte aux parents d’organiser la transmission à son décès de ce qu’ils lui auront donné.
- Certes, il subsiste certaines limites mais que l’on peut relativiser en présence d’une personne vulnérable. C’est notamment le cas à propos du respect de la réserve héréditaire ou des questions liées à la conservation des biens objet d’une libéralité substitutive. Suivant le recours à une libéralité graduelle ou résiduelle, le degré de difficulté sera différent. Le notaire accompagnera ses clients afin de les amener à opter pour la solution la plus adaptée à leur situation familiale.
- Enfin, dans la panoplie qui se présente, il ne faut pas s’enfermer dans l’idée qu’il faudrait impérativement opter pour un type de libéralité. Le notaire doit également être à même de proposer parfois un cumul des deux types de libéralités.
Mots-clés : Famille - Libéralités - Libéralités graduelles et résiduelles
Notes
- V. par ex. l’abondante bibliographie proposée par M. Nicod, Substitutions : libéralités graduelles et résiduelles : JCl. Civil Code, fasc. synthèse. ↩
- 102e Congrès des notaires de France, Strasbourg, 2006, Les personnes vulnérables, G. Crémont, H. Lenouvel et F. Loustalet, rapport 4e commission, Les alternatives patrimoniales, spéc. n° 4224 et s. ↩
- J. Carbonnier, P. Catala, J. de Saint-Affrique et G. Morin, Des libéralités, Une offre de loi : éd. Defrénois. ↩
- 102e Congrès des notaires de France, Strasbourg, 2006, compte-rendu des débats, p. 170 et s. ↩
- V. not. M. Nicod, Libéralités graduelles : JCl. Civil Code, Art. 1048 à 1056, fasc. 10 et 20, et Libéralités résiduelles, JCl. Civil Code, Art. 1057 à 1061, fasc. unique. – F. Sauvage, Libéralités graduelles et résiduelles : Encyclopédie Dalloz. – Ch. Vernières et G. Bonnet, Réflexions pratiques sur les libéralités graduelles et résiduelles : Defrénois 2017, n° 125f8. – F. Sauvage, De la donation-partage graduelle ou résiduelle, Mél. en l’honneur du professeur Gérard Champenois : Defrénois. ↩
- M. Nicod, Libéralités – libéralités graduelles – Notion. Domaine. Formation : JCl. Civil Code, Art. 1048 à 1056, n° 5. ↩
- Rappelons que le 96e Congrès des notaires de France, Lille 2000, Le patrimoine du XXIe siècle, avait déjà réfléchi sur les libéralités substitutives et défendu ce que l’on appelait alors un « vœu » visant à une consécration légale de la libéralité de residuo (R. Gentilhomme et A. Houis, 3e commission, 1re proposition). D’autres congrès ont également été force de proposition, par exemple le 108e Congrès des notaires de France, Montpellier, 2012, La transmission, avec une proposition visant à Autoriser la subrogation dans les libéralités graduelles (S. Arnaud, S. Ginon et F. Petit, 3e commission, 1re proposition). ↩
- J. Carbonnier, P. Catala, J. de Saint-Affrique et G. Morin, Des libéralités, Une offre de loi : éd. Defrénois. ↩
- S. Huyghe, Rapport de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, 2006, 1re lecture, n° 2850, p. 243 et 277 et s. – M. Nicod, Libéralités – libéralités graduelles – Notion. Domaine. Formation : JCl. Civil Code, Art. 1048 à 1056, n° 7. ↩
- V. par ex. H. de Richemont, Rapport de la Commission des lois du Sénat 2006, 1re lecture, n° 343, t. 1, p. 204. ↩
- 102e Congrès des notaires de France, Strasbourg, 2006, Les personnes vulnérables, compte-rendu travaux des commissions, p. 176. ↩
- M. Nicod, JCl. Civil Code, fasc. synthèse, Substitutions : libéralités graduelles et résiduelles. ↩
- V. rapp. S. Huyghe, Rapport de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, 2006, 1re lecture, n° 2850, p. 279. ↩
- 102e Congrès des notaires de France, Strasbourg, 2006, Les personnes vulnérables, G. Crémont, H. Lenouvel et F. Loustalet, rapport 4e commission, Les alternatives patrimoniales, spéc. n° 4231. ↩
- Sur les questions de recours et récupération d’aides sociales, V. not. JCl. Notarial formulaire, fasc. 10 et 12, Aides sociales, par J. Combret. ↩
- V. not. M. Nicod, Libéralités résiduelles : JCl. Civil Code, Art. 1057 à 1061, fasc. unique. ↩
- V. not. L. Hude et C. Brenner, Les libéralités graduelles et résiduelles : du sommeil au réveil ? : JCP N 2016, n° 24, 1196, spéc. n° 9 et s. ↩
- V. not. G. Wicker, Le nouveau droit des libéralités : entre évolution, révolution et contre-révolution : Dr. & patr. 2007, n° 157, p. 82. ↩
- Attention toutefois, en pareil cas, à intégrer les contraintes liées à la présence par exemple d’un associé sous tutelle ou curatelle et notamment les conséquences du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008. ↩
- M. Nicod et X. Bouché, La mise en œuvre des donations résiduelles : JCP N 2016, n° 18, 1146. ↩
- L. Hude et C. Brenner, Les libéralités graduelles et résiduelles : du sommeil au réveil ? : JCP N 2016, n° 24, 1196, spéc. n° 28. ↩
- À signaler toutefois tout récemment : H. Rakotondraibe, De quelques questions pratiques relatives aux libéralités graduelles et résiduelles : JCP N 2024, n° 47, 1222. ↩
- L. Hude et C. Brenner, Les libéralités graduelles et résiduelles : du sommeil au réveil ? : JCP N 2016, n° 24, 1196, spéc. n° 43. ↩
LES ARTICLES
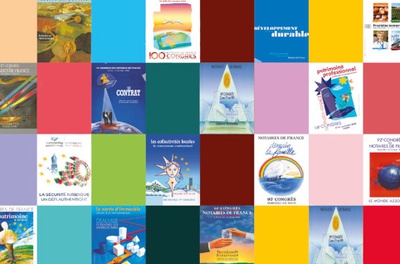
Introduction générale - Le notaire et la loi : « Et voudriez-vous… »
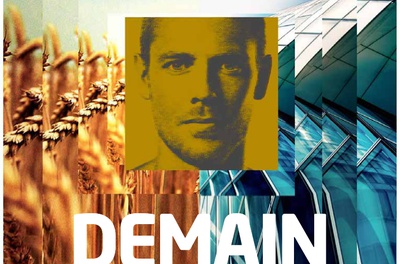
Introduction générale sur la famille
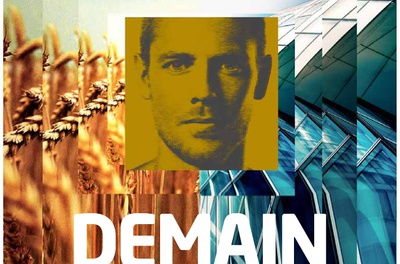
La contribution du notariat à l’amélioration du PACS
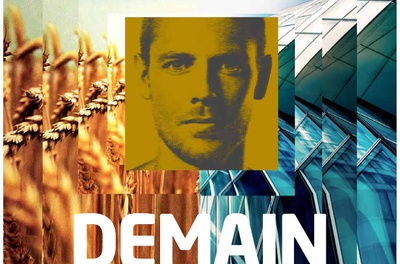
Les personnes vulnérables : quelles suites pour les propositions adoptées ?
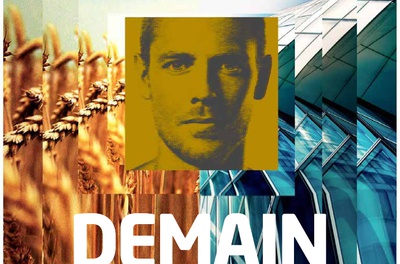
Libéralités graduelles et résiduelles : des solutions à ne pas oublier pour les personnes vulnérables
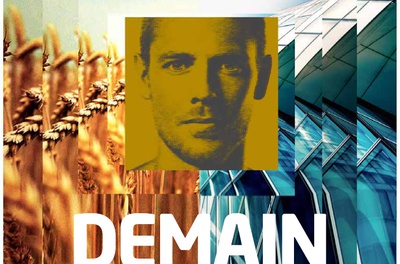
La renonciation à l'action en réduction des articles 929 et suivants du Code civil
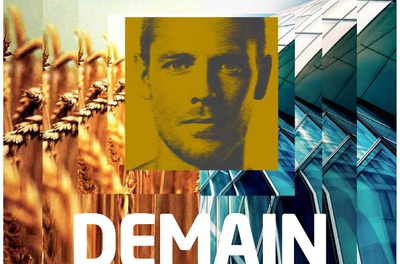
La vocation successorale égalitaire de tous les enfants
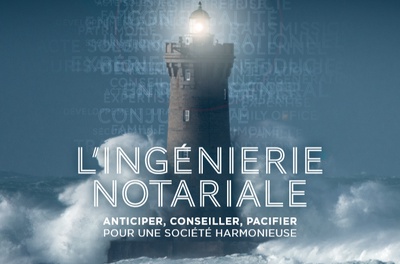
Introduction générale sur l’immobilier
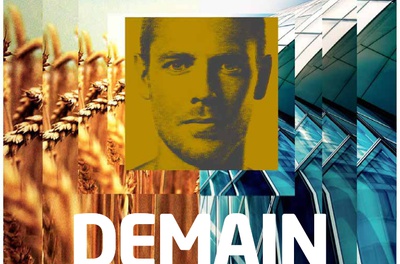
La vente d'immeuble à rénover : la suite de trois Congrès…
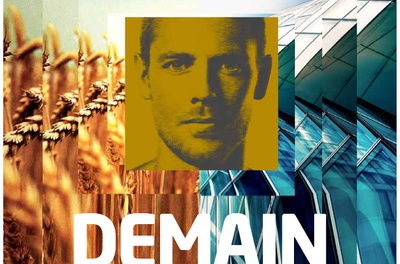
La vente en l’état futur d’achèvement : l’héritage des notaires bâtisseurs
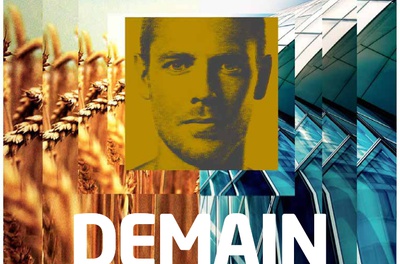
La division en volumes : l’inventivité notariale au service d’une nouvelle utilisation de l’espace
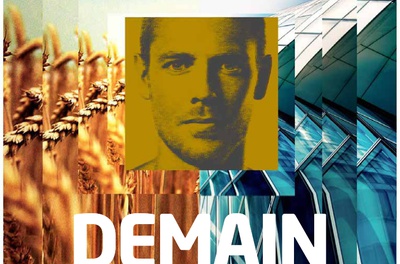
La reconnaissance par le droit de l’urbanisme du mécanisme de la prescription extinctive (C. urb., L. 421-9)
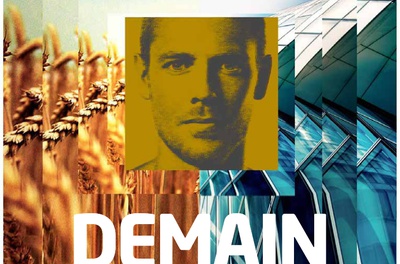
Le transfert par subrogation des accessoires garantis par l’inscription d’origine
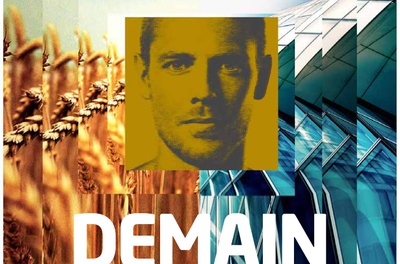
Introduction générale sur le droit public
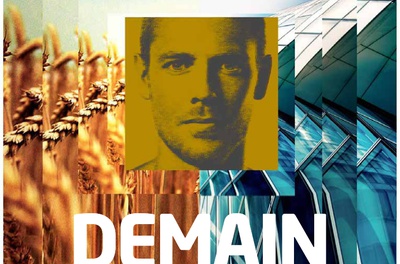
L'extension du déclassement par anticipation
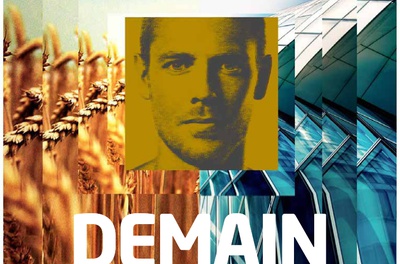
La sécurisation des droits du commerçant exploitant sur le domaine public
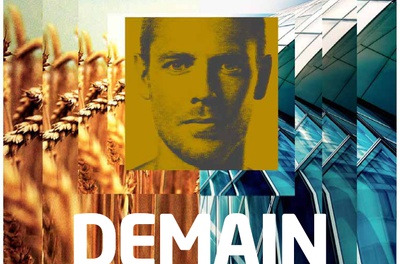
La sanction des clauses non conformes par le réputé non-écrit
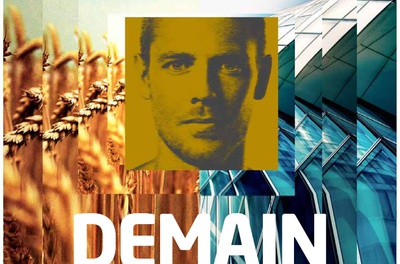
Entretien avec Jean-François Pillebout