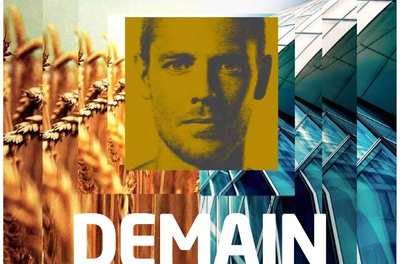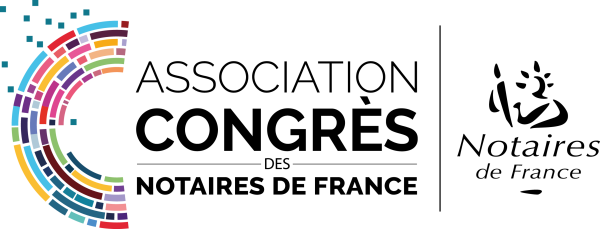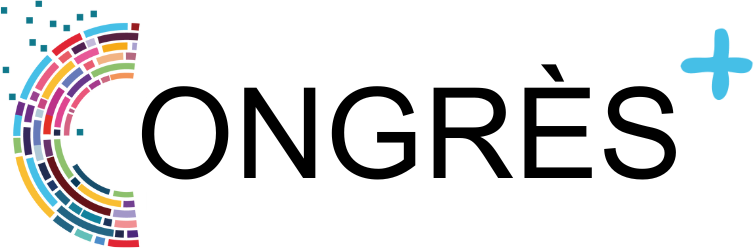Introduction générale - Le notaire et la loi : « Et voudriez-vous… »
Les apports des Congrès des notaires de France au droit
Plus de 200 textes législatifs et près de 130 règlementaires
inspirés des Congrès des notaires de France
L'extension du déclassement par anticipation
109e Congrès des notaires de France, Lyon 2013
1 - Domanialité publique et premier bilan. – Le 109e Congrès des notaires de France qui s'est tenu à Lyon en juin 2013 avait pour thème : « Propriétés publiques, quels contrats pour quels projets ? ». Plus spécialement consacrés à la question des transferts de propriété, les travaux de la deuxième commission ont été particulièrement marqués par le thème de la domanialité publique à un moment, 7 ans après l'entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques1 (CG3P), où il pouvait sembler pertinent de vouloir formuler un premier bilan de la codification.
À cet égard la deuxième commission a rapidement pris la mesure du profond renouveau qu'avait connu la domanialité publique, oscillant entre une grande continuité avec le droit jurisprudentiel antérieur, et une inflexion certaine2.
2 - Continuité. – Au chapitre de la continuité, il faut bien entendu relever la réaffirmation de la protection particulière dont bénéficient les biens dépendant du domaine public3 : ils sont inaliénables, et cette inaliénabilité est elle-même protégée par l'imprescriptibilité. Un bien qui est entré dans le domaine public ne peut donc pas en sortir sans qu'ait été respectée la procédure prévue par la loi. Et si par malheur cette procédure n'a pas été respectée, le vice demeure, le transfert de propriété fautif ne pourra être sauvé par aucune prescription.
3 - Inflexion. – Il faut en revanche classer au rang des inflexions certaines atténuations des principes, dont l'exemple peut-être le plus flagrant est l'admission par l'article L. 2122-4 du CG3P de la possibilité de constituer des servitudes conventionnelles sur les dépendances du domaine public « dans la mesure où leur existence est compatible avec l'affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s'exercent ».
Cette consécration d'une inflexion déjà amorcée en jurisprudence établissait clairement la véritable justification du régime protecteur du domaine public : ce qu'il s'agit de protéger n'est pas le bien en soi, ni la propriété publique (sinon, pourquoi y aurait-il également un domaine privé ?), mais l'affectation de ce bien à une utilité publique, soit un service public, soit l'usage direct du public.
Dès lors, partant de ce constat, la deuxième commission s'est sentie autorisée à avancer des propositions s'inscrivant dans ce qu'elle a pu concevoir comme un assouplissement de la règle. Le dogme de la sacro-sainte domanialité publique, protégée à tout prix, pouvait céder la place à une approche plus pragmatique.
4 - Deux propositions. – C'est dans cet esprit qu'ont été élaborées deux propositions regroupées sous un même propos introductif, parce qu'elles avaient en commun de réduire les conséquences des « mauvais déclassements » : ces biens issus du domaine public qui, parce qu'une maladresse est commise lors de leur mise en circulation, constituent ce que la commission a appelé des « bombes à retardement ». Est-il opportun de conserver indéfiniment, imprescriptiblement, un régime protecteur pour une affectation qui, de fait, a bien cessé et n'appelle plus cette protection ?
5 - Régularisation. – La première proposition avait une approche curative : il s'agissait, précisément, d'envisager la possibilité de régulariser a posteriori des déclassements fautifs, dès lors que l'affectation à un service public ou à l'usage direct du public n'était pas atteinte. Cette proposition, sans doute plus difficile à mettre en œuvre, il faut le reconnaître, n'a pas encore retenu l'oreille du législateur.
6 - Prévention. – Il en va tout différemment de la seconde proposition, qui relevait quant à elle d'une approche préventive. Il s'agissait en effet d'éviter les difficultés pratiques que l'on peut rencontrer à l'occasion d'une opération complexe de déclassement, en étendant les possibilités déjà prévues par les textes de procéder à des déclassements par anticipation. Un rappel des termes de la proposition permettra de mieux comprendre en quoi les réformes de 2016 puis 2017 répondent particulièrement bien aux vœux du Congrès.
1. La proposition du 109e Congrès des notaires pour l'extension du déclassement par anticipation
7 - La réflexion du Congrès des notaires peut être résumée de la façon suivante : après avoir identifié pourquoi il fallait étendre le déclassement par anticipation prévu par l'article L. 2141-2 du CG3P, la proposition s'était attachée à indiquer comment il fallait le faire.
A. - Pourquoi étendre le champ d'application du déclassement par anticipation ?
8 - On ne rappellera que brièvement ici le principe du déclassement du domaine public : celui-ci étant inaliénable et imprescriptible, un bien ne peut en sortir que s'il est régulièrement déclassé. Tout l'enjeu de la question se trouve dans la profonde dissymétrie qui oppose l'entrée et la sortie du domaine public : alors que l'entrée dans le domaine public relève du pur fait, la sortie est mêlée de fait et de droit.
9 - Entrée dans le domaine public. – On entre dans le domaine public par le pur fait : le régime de la domanialité publique s'applique à un bien, propriété d'une personne publique (CGPPP, art. L. 2111-1), dès lors qu'il se trouve affecté à une utilité publique, qu'il s'agisse de l'usage direct du public, ou d'un service public moyennant, dans ce second cas, un aménagement indispensable. Ce fait suffit, sans autre formalité, sans autre publicité, sans enregistrement particulier. Il n'y a donc pas de catalogue des biens entrés dans le domaine public.
10 - Sortie du domaine public. – En revanche, la sortie du domaine public appelle, en plus du fait, une formalisation. C'est ce qu'exprime l'article L. 2141-1 du CG3P : un bien « qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement ». Le droit vient donc s'ajouter au fait. Mais le fait reste essentiel : la désaffectation, en fait, doit absolument précéder le déclassement, en droit. C'est ce que signifie clairement la locution « qui n'est plus… », fidèle en cela à l'ancienne construction jurisprudentielle donnée par le Conseil d’État dans son arrêt Marrot du 20 juin 19304, puis dans son important avis du 31 janvier 19955. C'est aussi l'enseignement du fameux arrêt préfet de la Meuse6 : non seulement le bien doit être désaffecté, mais il ne doit pas être réaffecté entre-temps à une autre utilité. Le Conseil constitutionnel a lui aussi plusieurs fois confirmé cette jurisprudence7.
11 - Une règle cohérente … – La règle est on ne peut plus logique : dès lors que l'entrée dans le domaine public résulte du simple fait, il faut que, dans les faits, l'affectation ait cessé pour que le bien n’entre pas à nouveau, immédiatement, dans le domaine public. Le déclassement est par nature inopérant, faute de désaffectation préalable effective.
12 - … mais source de difficultés pratiques. – Pour claire et logique – imparable même – que soit la solution, elle n'en constitue pas moins, en pratique, une difficulté majeure et pour tout dire, un risque de dérapage lors des opérations de déclassement. Car si, en théorie, le séquençage « désaffectation puis déclassement » se comprend bien, la réalité du terrain est tout autre. Ce n'est pas toujours si facile de mettre fin à une affectation : cela nécessite une interruption du service public, quand bien même le projet est généralement de l'améliorer. Cela contraint à des déménagements compliqués : on ne désaffecte pas une installation militaire, un hôpital, une voirie, comme on déménage d'un appartement ! Il faut en outre penser à préparer le nouveau site qui accueillera l'activité, et bien entendu financer l'opération.
13 - Déclassement par anticipation. – C'est toute l'utilité d'un déclassement par anticipation, dérogation au principe posé par l'article L. 2141-1 du CG3P, qui consiste à acter la décision de déclasser avant d'avoir effectivement mis fin à l'affectation. Cela permet à la personne publique de s'organiser de manière à procéder à un déménagement progressif de l'ancien site vers le nouveau tout en permettant, le cas échéant, de financer la nouvelle implantation grâce au produit de la cession de l'ancien site.
Remarque
Surtout, cela règle aisément le débat sur la validité des promesses de vente portant sur les dépendances du domaine public : le déclassement par anticipation est en effet une réponse particulièrement adaptée pour permettre à un propriétaire public, vendeur, de s'engager sur la vente future d'une dépendance du domaine public, à ce titre encore inaliénable, sous condition de l'effectivité de la désaffectation à la date de réalisation.
Fin de remarque
14 - L'utilité d'une telle solution avait bien été comprise par le CG3P qui, dès l'origine, avait ouvert la voie au déclassement par anticipation par son article L. 2141-2, alors rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article L. 2141-1, le déclassement d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel de l'État ou de ses établissements publics et affecté à un service public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l'acte de déclassement. Ce délai ne peut être supérieur à une durée fixée par décret. Cette durée ne peut excéder trois ans. En cas de vente de cet immeuble, l'acte de vente stipule que celle-ci sera résolue de plein droit si la désaffectation n'est pas intervenue dans ce délai ».
15 - Cette rédaction a paru trop étriquée au 109e Congrès des notaires qui, il faut le souligner, reprenait ainsi une critique déjà formulée par le 103e Congrès. Les limites qu'il s'agissait de repousser étaient de deux ordres, car touchant tant aux biens, qu'aux propriétaires concernés.
1° La limite quant aux biens concernés
16 - Omission de la condition d’usage direct par le public. – La version d'origine de l'article L. 2141-2 du CG3P, à laquelle se référait le Congrès de 2013, comportait une étrange omission : s'il était question d'un bien « affecté à un service public », ce qui constitue, on l'a dit, l'une des deux entrées dans la domanialité publique, le texte laissait de côté l'autre porte d'entrée, l'usage direct du public. L'impasse qui était ainsi faite sur une partie du domaine public ne semblait pas logique et, surtout, pouvait s'avérer dangereuse.
17 - Étude de cas. – Pour éclairer sa position, la deuxième commission avait pris l'exemple suivant : dans le cadre du réaménagement d'un centre-ville, il est prévu de déménager l'unité de soins dépendant d'un grand centre hospitalier8. Elle va être transférée du bâtiment dans lequel elle se trouve actuellement vers un nouvel immeuble à construire à quelques centaines de mètres de là. L'emprise actuelle occupée par l'unité de soins et ainsi libérée doit être cédée à un promoteur qui envisage de construire à la fois sur cette emprise et sur une portion du parking du musée, établissement public de l'État, qui se trouve à côté, et que les ambulances et les visiteurs de l'hôpital ont également pris l'habitude d'utiliser. La vente de l'unité de soins et de la portion de parking va fort opportunément permettre de compléter le budget de l'opération de construction du nouveau centre hospitalier. De son côté le promoteur est confiant : il a compris que l'unité de soins ne va cesser son activité que progressivement, mais entretemps il s'est assuré de la maîtrise, à terme, d'un terrain idéalement situé dans le nouveau centre-ville. Il est donc prêt à attendre un peu…
Malheureusement, les choses ne sont pas si simples. Le bâtiment affecté à l'unité de soins est affecté à un service public. Il est donc bien possible de procéder à son déclassement par anticipation pour le vendre, tout en maintenant son activité pendant un temps donné. Celui des travaux… Le parking du musée en revanche, qui n'est pas affecté à un service public mais à l'usage direct du public, doit être désaffecté si l'on veut pouvoir le vendre en même temps.
D'où cette situation ubuesque : sur une même emprise, une partie des biens peut être déclassée par anticipation, et l'autre non. Uniquement parce que ces biens sont entrés dans le domaine public d'une manière différente. Pire : pour pouvoir continuer à utiliser l'unité de soins conformément à son affectation, il faudrait pouvoir continuer à utiliser le parking qui lui est si utile, ce que l'on ne peut pas faire. Il faudrait alors renoncer à le désaffecter ! Ce qui conduit à compromettre également, en pratique, le déclassement par anticipation de l'unité de soin qui ne peut fonctionner sans le parking.
Remarque
Cet exemple montrait pourquoi il semblait indispensable de pouvoir déclasser par anticipation tous les types de dépendances du domaine public artificiel immobilier, sans distinguer entre ceux qui sont affectés à l'usage direct du public, et ceux qui sont affectés à un service public.
Fin remarque
Mais les critiques de la deuxième commission ne s’arrêtaient pas à cette première limite.
2° La limite quant aux propriétaires publics concernés
18 - Un dispositif au champ d’application limité. – Le texte de l'article L. 2141-2 dans sa version d'origine, soit celle de 2006, se cantonnait en effet aux immeubles « appartenant au domaine public artificiel de l'État ou de ses établissements publics », la mesure ayant ensuite été étendue aux établissements publics de santé (CSP, art. L. 6148-6). Là encore, les justifications habituellement proposées pour expliquer cette discrimination ne semblaient pas convaincantes, raison pour laquelle le Congrès souhaitait étendre la mesure aux biens appartenant à toutes les personnes publiques, sans distinction.
19 - Arguments justifiant l'exclusion des autres personnes publiques. – Deux arguments semblaient venir au secours de l'exclusion des autres personnes publiques, et singulièrement des collectivités locales.
• le premier argument que l'on rencontrait était que seuls l'État et ses établissements publics avaient la capacité financière et technique de venir à bout des difficultés de mise en œuvre d'un déclassement par anticipation. Mais justement ! Pourquoi priver les collectivités, au prétexte de leur manque de moyens, du bénéfice d'un dispositif qui, précisément, leur en donnerait davantage, en permettant d'affecter le produit de la vente aux opérations de déménagement, et en donnant plus de temps (jusqu'à 3 ans) pour y parvenir ? Trois ans, qui est le délai maximal prévu par la loi, cela laisse à la collectivité et à son cocontractant le temps d'organiser la désaffectation progressive, dans le contrat ou surtout l'avant-contrat, dont la conclusion est favorisée par le déclassement par anticipation.
• le second argument, plus délicat à caractériser car souvent inavouable, était la traditionnelle méfiance qui existe à l'encontre des collectivités territoriales. Sont-elles assez sages pour manier un instrument aussi délicat que le déclassement par anticipation ? Ne risquent-elles pas d'en abuser alors qu'il s'agit d'une dérogation au principe de l'inaliénabilité du domaine public, et que cela doit le demeurer ?
20 - Pour inavouable qu'elle soit, cette motivation n'en était pas moins très présente dans les commentaires sur le sujet. C'est d'ailleurs très probablement à cause d'elle que le législateur n'avait pas encore entendu la proposition en ce sens déjà formulée par le Congrès de 2007. C'est donc pour dissiper ces réticences que le 109e Congrès avait précisé les modalités qui devaient, à son sens, accompagner l'élargissement du champ d'application du déclassement par anticipation aux biens de toutes les personnes publiques. Après le « Pourquoi ? », il fallait répondre au « Comment ? ».
B. - Comment étendre le champ d'application du déclassement par anticipation ?
21 - Pour vaincre les réticences largement dirigées contre les collectivités pour qui l'exercice semblait à certains trop complexes, la deuxième commission avait recherché des solutions simples. De fait, la proposition n'inventait rien : elle ne faisait que renforcer le dispositif déjà prévu dans l'article L. 2141-2 d'origine. Cette réponse s’exprimait de deux façons : la nécessité d’une justification, et le recours à la forme contractuelle.
1°La nécessité d’une justification
22 - Pour que le déclassement par anticipation ne devienne pas une solution de facilité manipulée par des apprentis-sorciers au risque de devenir, à terme, la procédure ordinaire, il convenait de faire ressortir les raisons particulières à chaque opération, qui justifient le recours à cette solution dérogatoire.
23 - Motivation expresse et circonstanciée. – Le texte en vigueur le faisait déjà en énonçant que le recours au déclassement par anticipation devait être justifié par les nécessités du service public. La proposition du Congrès retenait cette nécessité, tout en l'accentuant. Il s'agissait d'imposer à la personne publique qui aurait recours au déclassement par anticipation de motiver son choix de façon expresse et circonstanciée, en expliquant le calendrier des opérations et en expliquant en quoi le maintien de l'affectation, pour un temps donné, après la décision de déclasser, était dicté par les nécessités du service public.
Cette motivation serait une condition de validité du déclassement par anticipation dont le préfet vérifierait l'existence dans la décision soumise à son contrôle.
2°Le recours à la forme contractuelle
24 - Nécessité d’un contrat. – Dans la continuité de ces précisions, venait la seconde exigence, qui ne surprendra pas de la part des notaires : si l'on craignait que les collectivités s'engagent à la légère dans un déclassement par anticipation au risque de ne pas savoir en venir à bout dans les temps, il fallait mettre en avant la dimension contractuelle de l'opération. Il ne faut en effet pas oublier que l'opération se fait toujours dans le cadre d'un contrat, passé avec un acquéreur par exemple. Or, le texte d'origine imposait que l'on mentionnât dans ce contrat qu'il serait résolu si la désaffectation n'était pas réalisée à temps.
25 - La proposition du 109e Congrès voulait donner plus de corps à cette obligation, en précisant que la clause obligatoire devrait non seulement poser le principe de la résolution, mais aussi en organiser les suites (en termes de restitutions, de garanties, de sanctions contractuelles…) de sorte que les conséquences d'un manquement soient clairement identifiées, connues et prises en compte dès le départ.
26 - Proposition. –Telles étaient les réflexions qui avaient conduit à l'adoption d'une proposition ainsi formulée :
« Considérant :
-Que le dispositif prévu par l'article L2141-2 du CG3P répond à un réel besoin de souplesse dans les opérations de désaffectation et de déclassement précédant une vente,
-Qu'il est par conséquent regrettable que ce dispositif soit limité aux seuls biens affectés à un service public, sans que cette limitation puisse être justifiée,
-Qu'il est également regrettable que son bénéfice soit réservé à l'État, à ses établissements publics et aux établissements de santé, alors qu'il pourrait être utile à toutes les personnes publiques,
-Qu'il est néanmoins souhaitable que le recours à ce dispositif soit contrôlé, pour prévenir tout abus et préserver son caractère dérogatoire au principe de l'inaliénabilité du domaine public,
Le 109e Congrès des Notaires de France propose :
-Que l'article L. 2141-2 du CG3P soit modifié pour permettre le déclassement par anticipation de toutes les dépendances du domaine public, quel que soit leur propriétaire,
-Que la décision par d'autres personnes que l'État et ses établissements publics de déclasser par anticipation contienne, comme condition de sa validité, une motivation expresse expliquant en quoi le maintien de l'affectation pour un temps donné est imposé par les nécessités du service public.
-Que le contrat prévoie à peine de nullité une clause organisant les conséquences de la résolution qui découlerait du non-respect des conditions du déclassement par anticipation. »
2. L'extension du déclassement par anticipation par le législateur en 2016 puis en 2017
27 - La reproduction des termes de la proposition du Congrès est utile, pour comprendre en quoi le législateur l'a véritablement exaucée, en deux étapes : la loi du 9 décembre 20169 dite « Sapin 2 » complétée par l'ordonnance du 19 avril 201710 réformant le CG3P.
28 - Inspirationdu nouveau texte. – Comme souvent, le législateur ne révèle pas ses sources. A-t-il lu la proposition du Congrès ? Les travaux parlementaires ne permettent pas de l'affirmer avec certitude, même si d'autres aspects du travail de la deuxième commission ont pu être cités, en particulier dans un rapport du Sénat11. Il est donc difficile de pouvoir invoquer une filiation directe entre la proposition du Congrès des notaires et la rédaction de l'article L. 2141-2 du CG3P issue de ces deux interventions législatives. Pour autant le résultat, l'extension du déclassement par anticipation à toutes les dépendances du domaine public, quel que soit le mode d'affectation et le propriétaire, tout comme les modalités retenues pour le permettre, révèle une réelle convergence.
A. -L'extension aux collectivités territoriales par la loi « Sapin 2 » du 9 décembre 2016
29 - Article L 2141-2 du CG3P issu de la réforme de 2016. – D'entrée, la convergence est manifeste lorsque l'on prend connaissance du texte de l'article L. 2141-2 du CG3P issu de la réforme de 2016 (les modifications apparaissent ici en gras) : « Par dérogation à l'article L. 2141-1, le déclassement d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics et affecté à un service public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l'acte de déclassement. Ce délai ne peut être supérieur à une durée fixée par décret. Cette durée ne peut excéder trois ans. En cas de vente de cet immeuble, l'acte de vente stipule que celle-ci sera résolue de plein droit si la désaffectation n'est pas intervenue dans ce délai.
Toute cession intervenant dans les conditions prévues au présent article donne lieu, sur la base d'une étude d'impact pluriannuelle tenant compte de l'aléa, à une délibération motivée de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l'établissement public local auquel appartient l'immeuble cédé.
Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, l'acte de vente doit, à peine de nullité, comporter une clause organisant les conséquences de la résolution de la vente. Les montants des pénalités inscrites dans la clause résolutoire de l'acte de vente doivent faire l'objet d'une provision selon les modalités définies par le code général des collectivités territoriales ».
30 - Adoption des propositions du Congrès dans le texte de loi. – On le voit aisément, pour introduire les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics dans le domaine d'application du déclassement par anticipation, le législateur ajoute deux alinéas qui leur sont spécialement consacrés, et qui correspondent assez exactement aux deux préconisations du Congrès : voulait-on une motivation expresse et circonstanciée ? La loi Sapin 2 exige une délibération motivée reposant sur une étude d'impact. Voulait-on l'organisation contractuelle des conséquences de la résolution de la vente en cas de non-désaffectation à terme ? C'est ce que prévoit le texte, dans les mots-mêmes du Congrès.
Remarque
Ces deux exigences, perçues par les notaires comme une réponse à la supposée moindre maîtrise de l'exercice par les autres personnes publiques distinctes de l'État ou de ses établissements publics, leur sont bien réservées : c'est expressément formulé par les premiers mots du troisième alinéa, et induit par l'identité des organes délibérants « locaux » énumérés au deuxième alinéa.
L'État semble donc dispensé de ces formalités particulières, ce que l'on peut regretter dans la mesure où elles constituaient, dans l'esprit du Congrès, de bonnes pratiques à implanter au bénéfice de tous, y compris de l'État !
Fin de remarque
31 - Le législateur n'en est toutefois pas resté là car quelques mois plus tard intervenait l'ordonnance de 2017 dont l'objet était de mettre à jour le CG3P, après une dizaine d'années de pratique.
B. -L'extension à tous les types d'affectation par l'ordonnance du 19 avril 2017
32 - Avec la loi Sapin 2, la proposition du Congrès de 2013 était largement entendue quant au fond et la forme, pour ce qui concernait l'élargissement du déclassement par anticipation quant aux propriétaires publics concernés. Restait à en faire bénéficier également les dépendances du domaine public qui en demeuraient écartées parce qu'elles étaient affectées à l'usage direct du public.
33 - Article L. 2141-2 du CG3P issu de la réforme de 2017. – L'ordonnance de 2017 est heureusement venue compléter la loi de 2016 sur ce point, tout en apportant quelques précisions sur le « Comment ? » (les modifications de 2017 par rapport à 2016 apparaissent en gras) : « Par dérogation à l'article L. 2141-1, le déclassement d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel des personnes publiques et affecté à un service public ou à l'usage direct du public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public ou de l'usage direct du public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l'acte de déclassement. Ce délai ne peut excéder trois ans. Toutefois, lorsque la désaffectation dépend de la réalisation d'une opération de construction, restauration ou réaménagement, cette durée est fixée ou peut être prolongée par l'autorité administrative compétente en fonction des caractéristiques de l'opération, dans une limite de six ans à compter de l'acte de déclassement. En cas de vente de cet immeuble, l'acte de vente stipule que celle-ci sera résolue de plein droit si la désaffectation n'est pas intervenue dans ce délai. L'acte de vente comporte également des clauses relatives aux conditions de libération de l'immeuble par le service public ou de reconstitution des espaces affectés à l'usage direct du public, afin de garantir la continuité des services publics ou l'exercice des libertés dont le domaine est le siège.(Les deux alinéas suivants restent inchangés) ».
34 - Les apports de la rédaction de 2017 convergent parfaitement avec les réflexions du 109e Congrès. En premier lieu, l'introduction des biens affectés à l'usage direct du public vient compléter, conformément à la proposition, l'extension du champ d'application à toutes les dépendances du domaine public, sans distinguer la façon dont ils y sont incorporés.
Exemple
Le parking du musée pourra désormais bénéficier du déclassement par anticipation, comme l'unité de soins qu'il dessert également. L'extension souhaitée est ainsi parachevée.
Fin exemple
35 - Mais les modifications de 2017 ne s'arrêtent pas là, et il faut les approuver. On passera sur la reformulation du premier alinéa qui, tirant les conclusions de la réforme, supprime l'énumération désormais inutile des différents types de propriétaires publics concernés : ce sont bien aujourd'hui toutes les « personnes publiques » qui peuvent recourir au déclassement par anticipation. La modification est cependant purement formelle : les deux alinéas suivants n'étant pas modifiés, l'État demeure exempt du régime plus pointilleux réservé aux autres personnes publiques.
36 - Pour autant, les précisions apportées dans le premier alinéa, qui concernent donc également l'État et ses établissements publics, se font heureusement plus exigeantes, dans la mesure où les conséquences du déclassement par anticipation qui doivent être prévues « dans l'acte de vente » sont affinées. Cet aspect de la proposition du Congrès dont on pouvait regretter qu'il ne s'applique pas à l'État dans la version de 2016, s'impose désormais à lui pour ce qui relève de la continuité des services publics ou de l'exercice des libertés, c'est-à-dire de la raison d'être de l'affectation domaniale. Le contrat, la vente en l'espèce, étant bien comme le préconisaient les notaires, le support de cette précaution. Les notaires, rédacteurs d'actes, savent en effet à quel point l'exercice du passage obligé à l'écrit, qui présume une réflexion préalable, est un support à cette réflexion que l'on souhaite voir menée par la personne publique, quelle qu'elle soit, qui se risque à un déclassement par anticipation.
37 - Modification du délai. – Dernière innovation de 2017, le délai pendant lequel les opérations de déclassement par anticipation peuvent s'écouler est modifié. De fait, ce sujet, absent de la proposition du 109e Congrès telle qu'elle a été présentée à Lyon, n'avait pas échappé à la réflexion du notariat, ni aux débats en séance.
Le texte d'origine limitait le temps imparti pour parvenir à une désaffectation effective du bien déclassé par anticipation à un délai fixé par décret, mais borné par l'article L. 2141-2 du CG3P à 3 ans. L'équipe du 109e Congrès avait d'entrée été confrontée à la question, assez généralement partagée, de savoir si ce délai de 3 ans, d'ailleurs confirmé par le décret, était suffisant.
Des arguments contraires s'opposaient : pour des opérations par nature complexes, impliquant des processus souvent longs et sujets à recours (il suffit de penser aux autorisations d'urbanisme…), le délai de 3 ans peut sembler extrêmement court, ce qui fragilise l'usage du déclassement par anticipation et peut décourager d'y recourir. À l'inverse, donner trop de temps pourrait installer un faux sentiment de sécurité sans doute encore plus dangereux pour la bonne fin de la désaffectation dans les temps.
Partagée entre les deux arguments, et surtout soucieuse de ne pas alourdir la proposition par des considérations de détails, la deuxième commission avait renoncé à prendre position sur ce débat, qui ne manqua pas, pourtant, d'être évoqué en cours de séance par les questions de la salle. Or, d'une certaine façon, l'ordonnance de 2017 converge, là aussi, vers les réflexions du Congrès, en prenant certes position, mais d'une façon nuancée de nature à donner satisfaction tant aux partisans du délai de 3 ans, qu'à ceux d'un temps plus long.
38 - Un délai légal et prolongeable. – Le délai de 3 ans, tout d'abord, est consacré par le texte : il n'est plus un maximum imposé au pouvoir réglementaire, mais bien le maximum légal. Ce qui résulte probablement du constat pragmatique que ce délai de 3 ans reste court a priori, et qu'il demeure donc une bonne référence pour le droit commun. Mais vient ensuite la possibilité de doubler ce délai pour le porter à 6 ans au maximum, précisément dans les opérations complexes impliquant une construction, une restauration ou un réaménagement, c'est-à-dire justement celles qui pourraient être soumises aux nombreux et longs recours que l'on peut rencontrer dans ces matières.
C'est ainsi que la proposition du 109e Congrès des notaires de France s'est trouvée exaucée en tous points, et même au-delà, grâce à ce dernier aspect que l'équipe n'avait pas osé formaliser !▪
L'essentiel à retenir
- Le recours au déclassement par anticipation prévu par l’art. L. 2141-2 du CG3P a été offert la loi « Sapin 2 » du 9 décembre 2016 puis l’ordonnance du 19 avril 2017 à toutes les personnes publiques et à tous les types de dépendances domaniales, qu’elles soient affectées à un service public ou à l’usage direct du public, comme l’avait proposé le 109e Congrès des notaires.
- Les aménagements de la procédure mis en œuvre pour permettre cet élargissement sont ceux que le Congrès avait préconisés.
Mots-clés : Immobilier
Notes
- JCl. Propriétés publiques, fasc. 6, n° 22 et s. (pour la continuité) et n° 29 et s. (pour l'inflexion), par Ph. Yolka. ↩
- Il ne sera question ici que du domaine public artificiel immobilier. ↩
- CE, 20 juin 1930, Marrot : Lebon, p. 644 ; S. 1931, III, p. 31, concl. Rivet. ↩
- CE, 31 janv. 1995, avis n° 356960. ↩
- CE, 1er févr. 1995, préfet de la Meuse : Lebon, p. 782 ; Dr. adm. 1995, n° 261 ; JCP G 1995, IV, p. 1512. ↩
- Cons. const., 18 sept. 1986, n° 86-217 DC, relative à la loi sur la liberté de communication : Lebon, p. 141. – Cons. const., 23 juill. 1996, n° 96-380 DC, à propos des biens de France Télécom : AJDA 1996, p. 696. – Cons. const., 14 avr. 2005, n° 2025-513 DC : Dr. adm. 2005, n° 86, note R. Fraisse. ↩
- Les établissements publics de santé s'étaient déjà vu accorder le bénéfice du déclassement par anticipation comme on le verra infra. ↩
- L. n° 2016-1691, 9 déc. 2026, art. 35, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. ↩
- Ord. n° 2017-562, 19 avr. 2017, art. 9, relative à la propriété des personnes publiques. ↩
- Rapp. d'information Sénat, 1er oct. 2013, par MM. F. Pillet, R. Vandierendonck, Y. Collin et Ph. Dallier sur les outils fonciers à disposition des élis locaux, p. 46 et 47, sur les biens sans maître. ↩
LES ARTICLES
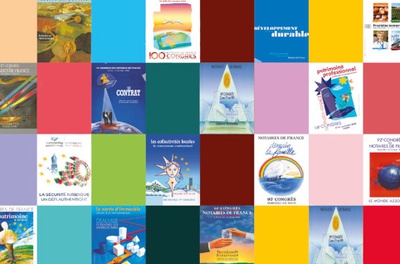
Introduction générale - Le notaire et la loi : « Et voudriez-vous… »
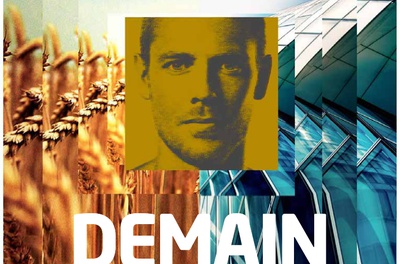
Introduction générale sur la famille
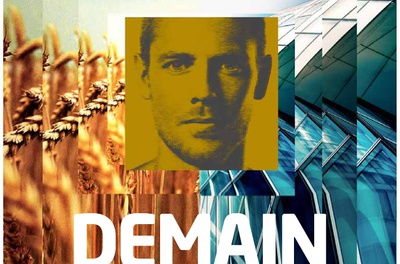
La contribution du notariat à l’amélioration du PACS
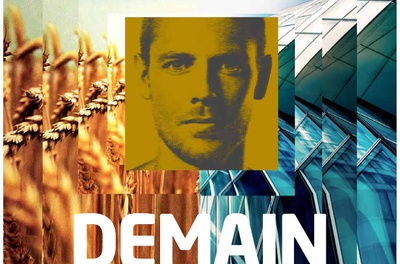
Les personnes vulnérables : quelles suites pour les propositions adoptées ?
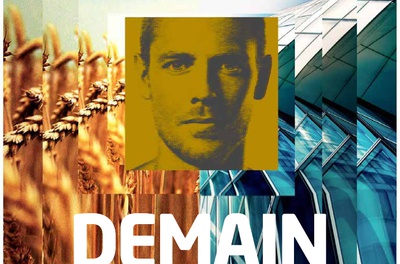
Libéralités graduelles et résiduelles : des solutions à ne pas oublier pour les personnes vulnérables
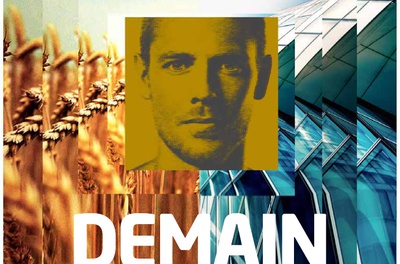
La renonciation à l'action en réduction des articles 929 et suivants du Code civil
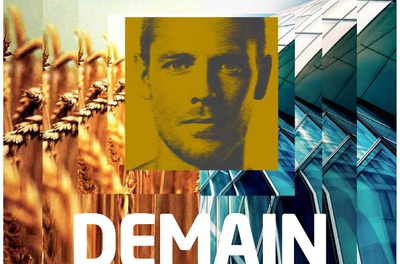
La vocation successorale égalitaire de tous les enfants
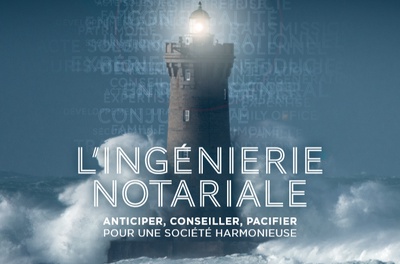
Introduction générale sur l’immobilier
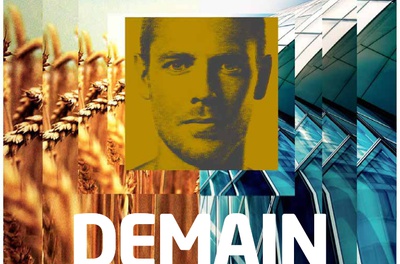
La vente d'immeuble à rénover : la suite de trois Congrès…
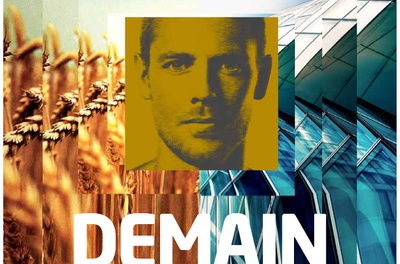
La vente en l’état futur d’achèvement : l’héritage des notaires bâtisseurs
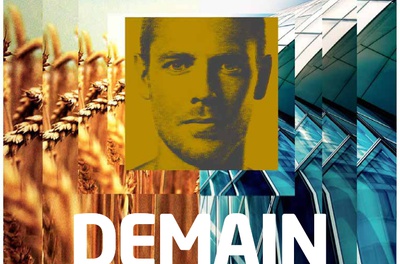
La division en volumes : l’inventivité notariale au service d’une nouvelle utilisation de l’espace
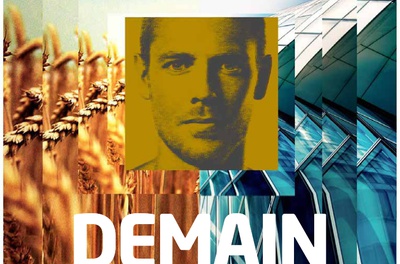
La reconnaissance par le droit de l’urbanisme du mécanisme de la prescription extinctive (C. urb., L. 421-9)
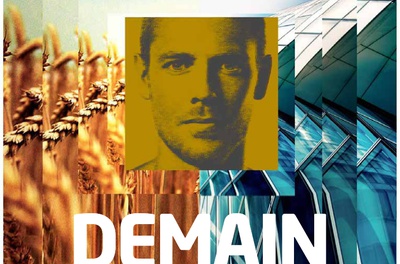
Le transfert par subrogation des accessoires garantis par l’inscription d’origine
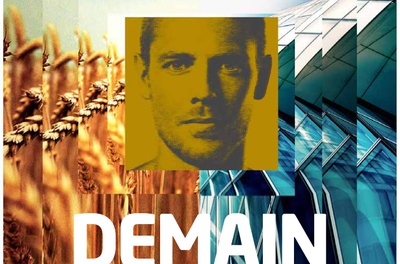
Introduction générale sur le droit public
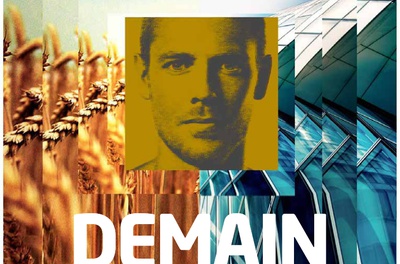
L'extension du déclassement par anticipation
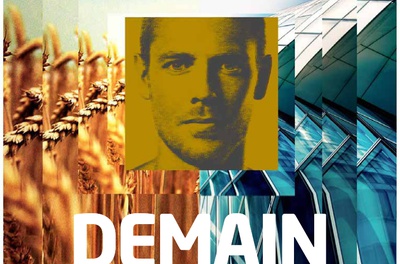
La sécurisation des droits du commerçant exploitant sur le domaine public
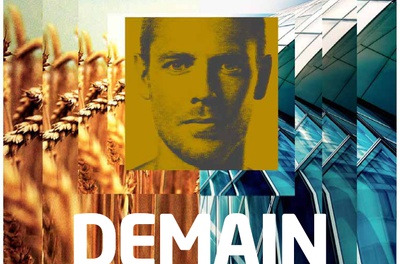
La sanction des clauses non conformes par le réputé non-écrit
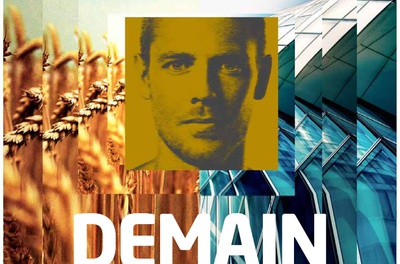
Entretien avec Jean-François Pillebout