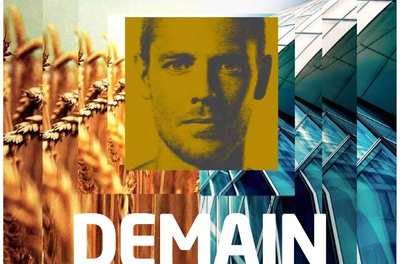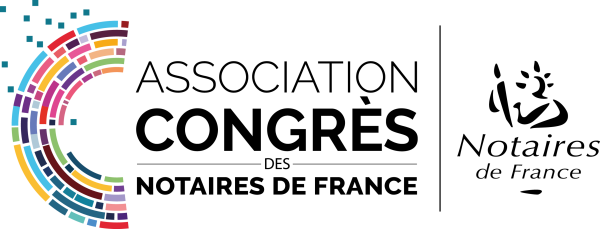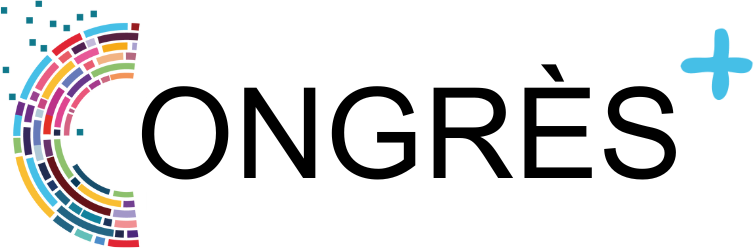Introduction générale - Le notaire et la loi : « Et voudriez-vous… »
Les apports des Congrès des notaires de France au droit
Plus de 200 textes législatifs et près de 130 règlementaires
inspirés des Congrès des notaires de France
Les personnes vulnérables : quelles suites pour les propositions adoptées ?
102e Congrès des notaires de France, Strasbourg 2006
1 - Lorsqu’en 2004, j’ai eu le privilège d’être désigné en qualité de président du futur Congrès des notaires de 2006, j’ai aussitôt fait part de mon souhait de le consacrer au thème des personnes vulnérables. Peu de temps après, rencontrant un confrère de ma région, celui-ci m’interpella : pourquoi avoir choisi un tel sujet, tu n’intéresseras personne ! Fort heureusement, son pronostic s’est avéré totalement démenti avec le succès rencontré par le congrès qui s’est tenu en mai 2006 à Strasbourg. Le choix d’un thème est naturellement influencé à la fois par les matières où on se sent le plus à l’aise et, très fréquemment, par une motivation plus personnelle. Ce fut mon cas, le droit de la famille me passionnant et le fait que ma famille soit concernée de près par la question des personnes handicapées ayant joué un rôle majeur. À mes côtés, j’ai eu la chance d’avoir un rapporteur général d’une humanité exceptionnelle et d’une finesse juridique remarquable. Avec Philippe Potentier, notre entente fut parfaite à tous niveaux. Ensemble, nous avons pu réunir une équipe de rapporteurs qui ont tous adhéré à notre projet et se sont investis à fond1. Tous les ingrédients afin d’essayer de réussir le congrès étaient réunis mais, parfois, cela ne suffit pas.
2 - Nous avons eu la chance de nous trouver au centre d’un calendrier politique et, par suite, législatif favorable. Il n’est pas inutile de rappeler qu’en une décennie, sous les mandatures du président de la République Jacques Chirac, avec deux majorités politiques de couleur différente, le droit de la famille a bénéficié d’une succession de réformes essentielles2 que la loi du 5 mars 20073 réformant le droit des majeurs protégés conclura. Ajoutons que le président Chirac était particulièrement soucieux de toutes les questions touchant au handicap et qu’il a usé de tout son poids pour parvenir faire adopter la grande loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
3 - Pour revenir au positionnement de notre thème, nous avions choisi un titre large avec la référence aux personnes vulnérables, ce qui englobait non seulement ceux de nos concitoyens atteints d’un handicap physique ou mental les empêchant de manifester leur volonté ainsi que les enfants mineurs, mais également ceux qui ont besoin d’aides provenant soit de leurs proches, soit de la société. Le champ de la vulnérabilité est vaste !
4 - Accompagnement associatif. – Durant toute la préparation du congrès, nous avons eu la chance d’être accompagnés par de nombreuses structures associatives dont le point commun était de s’intéresser à ce qui concernait la vulnérabilité sous ses différents aspects. Historiquement, les associations sont très présentes à chacun de nos congrès car elles savent que c’est un excellent vecteur de communication vis-à-vis de nos confrères. Elles savent également que le poids médiatique du congrès est de nature à favoriser la promotion d’idées ou de propositions qu’elles défendent. Autour de notre thème, elles se sont fédérées. Avec le recul, il semble que cette action commune a, par exemple, contribué à faire disparaître les blocages inexplicables qui empêchaient depuis de nombreuses années la réforme attendue du droit des majeurs protégés. Ajoutée à la volonté présidentielle de voir aboutir cette réforme avant la fin de son mandat, la conjoncture favorable a aligné les planètes, permettant ainsi au notariat d’apporter sa contribution.
5 - Soutien politique. – Le Premier ministre de l’époque, Dominique de Villepin, avait annoncé sa venue pour la séance de clôture du Congrès de Strasbourg et son déplacement fut préparé en détail avec ses services. Malheureusement, au dernier moment, un contretemps le contraindra à annuler et c’est monsieur Philippe Bas, ministre de la Famille, qui le remplaça. Lors de la séance d’ouverture du congrès, il fit également lire par monsieur Pascal Clément, alors garde des Sceaux, ministre de la Justice, un message dans lequel il annonçait officiellement qu’il lui avait demandé d’achever, en lien avec le ministre de la Famille, la préparation d’une réforme qu’il qualifia de majeure face aux insuffisances et aux carences du dispositif actuel de protection juridique des majeurs. Les notaires furent heureux d’entendre que « cette réforme répond à une attente pressante de la part des intéressés et de leur famille ainsi que des intervenants tutélaires. Vous vous en faîtes l’écho aujourd’hui, c’est bien le signe d’une profession attentive à la situation des plus fragiles d’entre nous et soucieuse de participer pleinement à l’amélioration des dispositions légales, sociales et économiques applicables à ces matières ». La promesse fut respectée et elle aboutit à la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.
Remarque
Comme cela a été indiqué plus haut, le champ de la vulnérabilité est vaste et monsieur Bas, ministre de la Famille, le rappela parfaitement dans son intervention, en insistant par exemple sur la question de l’articulation entre la solidarité familiale et les solidarités collectives. Cela constituait d’ailleurs un axe essentiel du rapport.
Fin remarque
6 - L’intervention de notre rapporteur général, Philippe Potentier, lors de la séance d’ouverture du Congrès est sans aucun doute l’outil le plus précieux afin de présenter le fruit des 2 années de travail de toute l’équipe qu’il a animée. Extrayons en quelques éléments essentiels.
« Les personnes vulnérables implorent le secours. De qui ? De la sociététoutentière devant exprimer ses devoirs mais aussi de nous tous pris individuellement ou familialement ». On voit ainsi apparaître les deux acteurs principaux : la famille d’un côté, l’État ou ses collectivités de l’autre et cela se retrouvera tout au long du rapport.
« Le droit des personnes vulnérables se nourrit à deux sources essentielles du droit : la loi dans son acception large, la volonté dans toute sa dimension. Il en appelle nécessairement une troisième car il faut de temps à autre un arbitre, un sage qui tranche les conflits et apaise les situations, le juge. »C’est un second aspect des réflexions menées avec la place de chacune de ces sources plus ou moins importantes selon les questions soulevées.
« Principe de nécessité et principe de subsidiarité s’alternent, se conjuguent, s’additionnent et jamais ne s’opposent parce que l’un vit de l’autre ».
7 - Thèmes des commissions. – Les deux premières commissions cherchèrent à traduire le principe de nécessité. Face à la vulnérabilité sous ses diverses formes, la réponse est en premier lieu publique et elle est graduée.
• L’aide à la personne : une personne vulnérable doit être aidée. La première commission4 se livra à une analyse détaillée de tout le champ de l’aide et de l’action sociales qui vise à accompagner la personne en difficulté.
• La protection de la personne : une personne vulnérable doit être également protégée si l’expression de sa volonté est altérée. La deuxième commission5 examina toute la gamme des mesures de protection.
Les troisième et quatrième commission déclinèrent le principe de subsidiarité en décrivant le champ contractuel de la volonté.
• Les figures libres d’assistance : la volonté désigne des figures libres d’assistance que la troisième commission6 développa autour du mandat avant d’explorer d’autres chemins, invitant à la contractualisation des rapports familiaux.
• Les alternatives patrimoniales : c’est ce qu’étudia la quatrième commission7 en prolongeant la réflexion dans le patrimoine, y trouvant des alternatives à la constitution, la gestion, la transmission d’un patrimoine au profit d’une personne vulnérable.
8 - Choix des propositions présentées. – Une fois le rapport rédigé, une phase importante de la préparation d’un congrès se présente, celle où l’on doit décider des propositions qui seront présentées et soumises à discussion et vote lors du congrès. Chaque commission arrive avec ses idées et elles foisonnent ! Il faut alors opérer des choix que certains jugeront parfois douloureux. Il n’est pas possible de faire autrement car chacun sait que le nombre de propositions est limité par les contraintes matérielles liées aux modalités de déroulement des débats. Sans reprendre en détail toutes les phases de la préparation du congrès, il est remarquable de constater que la machine est bien rodée et que, chaque année, le résultat fait honneur au notariat. Cela permet d’arriver au moment fort, le déroulement du congrès. Les débats autour des propositions seront riches avec des échanges fructueux entre l’Université, les professionnels concernés et les notaires. Strasbourg n’échappa à la règle.
9 - Plus de 18 ans après, il semblait intéressant de voir quel a été le sort des propositions faites. Un peu comme lors de la préparation du congrès, on aurait envie de les présenter toutes car chacune avait sa pertinence et son intérêt. Les impératifs liés à la taille de cette contribution ont imposé de faire des choix et de s’arrêter à certaines d’entre elles seulement. Le critère de sélection a été de revenir sur les propositions ayant eu une suite favorables (1) et d’insister sur certaines qui n’ont pas été suivies d’effet, mais le devraient (2).
1. Quelques propositions ayant eu une suite favorable
10 - Le long délai écoulé depuis 2006 est intéressant car il permet de faire apparaître qu’il y a d’un côté les propositions rapidement suivies d’effet (1) et, de l’autre, une dont la concrétisation s’est produite beaucoup plus tard (2).
A. -Illustration de propositions rapidement suivies d’effet
1° La réforme du droit des majeurs protégés
11 - Une annonce pendant le Congrès. – En débutant par cette proposition, il y a un aspect symbolique. En effet, lorsque l’on a réfléchi à ce qui ferait l’objet de débats, nous ignorions totalement que cette réforme tant espérée et attendue allait faire l’objet d’une annonce de lancement lors du congrès. Le hasard du calendrier nous a été particulièrement favorable. Ainsi que le rappelaient les considérants de la proposition, l’environnement législatif international invitait à une évolution du droit des personnes protégées. La doctrine, ainsi que de multiples rapports rendus en la matière depuis 15 ans, exprimaient des avis convergents. Enfin, l’ensemble des associations et des acteurs concernés réitéraient régulièrement les mêmes demandes. Et pourtant rien ne bougea jusqu’au congrès.
Cette heureuse conjonction s’est manifestée durant le congrès et la proposition visant à ce qu’un projet de loi portant réforme du droit des majeurs protégés soit déposé devant le Parlement dans les plus brefs délais fut adoptée à l’unanimité. Cela fut exaucé et le résultat fut le vote de la loi du 5 mars 2007 rappelée en introduction.
2° Statut personnel de la personne protégée
12 - Une autre proposition mérite d’être rappelée, c’est celle proposant que soit institué un véritable statut de la personne protégée, distinct de celui des biens composant son patrimoine et ajoutant également que la loi établisse, pour toutes les décisions relatives à la personne, une présomption de capacité, à l’inverse du statut patrimonial qui définissait une présomption d’incapacité. Enfin, elle suggérait que le juge puisse toutefois nuancer cette capacité personnelle. Les rapporteurs de la deuxième commission avaient placé cette proposition en tête car elle leur semblait d’un intérêt majeur en cas d’aboutissement d’une réforme du droit des personnes protégées. Ils ne faisaient en cela que suivre les préconisations de la doctrine et de tous les acteurs concernés mais ils souhaitaient qu’il y ait une mise en valeur particulière lors du congrès. La loi du 5 mars 2007 a totalement bouleversé l’architecture des textes régissant les majeurs protégés et a consacré ce statut avec l’introduction dans le Code civil d’une série d’articles relatifs aux effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne8 avant de développer ce qui concernait le patrimoine.
3° Une capacité élargie du majeur en tutelle
13 - Un constat avait été fait à propos du majeur en tutelle qui était contraint par des restrictions de fond quant à sa capacité de disposer à titre gratuit. Ainsi, à l’époque, il ne pouvait en principe donner ou recevoir ni tester selon les dispositions de l’article 902 du Code civil. Avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, il pouvait consentir des donations en avancement d’hoirie seulement au profit de ses descendants ou de son conjoint. Le testament établi après l’ouverture de la tutelle était nul de plein droit. Par ailleurs, toujours en lien avec le hasard du calendrier, le projet de loi portant réforme des successions et des libéralités était en cours d’adoption. Il prévoyait un léger assouplissement en étendant les bénéficiaires possibles d’une donation aux collatéraux privilégiés. De plus, il avait été introduit, par un amendement soutenu par M. S. Huygue, député rapporteur de la commission, une autre amélioration : le testament fait par le majeur en tutelle restait nul de plein droit à moins qu’il n’ait été préalablement autorisé par le conseil de famille. Lors des débats durant le congrès, M. Huyghe intervint pour préciser que c’est avec beaucoup de précaution que les députés s’étaient attaqués à cette question sachant qu’un texte se profilait sur les majeurs protégés et que la réflexion n’était pas suffisamment aboutie.
14 - Mettre fin à la défiance traditionnelle du droit vis-à-vis des actes à titre gratuit consentis par des majeurs vulnérables. – Nous souhaitions aller plus loin en estimant que la défiance traditionnelle de notre droit vis-à-vis des actes à titre gratuit n’était plus de mise et que le schéma d’une cellule familiale composée d’un enfant commun et d’un époux n’était plus révélateur de la diversité des situations désormais rencontrées.
Il fut donc proposé que soient supprimées les limitations à la faculté de consentir une donation au nom d’un majeur en tutelle et que l’autorisation à recueillir relève de la compétence exclusive du juge des tutelles. À notre grand étonnement, les débats autour de cette proposition furent vifs et il apparut notamment des oppositions fortes de la part de certains confrères. Le dernier intervenant fut le professeur Philippe Malaurie qui, à la différence de notre rapporteur général qui venait de faire part de sa confiance en la sagesse du juge avant d’autoriser une donation, indiqua qu’il ne faisait confiance à personne ! La proposition fut en définitive adoptée à une large majorité.
15 - Admission de la possibilité, pour le majeur sous tutelle, de faire des donations. – Comme cela avait été annoncé, la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités confirma les deux assouplissements rappelés plus haut à propos des testaments possibles sous réserve d’autorisation du juge des tutelles et des libéralités susceptibles de bénéficier désormais également aux collatéraux privilégiés. La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs alla plus loin avec le nouvel article 507 du Code civil. Désormais, le majeur en tutelle peut, avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il est constitué, être assisté ou au besoin représenté par le tuteur pour faire des donations.
4° Une mise en œuvre contrôlée du mandat de protection future
16 - La troisième commission consacrée aux figures libres d’assistance avait choisi d’apporter un éclairage particulier sur le mandat de protection future encore dans les limbes des éventuels projets de réforme du droit des majeurs protégés. Se basant sur un avant-projet de loi alors connu, il fut décidé de présenter deux propositions, la première ici rappelée relative au souhait d’une mise en œuvre contrôlée du mandat de protection future, la seconde, commentée plus loin, consacrée à une nécessaire publicité du mandat de protection future.
17 - À propos de la mise en œuvre contrôlée du mandat de protection future, la proposition a émis notamment le souhait, à défaut d’une procédure d’homologation qui pourrait être diligentée devant le juge des tutelles, que la loi organise la désignation par le mandant d’une ou plusieurs personnes de confiance à qui serait notifiée, en même temps qu’au mandant, la prise d’effet du mandat. Il fut également abordé dans la proposition la possibilité d’une faculté de contestation limitée aux éventuelles difficultés de mise en œuvre du mandat.
18 - Une absence de prévision légale de la possibilité de prévoir un personne de confiance… – Le mandat de protection future a été créé par la loi du 5 mars 2007. On y trouve notamment la faculté pour tout intéressé de saisir le juge des tutelles aux fins de contester la mise en œuvre du mandat ou de voir statuer sur les conditions et modalités de son exécution (C. civ., art. 484).
En revanche, le législateur n’a pas retenu notre suggestion de prévoir la désignation par le mandant d’une ou plusieurs personnes de confiance. Il n’a toutefois pas écarté cette faculté car le cadre juridique du mandat de protection future est relativement souple et laisse une large place à la liberté contractuelle. Cela fut souligné par la doctrine9.
19 - … palliée par la créativité notariale et les formules dédiées. – Dès lors, on a assisté à un exemple parfait de l’esprit créatif des notaires car, dès les premiers modèles de formules qui ont été élaborés10, il a été conseillé de désigner une ou plusieurs personnes de confiance et de leur confier une mission de surveillance, depuis la mise en œuvre du mandat jusqu’à son exécution.
Remarque
Aujourd’hui, la plupart des formules proposées ont intégré cette faculté et l’expérience pratique vécue par les notaires démontre qu’elle est très fréquemment utilisée. Elle est même considérée par la plupart des mandants comme un élément essentiel de nature à les rassurer sur l’efficacité de la mise en œuvre du mandat et le respect de leur volonté. C’est un bon exemple de la créativité notariale11 qui apporte sa contribution à une amélioration constante du droit.
Fin remarque
B. - Une concrétisation tardive
20 -La publicité du mandat de protection future. – Tout vient à point pour qui sait attendre ! En effet, le parcours suivi par cette question de l’intérêt de la publicité du mandat de protection future a été largement semé d’embûches, les services de la Chancellerie ayant, pour des motifs difficilement compréhensibles, été plus que rétifs à sa mise en œuvre.
Il ne sera pas développé ici en détail son histoire, la récente publication du décret du 17 novembre 202412 relatif au registre des mandats de protection future ayant enfin apporté une réponse. Il est renvoyé à un commentaire13 détaillé, publié Pa dans cette revue, présentant ce parcours chaotique.
Attention
Au moment de rédiger cette contribution, nous sommes encore dans l’attente d’un arrêté indispensable pour que la mise en œuvre de la publicité du mandat de protection future soit effectivement réalisable. On n’a plus à s’étonner de rien et on n’est plus à un retard près ! Pourtant, lorsqu’un texte devient applicable immédiatement, la moindre des choses serait qu’il y ait une bonne coordination afin que soient publiés en même temps le décret et l’arrêté indispensable.
Fin attention
21 -Vision prospective du Congrès. – En revanche, sans en tirer de fierté particulière, on peut saluer la vision prospective développée par les rapporteurs de la troisième commission du congrès. Ils ont, alors qu’aucun texte n’était encore annoncé et que le mandat de protection future n’avait pas été instauré, tenu à insister sur un élément majeur afin de le rendre efficace, celui de sa publicité. Il s’est ainsi écoulé plus de 18 ans entre le vote de cette proposition et sa mise en application avec son récent décret ! Il s’agira certainement d’un record difficile à battre… Retenons que les praticiens ressentent intuitivement les besoins de nos concitoyens mais qu’ils ont parfois du mal à faire le passer leur message. Ajoutons que ce qui compte dans une proposition, ce n’est pas le détail de son contenu mais la voie à explorer qui est ouverte. C’était d’autant plus évident ici que l’on faisait de la pure prospective à propos d’un outil n’existant pas encore dans notre arsenal juridique.
2. Quelques propositions non suivies d’effet
22 - Il va être présenté trois propositions importantes qui n’ont pas obtenu de suites positives. Elles ne sont pas les seules et il aurait été possible d’en ajouter d’autres, par exemple :
• celle relative à la difficulté liée à la responsabilité des associés dans une société civile qui pose problème en présence de mineurs et de majeurs protégés, avec le souhait de la limiter ;
• ou encore celle relative à une reconnaissance des contrats à titre onéreux contenant des prestations viagères intéressant des successibles avec le souhait de voir supprimé purement et simplement l’article 918 du Code civil ;
• ou enfin, celle relative à une demande de clarification de l’article 917 du Code civil.
A. - Libéralités graduelles et résiduelles
23 - Deux propositions de la quatrième commission s’intéressèrent aux libéralités résiduelles et graduelles, l’une souhaitant une reconnaissance générale et adaptée des libéralités graduelles et l’autre en faveur d’une pratique plus souple des libéralités résiduelles. Là encore, il faut rappeler que lors de leur élaboration, la réforme des successions et libéralités n’était pas engagée. En revanche, nous étions tous très imprégnés par l’Offre de loi de l’exceptionnel quatuor composé de Jean Carbonnier, Pierre Catala, Jean de Saint Affrique et Georges Morin14.
24 - Il ne sera pas réalisé de développements à leur propos car elles sont l’objet d’une contribution spéciale publiée dans le même numéro de cette revue et consacrée à leur intérêt particulier pour les personnes vulnérables15. Reprenons simplement ici afin de rester dans l’objectif de cet article ce qui y figure quant à l’absence de prise en compte de notre proposition : « c’était pour nous l’occasion de tenter de faire bouger le législateur sur les points qui nous semblaient encore devoir être améliorées pour les libéralités substitutives, en soutenant certains éléments pratiques de l’Offre de loi que le législateur ne semblait pas vouloir intégrer. Nos deux propositions furent largement adoptées mais n’ont pas abouti à convaincre le législateur et plus particulièrement le Sénat resté frileux »16. « Avec le recul, on ne peut que le regretter car les freins au développement des libéralités résiduelles et graduelles, constatés depuis et critiqués par une large part de la doctrine, ont confirmé que les auteurs de l’Offre de Loi avaient raison ».
B. - Une simplification, une clarification et une modulation de la récupération de l’aide sociale
25 - Ce n’était pas la première fois que les notaires avaient relevé que le dispositif de récupération de l’aide sociale, notion prise au sens large et intégrant à la fois les prestations de compléments de retraite versées au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et celles au titre de l’aide sociale proprement dite, se caractérisait par le fait qu’il était devenu un maquis complexe. Le 93e Congrès des notaires de France, Marseille 1999, sur le thème « Demain la famille », sous la présidence de Xavier Ginon, et dont j’avais eu l’honneur d’être le rapporteur général, y avait consacré de longs développements17 et fait des propositions. Il fut décidé de reprendre l’étude de cette matière délicate dans le congrès consacré aux personnes vulnérables car elles sont plus que d’autres concernées, nombre d’entre elles percevant des prestations de diverses origines. Un tableau récapitulatif de toutes les aides versées susceptibles de donner lieu à recours ou récupération fut établi en distinguant les aides aux personnes handicapées et celles aux personnes âgées démontrant de manière très pratique la réalité du maquis dénoncé18.
26 - Un droit complexe et confus. – Des considérants de la proposition faite, retenons que le droit de la récupération de l’aide sociale est devenu un droit complexe et confus, à la fois dans son principe et ses multiples exceptions ainsi que dans ses modalités d’exercice. Les différents recours envisagés à la fois contre le donataire, la succession et le légataire sont sources de difficultés et d’incompréhension. Le dispositif de la récupération manque actuellement de clarté et lisibilité. La proposition votée à l’unanimité souhaitait que le recours en récupération de l’aide sociale soir réexaminé dans son ensemble avec un triple objectif : simplifier le mécanisme, le clarifier et enfin le moduler.
27 - Des problèmes persistants. – Plus de 18 ans après, le bilan est plus que maigre et on peut clairement parler d’échec par rapport à ce que nous attendions. Si on essaie de rester positif, il convient toutefois de saluer le fait que l’administration fiscale a fini par prendre position en 201519 afin de définir les conditions de prise en compte des créances d’aide sociale dans le calcul des droits de succession. La solution retenue est loin d’être parfaite mais elle a le mérite d’exister. On relèvera également l’augmentation du seuil de récupération au titre de l’ASPA passé à 100 000 € en 202320 mais en regrettant que l’on n’ait pas traité parallèlement les autres seuils existant pour l’aide sociale proprement dite, perpétuant ainsi la complexité de la matière. En revanche, comment ne pas dénoncer une nouvelle incohérence ajoutée par la récente loi Bien-vieillir et autonomie du 8 avril 2024 ainsi que cela a été relevé récemment21 ? Au total, les reproches adressés en 2006 aux règles en vigueur, pour l’essentiel, n’ont pas été entendus.
C. - Pour des modalités particulières de formation d’un contrat soumis à autorisation
28 - Invalidité de la condition suspensive de l’accord de juge des tutelles pour signer la promesse de vente de l’immeuble d’une personne protégée. – Au-delà de ce titre susceptible d’interroger, la président de la deuxième commission précisa qu’il allait être question de l’un des actes les plus quotidiens de la pratique notariale, la vente de l’immeuble de la personne protégée. Un tel acte grave nécessite pour un majeur en tutelle l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles. Or, l’acte de vente est presque toujours précédé d’un avant-contrat. Il y a une difficulté pratique évidente en raison du délai entre la saisine du juge et sa réponse qui est incompatible avec la rapidité nécessaire à la conclusion de l’avant-contrat. Pendant de longues années, nombreux ont été ceux qui ont cru pouvoir contourner ce problème en ayant recours à la pratique de la condition suspensive de l’accord du juge des tutelles. Or, une telle solution est plus que contestable et doit être totalement écartée car on ne peut ériger en condition suspensive un élément essentiel au contrat, telle la volonté même de l’une des parties, le vendeur étant dans l’incapacité d’exprimer sa volonté en l’occurrence. La doctrine et la jurisprudence sont formelles sur ce point et on peut rappeler la belle formule du professeur Philippe Malaurie : « ce qui est essentiel ne saurait être une modalité ». La Cour de cassation a eu l’occasion de condamner cette pratique dans une promesse unilatérale de vente ou dans une promesse synallagmatique. Il a été rappelé les conséquences dévastatrices de la nullité de l’avant-contrat.
29 - Proposition d’une formation du contrat en plusieurs étapes… pour l’heure non consacrée par le législateur. – Il fut alors décidé de proposer une voie nouvelle avec une solution souple, simple et originale. Il s’agirait d’admettre qu’un contrat puisse se former en plusieurs étapes, engageant progressivement des volontés qui s’y agrègent, parfois avec un délai nécessaire, et que le pouvoir créateur de la volonté suffira à former ce contrat. Compte tenu de la figure juridique singulière qu’il ferait naître, la loi devrait en dessiner de façon claire et définitive les traits caractéristiques et fondamentaux.
Les débats autour de cette question furent animés et Philippe Potentier, rapporteur général, intervint avant le vote pour rappeler que la proposition démontrait à l’évidence qu’il fallait trouver une solution car les notaires sont confrontés à la fois à une réalité pratique et une réalité juridique.
La proposition fut adoptée à une très large majorité. Malheureusement, à ce jour rien n’a changé ! Simplement, peu à peu, au regard de la jurisprudence constante de la Cour de cassation et d’une meilleure appréhension de la difficulté par les notaires et les juges, la pratique de la condition suspensive de l’accord du juge des tutelles a presque totalement disparu. Et aucune solution parfaite et sûre n’a été trouvée. C’est réellement dommage.
30 - En guise de conclusion, le mieux est de se reporter à ce moment majeur de la fin du congrès qu’est la présentation toujours brillante du rapport de synthèse. Nous eûmes le privilège d’avoir à nos côtés le doyen Bernard Beignier. Toute l’équipe lui conserve une immense reconnaissance.
Au début de son intervention, il présenta deux lignes maîtresses de nos travaux : la première, pour reprendre la phrase de Portalis dans le discours préliminaire du Code civil, est que « les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois ». La deuxième ligne d’horizon est que, pour protéger, il faut faire appel aux deux structures fondatrices de notre civilisation : la famille et la Nation, la petite et la grande famille. Cela signifie qu’il faut savoir ce qui incombe à l’une et ce qui échoit à l’autre pour que, de cette subsidiarité, jaillisse une féconde complémentarité. Et il termina notamment par ce beau compliment à l’égard de la fonction de notaire : « être capable d’extraire de ce droit brouillon cette eau vive de la justice, être capable de simplifier toutes les complexités de la vie, être apte à dire le droit, le bon droit, voici ce à quoi nous sommes tous invités, mais voilà surtout l’une des plus belles justifications de la profession de notaire : soulager celui qui ploie sous le fardeauet, ce qui est peut-être plus exemplaire, aider ceux qui veulent aider l’humanité à mériter chaque jour un peu mieux son nom…Ne nous plaignons pas du droit, donnons-lui la vie ». ▪
L'essentiel à retenir
- Entre les propositions votées durant un congrès et leur prise en compte par le législateur, il peut parfois s’écouler du temps. L’essentiel est de finir par être entendu.
- On est souvent déçus de voir que des propositions d’un intérêt pratique indiscutable ne retiennent pas l’attention de ce même législateur. L’essentiel est de ne pas se décourager et de continuer à les défendre avec énergie. Un congrès ultérieur peut parfois être l’occasion de remettre sous une forme différente la question sur le tapis.
- L’utilité de nos congrès est, à travers ces quelques exemples, plus que jamais confortée !
Mots-clés : Personnes vulnérables - Handicap
Notes
- Citons notamment quelques textes majeurs : L. n° 99-944, 15 nov. 1999, relative au pacte civil de solidarité. - L. n° 2001-1135, 3 déc. 2001, relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral. - L. n° 2002-304, 4 mars 2002, relative au nom de famille. - L. n° 2003-516, 18 juin 2003, relative à la dévolution du nom de famille. - L. n° 2002-305, relative à l’autorité parentale. - L. n° 2004-439, 26 mai 2004, relative au divorce. - L. n° 2004-800, 6 août 2004, relative à la bioéthique. - L. n° 2005-370, 22 avr. 2005, relative aux droits des malades et à la fin de vie. - Ord. n° 2005-759, 4 juill. 2005, portant réforme de la réforme de la filiation. - L. n° 2006-728, 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités. ↩
- L. n° 2007-308, 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs. ↩
- Président J.-E. Garonnaire et rapporteur F. Picot. ↩
- Président J. Klein et rapporteur F. Gemignani. ↩
- Présidente N. Couzigou-Suhas et rapporteur Y. Lelevier. ↩
- Président G. Crémont et rapporteurs F. Loustalet et H. Lenouvel. ↩
- C. civ., livre premier, titre XI, De la majorité et des majeurs protégés par la loi, section IV, De la curatelle et de la tutelle, sous-section 4, Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne, art. 457-1 à 463. ↩
- V. not. J. Klein, Le mandat de protection future ou la protection juridique conventionnelle : Dr. famille 2007, étude 21. - J. Casey et J. Combret, Le mandat de protection future : RJPF juill.-août 2007, n° 7/8 ; RJPF sept. 2007, n° 9. ↩
- V. not. J. Combret, Ph. Potentier, F. Gemignani, H. Lenouvel et Y. Le Levier, Mandat de protection future, formule commentée : Defrénois 2009, art. 38891. - JCl. Notarial formulaire, V° Mandat de protection future, fasc. 55, Mandat de protection future, formules, par E. Mallet et J. Combret. ↩
- S. Torricelli-Chrifi, La pratique notariale, source de droit : Defrénois 2015, coll. Doctorat et notariat, (dir.) B. Beignier, F. Letellier, J. Mestre et A. Tani, Créativité notariale et Doctorat en droit : éd. LexisNexis. ↩
- D. n° 2024-1032, 16 nov. 2024, relatif au registre des mandats de protection future. ↩
- N. Baillon-Wirtz et J. Combret, Le registre des mandats de protection future ? : JCP N 2024, n° 51-52, 1258. ↩
- J. Carbonnier, P. Catala, J. de Saint-Affrique et G. Morin, Des libéralités, Une offre de loi : éd. Defrénois. ↩
- J. Combret, Libéralités graduelles et résiduelles, des solutions à ne pas oublier pour les personnes vulnérables : JCP N 2025, n° 1037, 20005. ↩
- V. par ex. H. de Richemont, Rapport de la Commission des lois du Sénat 2006, 1re lecture, n° 343, t. 1, p. 204. ↩
- 93e Congrès des notaires de France, Marseille 1999, Demain la famille, J.-P. Gatel et D. Froger, rapport 2e commission, Demain la famille, solidarités et responsabilités, n° 2249 à 2357. ↩
- 102e Congrès des notaires de France, Strasbourg 2006, Les personnes vulnérables, J.-E. Garonnaire et F. Picot, rapport 1re commission, L’aide à la personne, p. 234 à 238. ↩
- BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, 14 déc. 2015, § 160 à 190. - Pour des développements sur cette question, V. not., JCl. Notarial formulaire, V° Aides sociales, fasc. 12, Aides sociales, Révisions, Recours, par J. Combret. ↩
- L. n° 2023-270, 14 avr. 2023, art. 18, de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. ↩
- L. n° 2024-317, 8 avr. 2024, portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie. - N. Baillon-Wirtz et J. Combret, Bien-vieillir et autonomie, les modestes apports de la loi du 8 avril 2024 : JCP N 2024, n° 16, act. 556. ↩
LES ARTICLES
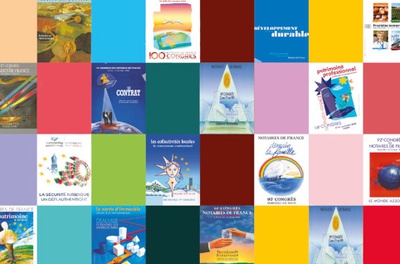
Introduction générale - Le notaire et la loi : « Et voudriez-vous… »
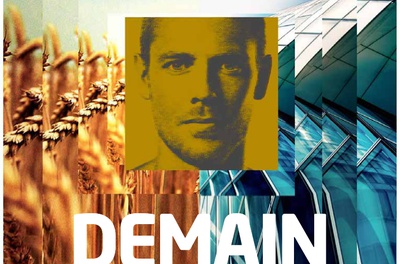
Introduction générale sur la famille
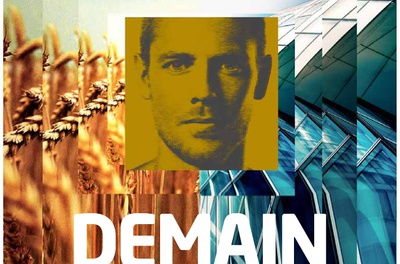
La contribution du notariat à l’amélioration du PACS
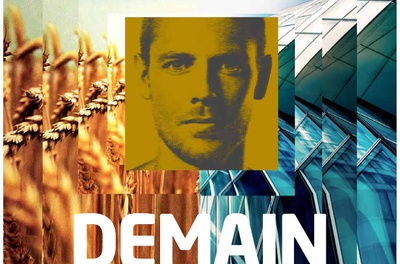
Les personnes vulnérables : quelles suites pour les propositions adoptées ?
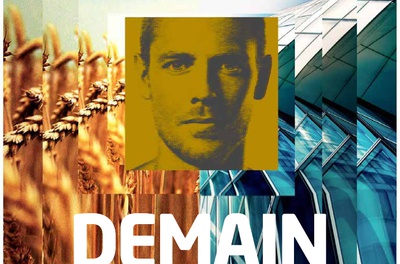
Libéralités graduelles et résiduelles : des solutions à ne pas oublier pour les personnes vulnérables
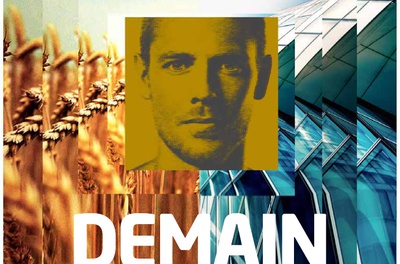
La renonciation à l'action en réduction des articles 929 et suivants du Code civil
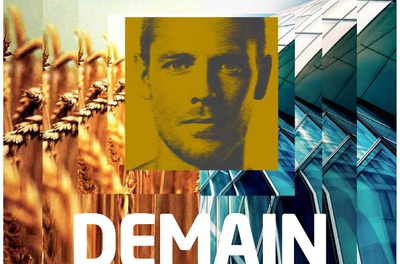
La vocation successorale égalitaire de tous les enfants
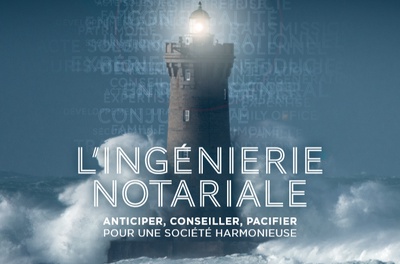
Introduction générale sur l’immobilier
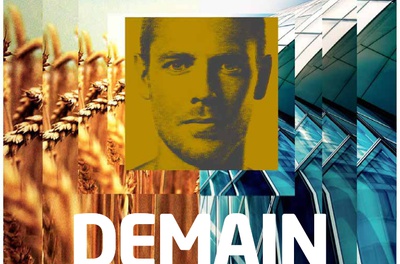
La vente d'immeuble à rénover : la suite de trois Congrès…
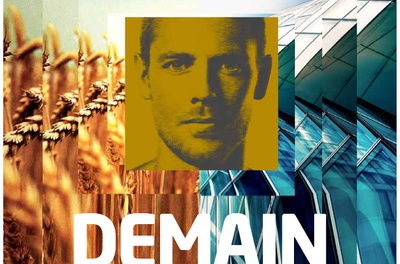
La vente en l’état futur d’achèvement : l’héritage des notaires bâtisseurs
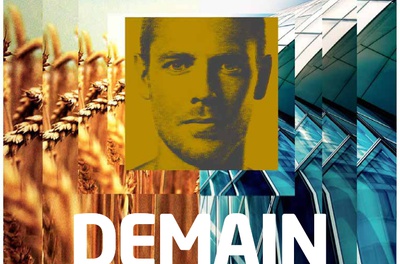
La division en volumes : l’inventivité notariale au service d’une nouvelle utilisation de l’espace
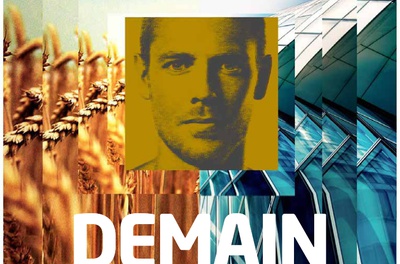
La reconnaissance par le droit de l’urbanisme du mécanisme de la prescription extinctive (C. urb., L. 421-9)
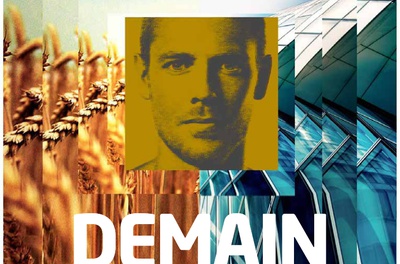
Le transfert par subrogation des accessoires garantis par l’inscription d’origine
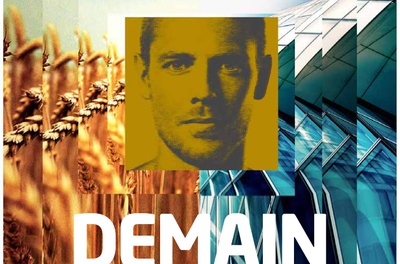
Introduction générale sur le droit public
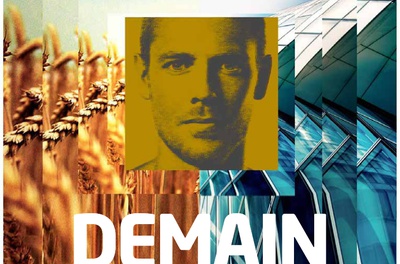
L'extension du déclassement par anticipation
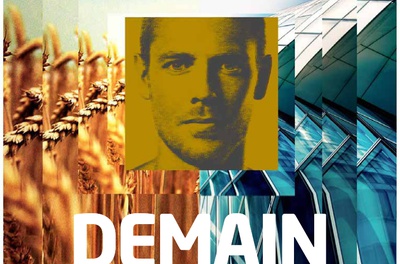
La sécurisation des droits du commerçant exploitant sur le domaine public
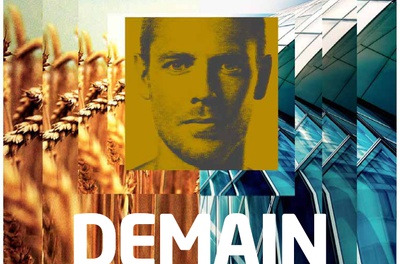
La sanction des clauses non conformes par le réputé non-écrit
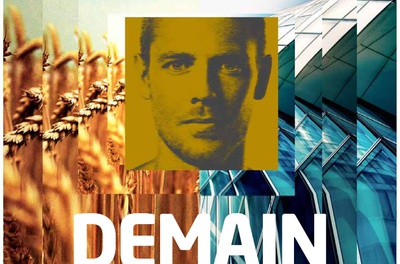
Entretien avec Jean-François Pillebout