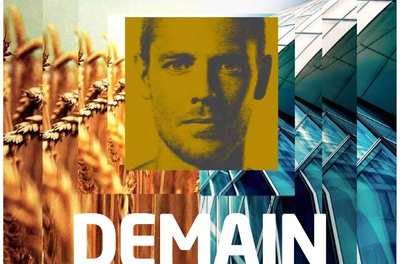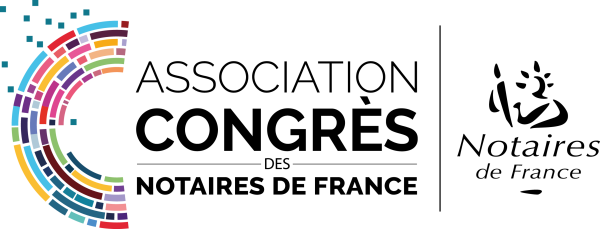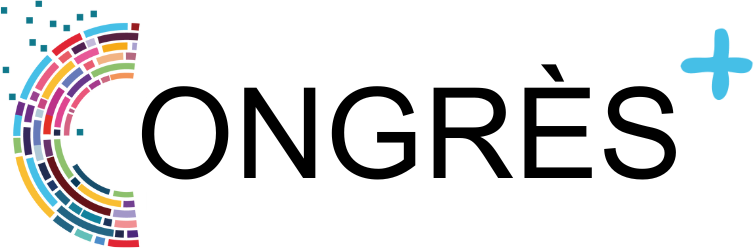Introduction générale - Le notaire et la loi : « Et voudriez-vous… »
Les apports des Congrès des notaires de France au droit
Plus de 200 textes législatifs et près de 130 règlementaires
inspirés des Congrès des notaires de France
La vente en l’état futur d’achèvement : l’héritage des notaires bâtisseurs
63e Congrès des notaires de France, Clermont-Ferrand 1965
1 - Conseiller des particuliers comme des différents opérateurs économiques, attentif par fonction à leurs besoins ainsi qu’aux nécessités pratiques, le notaire a toujours été un agent important de modernisation de la loi. Son large domaine de compétence lui permet de faire régulièrement des propositions avant-gardistes dans des secteurs aussi variés que le droit des personnes et de la famille, le droit des affaires et le droit de l’immobilier, dont il est un acteur de premier plan.
Pour se convaincre de l’importance de ce rôle, il suffit d’observer le nombre conséquent de vœux exprimés lors du Congrès annuel des notaires de France qui ont été consacrés par la loi. En se cantonnant à la matière immobilière, l’on songe immédiatement à la vente en l’état futur d’achèvement, devenu contrat nommé par la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire et à l'obligation de garantie à raison des vices de construction, à la suite d’un appel en ce sens du 63e Congrès des notaires1.
2 - En cette matière, peut-être plus qu’en tout autre, il apparaît nécessaire de conserver et renforcer cet échange fécond entre notariat et pouvoir législatif. La crise actuelle de l’immobilier plaide en ce sens. Il serait en effet illusoire de penser que nos sociétés modernes puissent prospérer sans un marché immobilier sain, lequel ne peut exister sans un droit parfaitement adapté aux réalités du terrain.
À ce titre, le rôle créateur et l’influence de certains illustres prédécesseurs doivent être salués. À l’origine de pratiques nouvelles destinées à répondre aux difficultés auxquelles le notaire est confronté, le fruit de leur inventivité, parfois révolutionnaire, a ensuite fait l’objet d’une consécration légale avant de s’épanouir en des formules devenues coutumières.
3 - Parmi ces grands noms figure en premier lieu celui de Claude Thibierge. Considéré à juste titre comme l’une des plus grandes figures du notariat du XXe siècle, ayant activement participé aux réformes législatives d’après-guerre, son nom est aujourd’hui indissociable de bon nombre d’instruments de la pratique notariale quotidienne. La division en volume et la vente en état futur d'achèvement en sont deux exemples parmi les plus saillants.
4 - Les lignes qui suivent sont destinées à mettre en exergue la créativité notariale et la recherche permanente du juste équilibre dont elle procède. Il y a, en effet, dans le mécanisme contractuel de la vente d’immeuble à construire une splendide illustration de l’art notarial de la mesure. Car, loin de ne poursuivre que l’intérêt économique des forces à l’œuvre, ce contrat permet à la fois de favoriser la construction d’immeubles collectifs (1) et de garantir la parfaite sécurité juridique des acquéreurs (2).
Un instrument favorisant les projets immobiliers d’ampleurs
5.- L’essor de la construction. – La seconde moitié du XXe siècle a été marquée par l’essor considérable de la construction immobilière, poussée par un souhait grandissant des Français d’accéder à la propriété. Cette aspiration à la propriété individuelle, résultat d’une amélioration générale du niveau de vie, a accompagné le phénomène de migration des populations rurales vers les villes, accentuant et entretenant par-là la nécessité de bâtir au sortir du second conflit mondial.
6 - Le financement de la construction. – L’un des obstacles immédiats à ces importantes opérations de construction tenait toutefois à leur financement. Il était en effet à craindre que l’ampleur de ces projets n’entraîne un accroissement du coût de la construction qui eût été dissuasif s’il avait dû être répercuté sans modulation sur l’accédant à la propriété.
La vente d’immeuble à construire fut alors pensée comme un moyen de faire participer l’acquéreur au financement du bien qu’il entend acquérir, permettant ainsi de déplacer le poids économique de l’opération.
Cela explique que, sans attendre sa consécration par la loi du 3 janvier 1967, la pratique se soit progressivement emparée de l’instrument. Il ne s’agissait en réalité que de concevoir une forme particulière de vente, celle d’une chose future, dont la licéité était alors largement confortée par l’ancien article 1130 du Code civil, qui prévoyait que la chose future peut être objet d’obligation2. Nul ne douta ainsi de la possibilité de recourir à cet instrument et jamais la loi n’y fit obstacle.
Mais il restait à dresser les contours et le régime d’une telle opération, qui n’avait alors d’autre support légal que l’ancien article 1130 du Code civil.
Remarque
Au départ, la pratique notariale eut recours à des cessions de quotes-parts indivises portant sur des assiettes foncières, à l’occasion desquelles les acquéreurs prenaient l’engagement de participer à la construction de l’immeuble collectif3. Le vendeur se voyait alors consentir concomitamment par l’acquéreur un mandat lui permettant de recourir aux services des différents loueurs d’ouvrage, sans qu’il fût alors investi de la qualité de maître d’ouvrage.
Fin remarque
7 - Ventes de choses futures : fragilité de la technique sociétaire. – Vinrent ensuite les véritables ventes de choses futures, avec en premier lieu le modèle de la vente sur plan. Mais à défaut de support légal, et compte tenu de l’inadaptation d’une grande partie du régime de la vente de droit commun (on songe notamment au régime ordinaire des vices cachés4), l’instrument était alors fortement concurrencé par diverses opérations sociétaires.
Les sociétés de construction, régies, à l’époque, par la loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartements, offraient aux promoteurs un modèle mieux connu, qui leur inspirait une plus grande confiance. Elles étaient ainsi constituées par les promoteurs, dans le but de laisser ensuite la personne morale réaliser l’opération de construire dans tout ce qu’elle implique : obtention de l’assiette foncière, du permis de construire, souscription des divers contrats auprès des loueurs d’ouvrages, etc. Ce système permettait en même temps de faire participer les accédants à la propriété au financement : soit directement par voie de souscription de parts sociales, soit indirectement par le rachat de celles des associés initiaux. L’intérêt de cette opération, du point de vue des associés, résidait alors dans la vocation à l’attribution de lots (voire d’immeubles) conférée par les parts sociales, une fois la construction finie, principalement par voie de retrait.
Mais l’obtention de la qualité d’associé s’accompagnait des obligations et contraintes qui lui sont liées. Par conséquent, l’accédant à la propriété devenait responsable, avec ses coassociés, des éventuels surcoûts pouvant résulter de l’opération, et le plus souvent sans que cela fût réellement souhaité.
Cette fragilité de la technique sociétaire, et sa relative complexité, expliquent que le modèle de la vente d’immeuble à construire lui ait été préféré dès lors que son régime fut encadré par la loi du 3 janvier 1967.
Aussi bien, en répondant aux craintes que pouvaient avoir les acquéreurs à se lancer dans de telles opérations, cette loi fut justement saluée comme un bienfait de l’ingéniosité notariale. La sécurité qu’elle apporta fut l’une des raisons majeures de l’immense succès que devait connaître la technique de la vente en état futur d'achèvement.
L’adoption d’une législation de protection des acquéreurs
8 - Si l’intérêt de la vente d’immeuble à construire réside dans la possibilité pour le promoteur d’obtenir le financement de la chose future avant son achèvement, il en résulte nécessairement un plus grand risque du côté de l’acquéreur.
Pour celui-ci, accepter d’acquérir en l’état futur d’achèvement revient à supporter la charge économique des travaux de construction au fur et à mesure de leur réalisation. La cause des paiements que cela implique réside dans le transfert immédiat par le vendeur de ses droits sur le sol (qu’il s’agisse d’un droit de propriété ou d’autres droits réels autorisant la construction) et l’acquisition progressive de la propriété des constructions par voie d’accession immobilière.
Or, si la liberté financière du promoteur s’en trouve grandie, l’accédant à la propriété n’a aucune certitude que la construction sera un jour achevée, voire, dans les cas les plus pathologiques, simplement débutée.
9 - Consécration légale de la VEFA. – C’est pour répondre à cette crainte de l’acquéreur, qui, sinon, pourrait avoir réalisé des versements à fonds perdus, qu’est intervenue la loi du 3 janvier 1967. Tel est l’objectif même qui motiva la consécration légale d’un régime des ventes d’immeubles à construire (dont la vente en état futur d'achèvement est aujourd’hui la forme de loin la plus répandue).
Cette volonté de protection s’est d’abord traduite par l’adoption de tout un pan d’ordre public du régime de la vente en état futur d'achèvement dans le cadre de ce que l’on a appelé la VEFA du « secteur protégé ». Ce secteur protégé recouvre les opérations portant « transfert de propriété d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation (CCH, art. L. 261-10) », et a donc vocation à s’appliquer aux acquéreurs de logements. A contrario, tout ce qui ne relève pas du domaine de la vente de logements est appelé « secteur libre » et forme, avec la VEFA du « secteur protégé », une véritable summa divisio applicable en la matière.
9- On relèvera ici avec intérêt la méthode employée par le législateur pour désigner la personne considérée comme devant être protégée. Celle-ci n’a pas été définie subjectivement, comme pourrait l’être le consommateur5, mais simplement comme étant l’acquéreur d’un logement, et cela indépendamment de ses qualités intrinsèques. Le régime de la vente en état futur d'achèvement du secteur protégé se déploie donc à l’intérieur d’un périmètre parfaitement objectif, lequel n’a d’égard que pour la seule nature du contrat.
10 - Si un tel critère de définition permet assurément de garantir la protection du particulier acquéreur, il est cependant également source de difficultés. Il conduit en effet, ce qui est aujourd’hui largement dénoncé, à étendre le domaine du secteur protégé au-delà de ce qui avait sans doute été initialement prévu6. Cette extension est criante lorsqu’un professionnel acquiert des logements en VEFA en vue de leur revente ; dans cette situation, les parties à l’opération souhaiteraient opportunément pouvoir se placer sur le terrain de la vente en état futur d'achèvement du secteur libre, sans que cela ne leur soit actuellement permis. Ce qui est regrettable.
11 - Cet embarras à se placer sur le terrain de la vente en état futur d'achèvement du secteur protégé (du point de vue des acquéreurs professionnels) tient notamment à ce que, du moment que ce régime se trouve applicable, la liberté contractuelle est grandement restreinte. C’est ici que se manifeste, en effet, toute la volonté de protéger celui que l’on suppose être un particulier.
Il n’est pas possible aux parties, à l’intérieur de ce périmètre, de déroger à la majeure partie du régime de la vente en état futur d'achèvement, qui se teinte alors d’une coloration d’ordre public7. Dans le même ordre d’idées, il n’est plus d’autre forme de contrat préliminaire qui puisse être employée que celle du contrat dit de « réservation8 ».
12 - Fâcheuse pour les acquéreurs professionnels, la sévérité de cet ordre public de protection doit en revanche être saluée lorsque l’acquéreur est un particulier. Il y a derrière cette impérativité toutes les garanties nécessaires pour que celui qui cherche à se loger ne pâtisse pas d’une éventuelle situation de fragilité. Or, c’est bien dans son aptitude à faire triompher le juste équilibre contractuel que réside tout l’art du notaire.
De fait, l’application du régime de la VEFA du secteur protégé conduit à conférer à l’accédant à la propriété un ensemble de garanties supplémentaires, qui s’ajoutent à celles déjà présentes dans le secteur ordinaire.
13 - Garantiesau profit de l’acquéreur. – L’acquéreur est ainsi assuré de trouver, dans cette trousse à outils enrichie, des fondements d’actions pour répondre à chacun de ses maux. Il en ira ainsi, soit que la chose n’ait pu être achevée, soit qu’elle présente des vices de construction ou des défauts de conformité.
Dans le premier cas, et pour prévenir une éventuelle situation de faillite, la loi impose au promoteur de souscrire avant le début de l’opération une garantie financière d’achèvement ou bien de remboursement des versements réalisés (CCH, art. L. 261-11, al. 1er). Il s’agit d’une obligation dans le secteur protégé, et d’une précaution d’usage dans le secteur libre.
La première forme de garantie financière, la garantie d’achèvement, se décline à son tour en deux possibilités que sont l’ouverture de crédit ou le cautionnement. Toutefois, malgré cette alternative, le cautionnement est de loin la forme de garantie financière la plus pratiquée et il conduit, dans les situations de faillite du promoteur, à la prise en charge du financement de la construction par la banque jusqu’à son achèvement.
À côté de cela, la garantie financière de remboursement a pour seul objet de permettre à l’acquéreur de récupérer sa mise. Moins attirante pour ce dernier, qui n’accèdera finalement pas au bien désiré, la garantie financière de remboursement est en pratique largement délaissée au profit de la garantie financière d’achèvement.
14 - Pour le cas où les moyens du promoteur ne feraient pas défaut, une autre hypothèse pathologique est le défaut d’achèvement de la construction en raison de la perte de la chose par cas fortuit. On retrouve ici la question traditionnelle des risques attachés à la chose vendue.
En règle générale, le transfert de propriété s’accompagne du transfert concomitant des risques de la chose9. Pour autant, en ce domaine particulier de la vente en état futur d'achèvement, la jurisprudence a pris la liberté de déroger à ce principe, en précisant que le vendeur demeure garant des risques jusqu’à la date de la livraison de la chose à l’acquéreur10. Il en résulte que toute perte fortuite de la construction en cours d’édification est supportée par le vendeur, qui ne cesse de supporter les risques qu’au jour où le bien a pu être remis à l’acquéreur11.
15 - Il peut encore arriver que la construction, bien qu’achevée et livrée à l’acquéreur, présente ensuite des défauts de conformité ou des vices de construction. C’est ici une autre source de crainte pour l’acquéreur en l’état futur d’achèvement, qui est, par hypothèse, dans l’impossibilité d’apprécier ces défauts ou vices de la chose au jour de l’acte de vente (puisque celle-ci ne sera achevée que plus tard).
C’est pour s’adapter à cette particularité de la vente d’immeuble à construire qu’a été prévu, dans la loi du 3 janvier 1967, un ensemble de garanties spécifiques dues par le vendeur au titre des vices et défauts de la chose vendue.
Concrètement, ce dernier est garant, dans un premier temps, des vices et défauts apparents de la chose vendue. Il ne peut en être déchargé qu’à l’issue d’un délai d’1 mois à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession de l’acquéreur (C. civ., art. 1642-1). Puis, si des désordres sont constatés durant la période couverte par le plus long de ces deux délais, l’acquéreur dispose ensuite d’1 an pour agir sous peine de forclusion (C. civ., art. 1648, al. 2).
Dans un second temps, si se révèlent des vices de construction non apparents lors de la livraison de la chose, l’acquéreur pourra actionner le vendeur au titre des garanties biennale et décennale, qui lui sont également applicables. Le vendeur en VEFA est ainsi, du point de vue de la garantie des vices de construction, assimilé au constructeur de la chose12.
Le tout sans compter l’obligation de délivrance conforme également imposée au vendeur d’immeuble à construire, et la possibilité de l’actionner sur le terrain de la responsabilité contractuelle ordinaire pour le cas où un vice de construction ne répondrait pas aux conditions lui permettant d’actionner les garanties biennale et décennale13.
16- Conclusion. – Parce que chaque année les notaires reçoivent plus de vingt millions de personnes dans leurs études, ils sont légitimes à revendiquer avoir une perception aigue de leurs besoins.
Parce qu’ils sont des juristes formées aux matières qui touchent aux personnes et à leur environnement, ils sont capables de maîtriser l’arsenal juridique existant.
Mais enfin, parce qu’ils ont conscience de leur devoir d’être, aux côtés des pouvoirs publics, des éclaireurs et d’explorer le champ des possibles, ils tiennent depuis plus d’un siècle des congrès destinés à améliorer et sécuriser le droit.
Partir d’un besoin (la construction de logements dans une France des trente glorieuses) et d’une aspiration citoyenne (l’accès à la propriété) pour imaginer un modèle juridique proposé aux pouvoirs publics dans l’espoir d’une consécration législative. Telle est la manière dont on pourrait résumer l’histoire de l’introduction dans notre droit de la vente en l’état futur d’achèvement.
Elle apparaît être ainsi une parfaite illustration du rôle de bâtisseur des notaires. ▪
L'essentiel à retenir
- Le notaire, en tant qu’agent de modernisation de la loi, joue un rôle primordial dans l’évolution des pratiques immobilières, notamment par la mise en place de mécanismes adaptés aux réalités du terrain, comme avec la vente en état futur d'achèvement.
- L’instrument de la vente d’immeuble à construire, notamment la VEFA, illustre l’ingéniosité notariale qui a su anticiper et encadrer juridiquement des opérations complexes pour répondre à des enjeux financiers et sécuritaires.
- La législation encadrant les ventes en état futur d'achèvement a été conçue pour protéger les particuliers, en imposant des garanties financières et en assurant la sécurité juridique face aux risques liés à la construction.
- La loi du 3 janvier 1967 introduit deux régimes distincts en fonction de la nature de la vente et du profil de l’acquéreur, renforçant ainsi les obligations contractuelles pour les transactions destinées aux logements et limitant la liberté contractuelle.
Mots-clés : Vente en l’état futur d’achèvement
Notes
- Ce principe se retrouve aujourd’hui à l’article 1163 du Code civil, issu de la réforme du 10 février 2016. Le texte précise, alinéa 1er : « l'obligation a pour objet une prestation présente ou future ». ↩
- Cette pratique fut baptisée « méthode de Grenoble ». V. JCl. Notarial Formulaire, fasc. 10, Ventes d’immeubles à construire. - Origine. Législation. Définition, par D. Sizaire et G. Durand-Pasquier. ↩
- L’application de cette garantie de droit commun au vendeur d’immeuble à construire a d’ailleurs plus tard été rejetée. En ce sens : Cass. 3e civ., 11 déc. 1991, n° 90-15.469 : JurisData n° 1991-003121. ↩
- Le juriste moderne pourrait en être surpris, tant cette approche subjective est aujourd’hui devenue la norme sous l’impulsion du droit de la consommation (dont le rôle ne fait que croître). ↩
- En ce sens, on citera notamment la troisième proposition de la première commission du 118e Congrès des notaires, suggérant : « D’ajouter aux critères permettant de distinguer les champs d’application respectifs du secteur libre et du secteur protégé, un critère se rapportant à la qualité de l’acquéreur en VEFA. Ce critère pourrait utilement renvoyer à la notion de professionnel de l’immobilier […] ». ↩
- L’article L. 261-10 du Code de la construction et de l'habitation précise en effet, dans son alinéa 1er : « Tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation […] doit, à peine de nullité, revêtir la forme de l'un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du code civil, reproduits aux articles L. 261-2 et L. 261-3 du présent code. Il doit, en outre, être conforme aux dispositions des articles L. 261-11 à L. 261-14 ci-dessous ». Surligné par nos soins. C'est en outre le mécanisme du réputé non-écrit qui est ici à l’œuvre, ce que l’on trouve à l’article L. 261-16 du Code de la construction et de l'habitation : « Toute clause contraire aux dispositions des articles L. 261-11 à L. 261-15 du présent code et à celles des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, est réputée non écrite ». ↩
- Ce contrat préliminaire présente pourtant un certain nombre d’éléments de régime qui, s’ils se conçoivent fort bien lorsque l’acquéreur est un particulier, peuvent paraître en inadéquation avec les opérations passées entre professionnels. Du point de vue du réservant, ce dernier pourrait déplorer que l’indemnité versée par le réservataire ne puisse excéder 5 % du montant prévisionnel, voire ne pas être même possible si le délai de signature du contrat de VEFA est de plus de 2 ans à compter du contrat de réservation. Du point de vue du réservataire, ce dernier pourrait souhaiter obtenir un engagement plus ferme de la part du réservant, lequel ne s’oblige qu’à la formulation d’une offre de vente pour le cas où son programme serait viable. ↩
- Principe désormais formulé à l’article 1196, alinéa 3 du Code civil : « Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose ». ↩
- Cass. 3e civ., 11 oct. 2020, n° 98-21.826: JurisData n° 2000-006185. ↩
- On observe ainsi une tendance de la vente en état futur d'achèvement à apporter un certain nombre d’entorses aux effets ordinaires du transfert de propriété de l’assiette foncière. La plus importante est évidemment relative à la qualité de maître de l’ouvrage. En effet, si la qualité de maître de l’ouvrage appartient par principe au propriétaire du sol et devrait donc être celle de l’acquéreur, ce rôle est ici assumé par le vendeur jusqu’à la date de réception des travaux (selon l’article 1601-3 du Code civil). Il reviendra donc notamment au vendeur de contracter avec les différents loueurs d’ouvrages, de s’assurer de la bonne exécution des travaux et d’en faire la réception. ↩
- L’article 1646-1 du Code civil fait en effet renvoi au régime du constructeur dans les termes suivants : « Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code ». ↩
- La doctrine qualifie cela de « théorie des dommages intermédiaires ». Il nous faut ici mentionner la nécessité qu’a l’acquéreur, désormais clairement affirmée en jurisprudence, de prouver la faute du vendeur (en ce sens : Cass. 3e civ., 4 juin 2009, n° 08-13.239 : JurisData n° 2009-048516). C’est en réalité une tâche très ardue dans la mesure où le vendeur n’est pas celui qui assume, dans les faits, la tâche de bâtir l’immeuble. ↩
LES ARTICLES
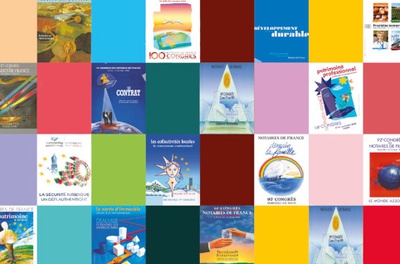
Introduction générale - Le notaire et la loi : « Et voudriez-vous… »
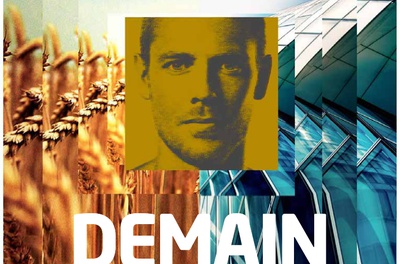
Introduction générale sur la famille
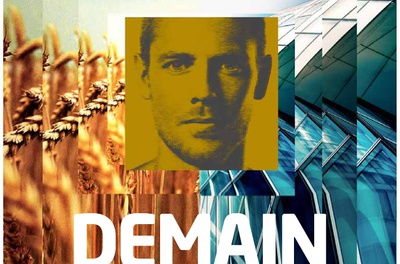
La contribution du notariat à l’amélioration du PACS
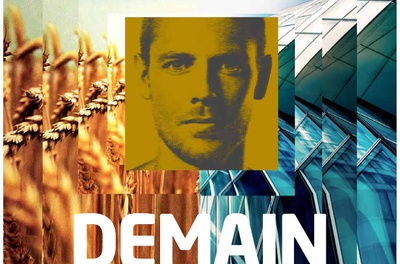
Les personnes vulnérables : quelles suites pour les propositions adoptées ?
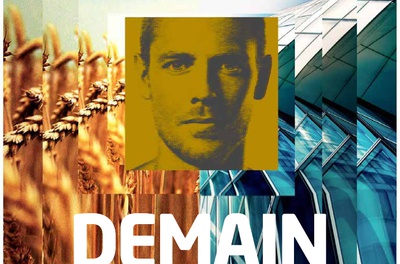
Libéralités graduelles et résiduelles : des solutions à ne pas oublier pour les personnes vulnérables
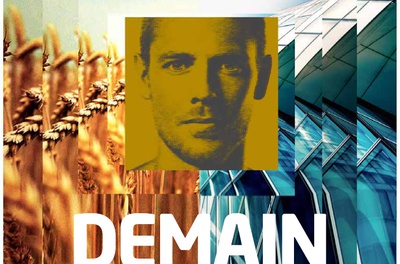
La renonciation à l'action en réduction des articles 929 et suivants du Code civil
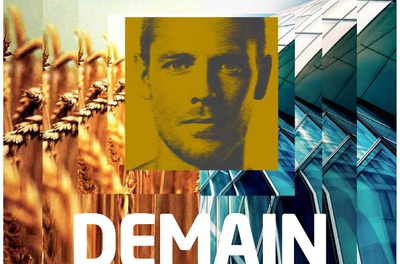
La vocation successorale égalitaire de tous les enfants
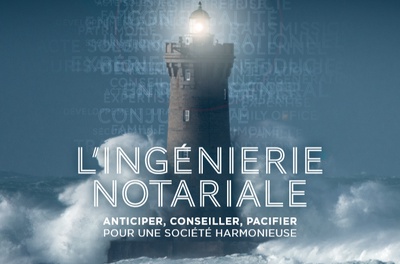
Introduction générale sur l’immobilier
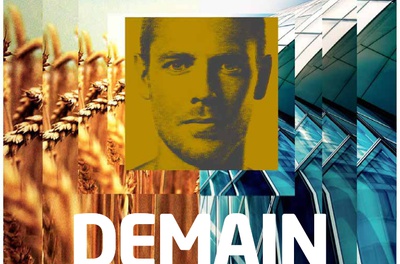
La vente d'immeuble à rénover : la suite de trois Congrès…
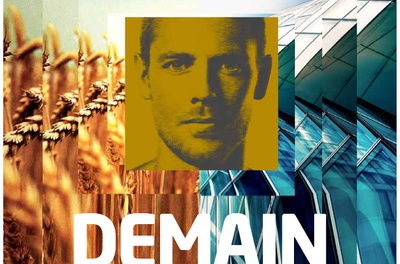
La vente en l’état futur d’achèvement : l’héritage des notaires bâtisseurs
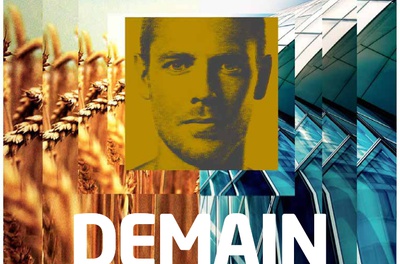
La division en volumes : l’inventivité notariale au service d’une nouvelle utilisation de l’espace
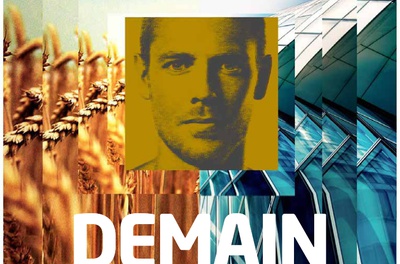
La reconnaissance par le droit de l’urbanisme du mécanisme de la prescription extinctive (C. urb., L. 421-9)
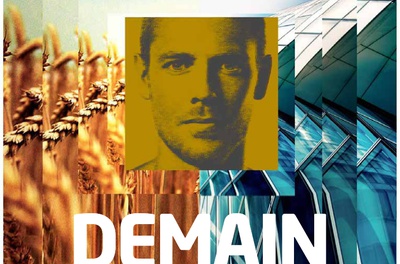
Le transfert par subrogation des accessoires garantis par l’inscription d’origine
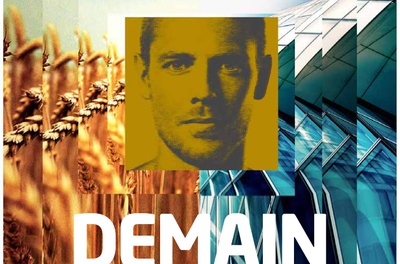
Introduction générale sur le droit public
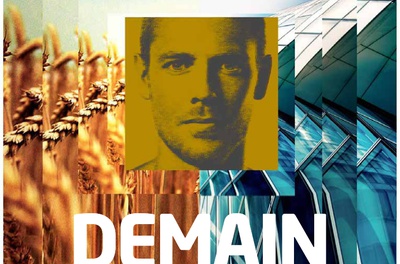
L'extension du déclassement par anticipation
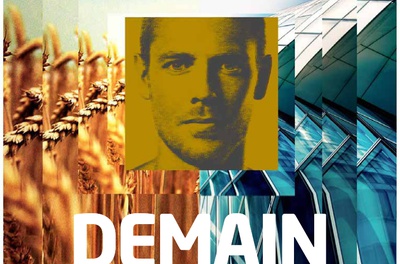
La sécurisation des droits du commerçant exploitant sur le domaine public
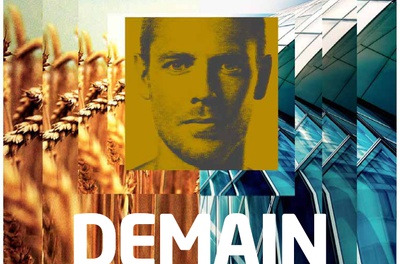
La sanction des clauses non conformes par le réputé non-écrit
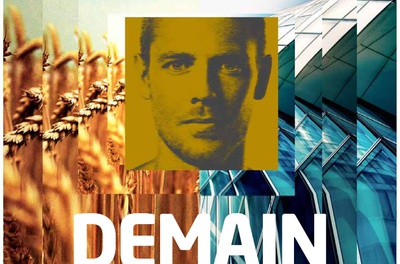
Entretien avec Jean-François Pillebout