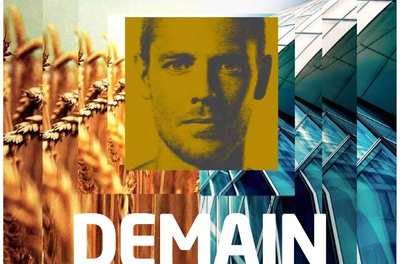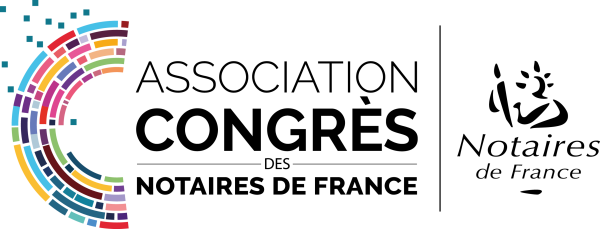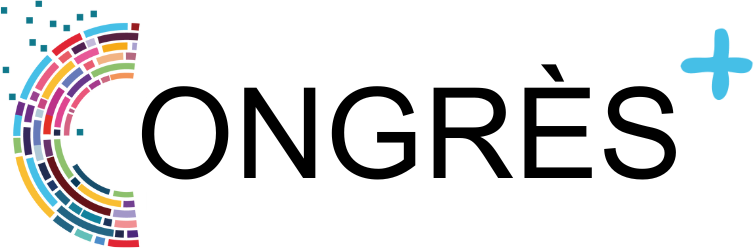Introduction générale - Le notaire et la loi : « Et voudriez-vous… »
Les apports des Congrès des notaires de France au droit
Plus de 200 textes législatifs et près de 130 règlementaires
inspirés des Congrès des notaires de France
La vente d'immeuble à rénover : la suite de trois Congrès…
77e Congrès des notaires de France, Montpellier 1981 | 93e Congrès des notaires de France, Strasbourg 1997 | 99e Congrès des notaires de France, Deauville 2003
1 - Rénover: un devoir national. –Rénover est un devoir national. Telle est la conclusion que les sociologues, les urbanistes, les économistes et les politiques ont tirée d'un examen objectif de la situation actuelle de nos cités. « Guerre aux démolisseurs ! ». Cette imprécation, lancée il y a près de 200 ans par Victor Hugo1, destinée à faire cesser les destructions inconsidérées préjudiciables à la conservation du patrimoine architectural de la France semble enfin avoir été entendue, à telle enseigne que l'on devrait presque dire aujourd'hui : « Vivent les rénovateurs ! ».
En réaction contre les actions de destruction menées au cœur des villes, on a ainsi pu assister à la naissance, au sein de l'opinion, d'un large consensus sur la nécessité de protéger les quartiers anciens. Ce souci est devenu désormais l'une des constantes de l'urbanisme contemporain. Illustrant cette prise de conscience, Jacques Barrot, alors secrétaire d'État au Logement, avait déclaré : « Rénover l'habitat ancien, c'est amorcer un véritable virage dans la politique officielle de l'urbanisme »2.
2 - Plusieurs raisons peuvent expliquer ce revirement.
En premier lieu, il serait vain de se cacher que les déceptions éprouvées à la suite de l'adoption d'une politique privilégiant exagérément la construction neuve, ont contribué à nourrir la préférence que l'on constate aujourd'hui. Pour rattraper le retard considérable qu'il avait accumulé, notre pays a connu, durant plusieurs années, un développement considérable des constructions neuves. Cet effort quantitatif n'a malheureusement pas toujours été accompagné d'un effort qualitatif de même ampleur ; la qualité architecturale des constructions réalisées laissant parfois beaucoup à désirer. L'implantation de cités-dortoirs à la périphérie des villes a aussi gravement perturbé le mode de vie des habitants en accroissant démesurément la distance entre le lieu de travail et le domicile ainsi que le temps de transport pour se rendre de l'un à l'autre.
Par ailleurs, l'édification hâtive de grands ensembles, sans esprit et sans âme, loin de réaliser un cadre de vie propice aux échanges, s'est révélée constituer, en fait, un facteur de discrimination sociale.
3 - La rénovation d'immeubles existants avec, le cas échéant, transformation d'immobilier tertiaire en logements, permet, au contraire, de combattre l'attrition et le dépérissement progressifs du cœur de nos cités et d'éviter les effets ségrégatifs qu'entraînent fréquemment les opérations de démolition suivies de reconstruction. Répondant, en outre, aux impératifs écologiques du développement durable, la rénovation immobilière permet de promouvoir une politique d'urbanisme conforme aux aspirations des populations citadines. Elle participe à la lutte contre le dépeuplement de certains centres urbains, tout en favorisant, au besoin, la création de logements sociaux.
4 - Une absence initiale d’un statut légal de la rénovation. – En dépit de son intérêt, la rénovation immobilière a longtemps été dépourvue de tout statut légal, de sorte que l'on pouvait s'interroger sur le point de savoir si la vente d'un immeuble à rénover devait ou non être assimilée à une vente d'immeubles à construire régie par la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967. Certains auteurs s'étaient cependant risqués à esquisser quelques pistes de réflexion, en soulignant que les règles de droit alors existantes étaient inadaptées aux opérations de rénovation, même si, par certains de leurs aspects et dans bien des cas, elles pouvaient s'apparenter à des opérations de construction3.
5 - LeCongrès des notaires de mai 2003 : contexte. – Lorsque j'ai eu l'honneur de me voir confier, en 2001, la présidence du 99e Congrès des notaires de France qui s'est tenu à Deauville, en mai 2003, sur le thème de la vente d'immeuble, force m'a été de constater que le législateur n'avait toujours pas répondu à la demande du notariat qui souhaitait l'instauration de règles spécifiques pour le contrat de vente d'immeubles à rénover. Bien que deux précédents Congrès aient déjà abordé cette question4, la situation inextricable devant laquelle se trouvaient les praticiens, à cause du vide législatif en ce domaine, nous faisait un devoir d'évoquer à nouveau la vente d'immeubles à rénover. L'équipe du 99e Congrès, menée par Dominique Larralde, son dynamique rapporteur général, et conseillée par le professeur Périnet-Marquet, son précieux rapporteur de synthèse, était unanime pour faire une nouvelle tentative afin de promouvoir un véritable statut pour la vente de l'immeuble à rénover, en espérant que, cette fois, nous serions entendus par les pouvoirs publics.
6 - Plus de 20 ans après, il semble intéressant de voir comment a été accueillie la proposition faite par notre Congrès visant à obtenir la création d'un statut de la rénovation. Cela nous conduira d'abord à évoquer la genèse de l'actuelle vente d'immeubles à rénover (VIR) (1). Adoptant ensuite une démarche prospective, nous nous interrogerons sur la coexistence des dispositions régissant la vente de l'immeuble à rénover avec celle de la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) (2).
1.La genèse de la vente d'immeubles à rénover
7 - La difficulté à définir, de manière objective, la rénovation immobilière et les divers aspects qu'elle peut revêtir (A) imposaient de rechercher les critères permettant son assimilation, le cas échéant, à une opération de construction (B). Toutefois, l'application à la vente d'immeubles à rénover du régime de la vente en l'état futur d'achèvement ne constituant qu'une solution approximative, l'instauration d'un statut autonome s'est révélée indispensable (C).
A. -Les difficultés pour définir la rénovation
8 - Terminologie. – Afin de désigner les opérations originales consistant à améliorer le confort et les conditions d'habitabilité des immeubles anciens, on a parlé tantôt de « restauration », tantôt de « restructuration » ou encore de « réhabilitation » ou parfois même de « curetage ». Ces termes ne paraissent refléter qu'imparfaitement la spécificité de ce type d'opération visant à moderniser un immeuble vétuste, tout en lui conservant ses traits originaux. Le mot « rénovation », en revanche, implique bien, à la fois, l'action de remettre en état et celle d'améliorer en apportant des éléments nouveaux. C'est ce dernier vocable qui s'est finalement imposé pour désigner ce type d'opération.
9 - Domaine de la rénovation immobilière. – La rénovation immobilière recouvre, en pratique, des situations différentes selon l'importance des travaux à réaliser.
Certains immeubles n'exigent qu'une mise aux normes d'habitabilité (changement des appareils sanitaires, installation de salles d'eau, réparation des huisseries) et même parfois une simple réfection des peintures. Dans d'autres cas, les immeubles exigent des travaux plus importants afin de réaménager un bâtiment, en redistribuant les appartements qu'il comporte tout en révisant complètement sa toiture. Parfois enfin, l'état des cloisons, des plafonds et des planchers impose leur remplacement par de nouvelles structures intérieures avec installation d'un ascenseur et d'un chauffage central.
10 - Domaine de la vente d’immeuble à construire. – Par leur ampleur, certains travaux peuvent, à l'évidence, équivaloir à une opération de construction de sorte que l'on conçoit, sans trop de difficulté, que toute vente réalisée avant achèvement de l'immeuble en cours de rénovation puisse relever de l'article L. 261-10 du Code de la construction et de l'habitation : « Tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d'un immeuble ou d'une partie d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et comportant l'obligation pour l'acheteur d'effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l'achèvement de la construction doit, à peine de nullité, revêtir la forme de l'un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du Code civil », instituant la vente à terme et la vente en l'état futur d'achèvement.
Attention
Les dispositions de l'article L. 261-17 du Code de la construction et de l'habitation qui punit d'un emprisonnement de 2 ans et ou d'une amende de 9 000 € toute personne qui exige ou accepte un versement en violation des articles L. 261-12 et L. 261-15 du même code doivent inciter les rénovateurs et les notaires à la plus grande prudence. Il convient donc de rechercher les critères permettant d'appliquer à un immeuble à rénover le cadre juridique de la vente d'immeubles à construire.
Fin d’attention
B. -La recherche des critères de la rénovation-construction
11 - Des critères d’appréciations à géométrie variable. – La jurisprudence tendant à transposer l'application du régime de la vente d'immeuble à construire au cas de l'immeuble à rénover était difficile à interpréter5. Certaines décisions se sont attachées à examiner la nature des travaux en considérant, par exemple, que le ravalement extérieur, la réfection de la toiture et du chauffage central, la peinture intérieure, la pose de couvre-sol et de moquette dans un immeuble existant ne pouvaient caractériser une opération de construction. D'autres décisions sont fondées sur l'importance des travaux à réaliser sur un bâtiment existant, en estimant que la vente de locaux peut être qualifiée de vente d'immeuble à construire, si les travaux sont suffisamment importants pour être considérés comme une construction intérieure. Un examen au cas par cas se révèle toutefois indispensable afin de s'assurer de la consistance exacte des travaux à réaliser, sachant que les juges n'entendent pas appliquer la loi du 3 janvier 1967 dans l'hypothèse de remise en état ou de simples travaux d'entretien sur un immeuble. Une décision, qualifiée d'espèce, a exclu du champ d'application de la loi de 1967 la vente de studios provenant de la surélévation d'un immeuble au motif que celle-ci avait été consentie par un marchand de biens. Il est vrai qu'en l'occurrence le rénovateur avait invoqué le bénéfice de la loi pour s'affranchir de la garantie des vices apparents et des vices cachés à laquelle il était tenu en tant que vendeur professionnel.
12 - Clarification jurisprudentielle. – En excluant le critère de l'importance des travaux, la Cour de cassation a contribué à simplifier le débat. Par un arrêt du 23 octobre 19786, la chambre criminelle a décidé que « la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 s'applique à l'un quelconque des locaux composant un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'une édification complète de l'immeuble en cause ou partie decelle-ci ; qu'il n'y a pas lieu d'en exclure la vente de locaux destinés à être transformés sans surélévation à l'intérieur d'un volume existant… ».
Dès lors, le doute n'était plus permis : toute vente de locaux d'habitation comportant obligation pour l'acheteur d'effectuer des versements avant l'achèvement des travaux devait être soumise aux dispositions de la loi du 3 janvier 1967.
13 - Transposition de la vente en état futur de rénovationau régime de la VEFA. –Pour tenir compte de la jurisprudence et avant toute intervention législative, on peut tenter de dégager les critères permettant à la pratique de soumettre les ventes en état futur de rénovation au droit positif des ventes d'immeubles à construire :
• un critère se voulant objectif consistait à considérer que, dès lors que les conditions de l'article L. 261-10 du Code de la construction et de l'habitation étaient réunies, celui-ci devait s'appliquer. Par suite, si un contrat de vente portant sur un immeuble relevant du secteur protégé imposait à l'acquéreur le versement de fonds avant que l'immeuble soit achevé au sens de l'article R. 261-1 du CCH, il devait revêtir la forme de l'un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du Code civil. La notion d'achèvement était donc essentielle. Le régime de droit commun était applicable si l'immeuble, lors de la vente, pouvait être considéré comme achevé ; à l'inverse, les règles de la vente d'immeubles à construire s'imposaient. Encore fallait-il qu'il s'agisse d'une rénovation-construction, consistant à exécuter des travaux modifiant plus ou moins profondément la disposition des lieux et restructurant l'intérieur de l'immeuble, par des travaux visés par les dispositions des articles 1792 et 1792-2 du Code civil. En effet, la rénovation-modernisation, destinée à mettre aux normes du confort moderne un bâtiment sans en modifier la structure ni la distribution, relevait du droit commun de la vente d'immeuble7.
• même si, pris isolément, ils n'étaient pas déterminants, l'adjonction de critères supplémentaires tels que l'obtention d'un permis de construire ou l'assujettissement de l'opération à la TVA pouvait aussi être de nature à conforter l'opinion que l'on pouvait avoir sur la véritable nature de l'opération de rénovation.
14 - Une solution source de difficultés pratiques. – Afin de protéger les acquéreurs de biens à rénover, à usage d'habitation ou à usage mixte, la pratique notariale s'était inspirée des contrats de vente en état futur d'achèvement pour rédiger ceux des ventes en état futur de rénovation. Indispensable pour répondre aux prescriptions résultant de la jurisprudence, cette solution n'en restait pas moins approximative car elle ne permettait pas de résoudre tous les problèmes. La transposition du régime de la vente en état futur d'achèvement au secteur de la rénovation s'est révélée inadéquate à certains égards.
15 - Parmi les garanties d'achèvement dites extrinsèques et intrinsèques prévues pour la vente en état futur d'achèvement, il est apparu que les secondes étaient totalement inappropriées dans le domaine de la rénovation. Considérées, au mieux, comme des présomptions de bonne fin des programmes immobiliers et, au pire, comme parfaitement illusoires, ces prétendues garanties d'achèvement devaient être écartées par les rédacteurs des contrats de vente d'immeubles à rénover qui tentaient de convaincre les vendeurs de mettre en place une garantie extrinsèque8.
Par ailleurs, la mise hors d'eau d'un immeuble libre de tout privilège ou hypothèque, visée par l'article R. 261-18 du CCH, bien qu'attestée au moyen d'un certificat délivré par un homme de l'art, pouvait être suivie de la dépose de la totalité de la toiture. De même, la condition tenant à l'exigence de l'achèvement des fondations d'un bâtiment s'est révélée inopérante car, s'agissant d'un immeuble à rénover, les fondations étaient, par hypothèse, déjà achevées et pouvaient d'ailleurs faire l'objet d'une éventuelle reprise en sous-œuvre.
Enfin, tel que prévu par l'article R. 261-14 du CCH pour la vente en état futur d'achèvement, l'échelonnement du paiement du prix en fonction de l'avancement des travaux ne paraissait pas de nature à assurer une protection suffisante à l'acquéreur d'un bien à rénover. Cet échelonnement n'aurait pas dû être identique à celui du prix de vente d'un immeuble à construire. Ainsi qu'il a été précisé plus haut, les fondations étant déjà réalisées, il semblait inopportun de considérer leur achèvement comme un stade représentant un palier rendant exigible le règlement d'une partie du prix.
16 - L'application à la vente d'immeubles à rénover du régime de la vente en état futur d'achèvement, tout en excluant de celui-ci certaines dispositions jugées inadaptées ou incohérentes, fragilisait le contrat de vente en état futur de rénovation et représentait un facteur d'insécurité des parties à l'acte. Cela rendait indispensable l'instauration d'un statut propre à la rénovation, ce que le législateur s'est finalement résolu à consacrer, en s'inspirant des travaux de nos Congrès.
C. -L'instauration d'un statut autonome pour la rénovation
17 - Article L. 262-1 du CCH. – Il n'est pas dans notre propos d'exposer le régime de la vente d'immeuble à rénover issu de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, codifiée sous les articles L. 261-2 à L. 262-10 du CCH, et complétée par les dispositions du décret n° 2008-1338 du 16 décembre 20089. Qu'il nous soit cependant permis de relater les deux premiers alinéas de l'article L. 262-1 du CCH :
« La vente d'immeuble à rénover est le contrat par lequel le vendeur d'un immeuble bâti ou d'une partie d'immeuble bâti, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, transfère immédiatement ses droits à l'acquéreur et, dans un délai déterminé par ce contrat, réalise ou fait réaliser des travaux et prévoit le paiement de sommes d'argent ou le dépôt de fonds avant la livraison des travaux.
« Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travaux d'agrandissement ou de restructuration complète de l'immeuble, assimilables à une reconstruction ».
18 - Influence des travaux des Congrès.– La lecture de ce texte et des dispositions complémentaires permet de constater que le législateur s'est largement inspiré des travaux des 77e, 93e et 99e Congrès même s'il n'a pas retenu l'intégralité des propositions, présentées successivement par les commissions, dont on peut relever qu'elles avaient d'ailleurs, sur certains points, un peu évolué au fil des années. On pourrait presque qualifier de « pluripaternité » l'apport des trois Congrès précités au corps de règles régissant désormais la vente d'immeuble à rénover.
19 - Dépôt d’un projet de loi n° 194.–Répondant aux sollicitations du notariat, un premier projet de loi n° 194, relatif à la protection des occupants et des acquéreurs de biens immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, avait été déposé sur le bureau du Sénat, lors de la session 1992-1993. L'article 13 de ce texte prévoyait la création d'un « contrat de vente en état futur de rénovation ». D'après l'exposé des motifs, le législateur entendait apporter « une clarification nette des prestations promises avec leurs prix et les conditions de paiement ». De fait, avec l'assistance d'un architecte et d'un contrôleur technique, le rénovateur prenait l'engagement de réaliser directement ou indirectement des travaux sur les éléments constitutifs ou les éléments d'équipement de tout ou partie d'un immeuble. Le projet prévoyait en outre une garantie financière de bonne exécution des travaux, tout en réservant à l'acquéreur la faculté d'en réaliser certains par lui-même.
Remarque
En dépit de ces imperfections, notamment à propos de l'échelonnement des paiements, ce projet de loi, en cas d'adoption, aurait pu améliorer sensiblement la sécurité des acquéreurs de biens immobiliers à rénover10. Aussi peut-on s'étonner que ce projet n'ait pas été repris lors de l'élaboration de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 dite « Solidarité et Renouvellement Urbain » dont l'objectif était de repeupler les centres-villes.
Fin de remarque
20 - Conception de la VIR proposée par le 99e Congrès. – Considérant que la loi SRU, qui voulait rebâtir la ville sur la ville, avait passé sous silence la rénovation, le 99e Congrès a proposé au législateur de définir un statut de la vente en état futur de rénovation pour toute vente d'un immeuble existant que l'acquéreur destine à l'habitation ou à usage mixte, comportant l'engagement par le vendeur professionnel, directement ou indirectement, d'effectuer des travaux après la signature de l'acte de vente constatant le paiement de tout ou partie du prix. Ce statut, inspiré de celui de la vente en état futur d'achèvement, devait être adapté, notamment sur l'échéancier de paiement du prix, établi par un homme de l'art en fonction de l'avancement des travaux, et assorti d'une garantie d'achèvement extrinsèque.
Tout en limitant le champ d'application du statut de la vente d'immeuble à rénover au vendeur professionnel, notre proposition visait, en revanche, l'ensemble des travaux de rénovation, quels qu'ils soient, en ce compris les petits travaux dont on pouvait penser que le rénovateur aurait préféré les réaliser avant la vente afin d'éviter d'avoir à subir les contraintes du statut.
21 - Conception de la VIR retenue par le législateur. –Or, aux termes de l'article L. 262-1 du CCH, le législateur ne s'attache pas à la qualité des parties. Les règles protectrices doivent s'appliquer que le vendeur ou l'acquéreur soient un professionnel ou un non professionnel. Seul l'objet du contrat importe. Dans le statut légal de la rénovation, en vertu de l'article R. 262-1 du CCH, les règles de la vente en état futur d'achèvement sont, de plein droit, applicables aux travaux d'agrandissement ou de restructuration complète d'un immeuble existant.
Sont assimilables à une reconstruction les travaux de rénovation ou d'agrandissement rendant à l'état neuf :
• soit la majorité des fondations ;
• soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ;
• soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;
• soit l'ensemble des éléments de second œuvre suivants, dans une proportion au moins égale à deux tiers pour chacun des éléments ci-après :
- les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage,
- les huisseries extérieures,
- les cloisons intérieures,
- les installations sanitaires et de plomberie,
- les installations électriques,
- et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage.
Remarque
Ces différents critères sont objectivement appréciés et quantifiés par l'expert, impartial et indépendant, défini à l'article R. 262-7 du CCH.
Fin remarque
22 - Il arrive que la recherche de la sécurité aboutisse parfois à une certaine complexité. Paradoxalement, depuis la loi du 13 juillet 2006, relative à la rénovation immobilière, la VIR doit, dans certaines circonstances, s'effacer devant la VEFA. La coexistence de ces deux régimes ne va pas sans soulever quelques difficultés qui ont déjà retenu l'attention de la doctrine11.
2.La coexistence de la VIR et de la VEFA
23 - Pratique antérieure à la loi de 2006. –Avant la loi de 2006, la pratique disposait de deux types de contrat pour accompagner la commercialisation d'un immeuble à rénover12. En présence de travaux importants réalisant une opération de rénovation-construction, le recours à la vente en état futur d'achèvement s'imposait. À l'inverse, une rénovation légère ne donnant lieu à aucun travaux d'ampleur restait dans le champ du droit commun de la vente, assortie au besoin d'une convention sur les aménagements et prestations à réaliser. Les suggestions faites par le 99e Congrès aboutissaient, dans un souci de simplification, à maintenir la dualité des statuts de la vente de l'immeuble, objet d'une rénovation, sous réserve d'une différence majeure. Lorsque les travaux devaient être faits après la vente, le statut protecteur devait obligatoirement s'appliquer, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la nature et la valeur des travaux comparée à celle de l'immeuble existant ; l'exécution des travaux avant la vente permettait, à l'évidence, de recourir à un contrat de vente de droit commun.
24 - Pratique issue de la loi de 2006. – Or, il résulte de la loi de 2006 qu'une opération de rénovation immobilière relève désormais tantôt du statut de la VEFA, tantôt de celui de la VIR, en fonction de l'importance et de la nature des travaux à réaliser et selon les critères précis définis par décret.
Conçus pour des situations différentes, ces deux régimes pourraient actuellement être appelés à coexister pour une même opération immobilière (A). Cependant, l'application conjointe et distributive de la VIR et de la VEFA, dans ces conditions, se révèle d'une telle complexité (B) qu'il conviendrait plutôt d'envisager une application exclusive d'un seul régime pour une seule opération (C).
A. - Le cumul de la VIR et de la VEFA
25 - Spécificités des régimes. –À l'origine, lors de la mise en place de la VEFA et de la VIR, chacun de ces régimes correspondait à une situation bien différenciée. Alors que le statut de la VEFA a été conçu exclusivement pour l'édification d'un bâtiment sur un terrain nu, celui de la VIR devait concerner des travaux à réaliser sur une construction déjà existante. Qu'un même programme puisse englober, en même temps, un bâtiment à rénover et des constructions neuves ne semble pas avoir été envisagé.
26 - On voit pourtant se développer des opérations immobilières de ce type qui peuvent troubler la pratique.
Exemple
Il se peut qu'un contrat de vente porte sur la partie rehaussée d'un immeuble existant faisant ou non lui-même l'objet d'une restructuration interne. De même, l'agrandissement d'un bâtiment existant au moyen d'une extension horizontale, notamment pour la commercialisation d'un ensemble de maisons individuelles, peut conduire, lors de la vente de celles-ci, à faire une distinction entre la partie neuve et la partie ancienne. Enfin, on ne peut exclure l'hypothèse de l'adossement à un bâtiment collectif existant d'une construction nouvelle de même hauteur, de sorte que les ventes des appartements dépendant de cet immeuble en cours d'agrandissement porteraient, tantôt sur des appartements à construire, tantôt sur des appartements anciens et, peut-être même, tantôt sur des appartements composés de pièces dont les unes dépendraient des parties anciennes et les autres de la nouvelle construction.
Fin exemple
27 - Ainsi que l'a relevé, à juste titre, Olivier Herrnberger13, ces différentes situations sont de nature à accroître la perplexité des praticiens qui y sont confrontés. Un même programme immobilier peut-il être soumis cumulativement au statut de la VEFA et de la VIR ? Si elle mérite d'être posée, la question semble, à ce jour, demeurée sans réponse. Les dispositions combinées des articles L. 262-1 et R. 262-1 du CCH imposent d'assimiler à une reconstruction les travaux d'agrandissement ou de restructuration importante, mais assujettissent les autres opérations de rénovation aux règles de la VIR, ce qui commande de plein droit l'application de ce statut spécifique à l'immeuble ou à la partie d'immeuble en cours de rénovation. Semblant résulter de la loi, le cumul des statuts de la VEFA et de la VIR dans une même opération serait donc possible dans certaines circonstances et à certaines conditions.
B. -L'application distributive de la VIR et de la VEFA
28 - Au stade de l’avant-contrat. –D'emblée, il apparaît que l'application conjointe des régimes de la VEFA et de la VIR à un programme immobilier unique sera source de complexité et de difficultés pratiques. D'abord, au stade de la commercialisation et de la rédaction des avant-contrats, il faut expliquer aux candidats acquéreurs que, selon la localisation des appartements proposés à la vente, ils auront à signer un contrat préliminaire, conforme aux dispositions de l'article L. 261-15 du CCH, ou bien une promesse de VIR prévue par les articles L. 262-9 et L. 262-14 du CCH. La juxtaposition de deux environnements contractuels différents au sein d'un même programme, selon que le bien immobilier se trouve dans la partie neuve ou devant être considérée comme telle, ou à rénover, risque de ne pas faciliter la commercialisation de celui-ci. Les documents qui doivent être réunis ou produits par le vendeur ne sont évidemment pas identiques pour la VEFA et pour la VIR. On sait que, dans ce dernier cas, il sera nécessaire d'établir des diagnostics techniques de l'existant et indispensable de ventiler le prix entre la partie à rénover et les travaux à réaliser, tout en indiquant la superficie future.
29 - Lors de la mise en place des garanties. – Pour les mêmes raisons, la mise en place des garanties de bonne fin peut s'avérer délicate. La fourniture de deux garanties distinctes est possible à condition de prévoir leur divisibilité ou leur indivisibilité. Une garantie unique d'achèvement semble, sans doute, préférable si elle répond aux exigences cumulées des articles R. 262-12 du CCH, pour la VIR, et L. 261-10 du CCH, pour la VEFA.
30 - Dans le cadre de la copropriété. – En dernier lieu, l'application conjointe des règles de la VEFA et de la VIR peut, dans un immeuble collectif, perturber le fonctionnement de la copropriété. En effet, l'article 1-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que, pour un immeuble bâti existant, le statut de la copropriété s'applique à compter du premier transfert de propriété d'un lot, alors que, pour les immeubles à construire, le fonctionnement de la copropriété découlant de la personnalité morale du syndicat des copropriétaires prend effet lors de la livraison du premier lot. Il en résulte une distorsion, au sein d'une même copropriété, dans le traitement des copropriétaires, selon qu'ils détiennent des lots se trouvant dans un bâtiment existant ou dans une construction nouvelle.
31 - L'application conjointe et distributive des règles de la VEFA et de la VIR à une opération unique aboutit à un résultat dont la complexité confine à l'incohérence, alors même que le maintien de cette dualité n'a pas de réelle justification. Aussi est-il pertinent de rechercher la solution qui consisterait plutôt à privilégier une application exclusive d'un seul statut à un même programme immobilier.
C. -L'application exclusive de la VIR ou de la VEFA
32 - Quelques pistes ont déjà été tracées récemment par Olivier Herrnberger14, car il lui paraît souhaitable d'éviter le télescopage de la VEFA et de la VIR dans une même opération. À cet effet, pour privilégier un statut par rapport à l'autre, il importe d'envisager l'opération immobilière dans sa globalité, en ayant, si l'on peut oser cette image, une approche plus impressionniste que pointilliste.
33 - Exclusion de la VIR en cas de travaux d’agrandissement. – Sachant que l'article L. 262-1, alinéa 3 du CCH exclut déjà du régime de la VIR les travaux d'agrandissement, une première solution consisterait à ne pas appliquer la VIR à l'opération de rénovation dès lors que celle-ci implique un agrandissement. Il faudrait entendre par là une augmentation tangible de la superficie de plancher, au sens du Code de l'urbanisme, sans tenir compte des changements de destination ayant pour effet de majorer la surface habitable définie par le CCH. Ainsi, dans un bâtiment objet d'une surélévation, même minime, il n'y aurait plus lieu de distinguer entre les appartements provenant de la partie neuve et ceux situés dans la partie ancienne. Dans cette optique, c'est l'ensemble des appartements qui dépendraient du statut de la VEFA.
Remarque
On pourrait faire observer que la préconisation de cette solution se heurte au principe général qui veut que l'accessoire doit suivre le principal. Or, l'accolement d'un édicule au pignon ou sur la terrasse d'un bâtiment ne faisant l'objet d'aucune restructuration soumettrait au régime de la VEFA tous les appartements situés dans l'immeuble. Malgré ces inconvénients, l'instauration d'un seuil ne semblerait pas déraisonnable.
Fin de remarque
34 - Méthodologie. – Lorsque l'immeuble ne fait l'objet d'aucun agrandissement, une approche globale de l'opération immobilière paraîtrait indispensable pour déterminer le régime applicable à l'ensemble de l'opération. Plutôt que de considérer isolément la vente de chaque unité d'habitation pour savoir s'il doit être traité comme un bien immobilier neuf ou comme un bien immobilier rénové, la méthode pourrait consister à analyser d'abord, de manière globale, l'ensemble de l'opération immobilière en considérant l'unique bâtiment, si elle n'en comporte qu'un, ou chaque bâtiment autonome, si elle en comporte plusieurs. Il suffirait d'appliquer ensuite à la vente de chaque appartement le régime de la VEFA ou de la VIR, sans avoir à tenir compte de sa localisation par rapport à la partie restructurée, considérée comme neuve, relevant à ce titre du régime de la VEFA, ou à la partie faisant l'objet d'une rénovation plus légère, régie par celui de la VIR.
Remarque
En conséquence, si l'opération, prise dans sa globalité, doit relever du régime de la VEFA, l'échéancier des paiements, identique pour tous les acquéreurs, sera déterminé par les stades d'exécution de l'ensemble du chantier, la ventilation du prix entre l'existant et les travaux devenant, par suite, inutile. Les fondations étant, par hypothèse, toutes achevées, le seuil de 35 % sera immédiatement exigible. Dans le cas où le régime de la VIR s'appliquerait au programme, le prix de vente de chaque unité d'habitation devrait nécessairement être ventilé entre la partie existante et la partie travaux.
Fin de remarque
35 - En conclusion. – Une observation empreinte de bon sens me permettra de conclure. Les techniciens du bâtiment, architectes et entrepreneurs, sont unanimes pour reconnaître qu'une opération de rénovation d'un immeuble existant est souvent plus complexe que la construction d'un nouveau bâtiment. Aussi ne faut-il pas s'étonner que les juristes, cherchant à accroître la sécurité et la simplicité dans les opérations de rénovation, aient été confrontés à des problèmes complexes. Depuis les années 1980 qui marquent le début de l'essor de la rénovation immobilière, le notariat n'a eu de cesse de réclamer un statut spécifique pour ce secteur d'activité. Après quelque 30 années, les pouvoirs publics ont enfin adopté les dispositions législatives et réglementaires instaurant la vente d'immeuble à rénover dont les règles sont largement inspirées par les travaux des 77e, 93e et 99e Congrès des notaires de France.
36 - Le statut actuel est assurément perfectible mais, en l'état, il peut être source d'inspiration pour les rédacteurs de contrats de vente qui, forts du rôle créatif de la formule notariale15, souhaiteraient l'adapter à des situations particulières qu'ils peuvent rencontrer. « Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage : polissez-le sans cesse et le repolissez ; ajoutez quelquefois et souvent effacez ». Ce conseil peut s'adresser, en l'espèce, au législateur afin de l'inviter à améliorer le statut de la VIR. Toutefois, les notaires peuvent aussi en faire leur profit en remettant la rénovation immobilière à l'ordre du jour d'un prochain Congrès. Mais ceci est une autre histoire que je laisse à d'autres le soin d'écrire…▪
L'essentiel à retenir
- En dépit de son intérêt, la rénovation immobilière a longtemps été dépourvue de tout statut légal.
- Le législateur a finalement instauré le régime de la vente d’immeuble à rénover, inspiré des travaux de 3 Congrès des notaires.
- Toutefois, le fait que selon l’importance des travaux à réaliser, une opération de rénovation immobilière relève tantôt du statut de la VEFA, tantôt de celui de la VIR, est encore source d’incertitudes.
Mots-clés : Immobilier
Notes
- Cité dans l'éditorial du premier numéro de la revue « Rénovation », oct. 1974, édité par le Syndicat national des rénovateurs et marchands de biens. ↩
- Allez, Recherches de solutions pratiques en matière de réhabilitation de l'habitat existant depuis l'arrêt du 28 octobre 1978 de la Cour de cassation : Dr. et ville 1979, n° 8, p. 69. – Jaquet, Les aspects juridiques et fiscaux de la rénovation des immeubles ; mémoire pour le diplôme supérieur de notariat, université de Paris II, sept. 1979. – Rupied, La réhabilitation de l'habitat ancien, amélioration et rénovation : AJPI 1981, p. 13. – Saint-Alary, Les opérations de réhabilitation de l'habitat existant (Problème de droit privé) : Dr. et ville 1979, n° 8, p. 45. ↩
- 77e Congrès, Montpellier, 1981. Rapport de la quatrième commission. Président : Jean-Paul Decorps ; rapporteur : Alain Devos. – 93e Congrès, Strasbourg, 1997. Rapport de la première commission. Président : martial Dréano ; rapporteurs : Jean-Paul Matteï et Pierre-Jean Meyssan. ↩
- Rapp. de la quatrième commission du 77e Congrès, p. 646 et s. ↩
- Cass. crim., 23 oct. 1978 : JCP N 1979, II, p. 45, note Stemmer. ↩
- Jaquet, La protection des acquéreurs d'immeubles à rénover : JCP N 1980, I, p. 119 et s. ↩
- Allez, Recherches de solutions pratiques en matière de réhabilitation de l'habitat existant depuis l'arrêt du 28 octobre 1978 de la Cour de cassation : Dr. et ville 1979, n° 8, p. 69. – Jaquet, Les aspects juridiques et fiscaux de la rénovation des immeubles ; mémoire pour le diplôme supérieur de notariat, université de Paris II, sept. 1979. – Rupied, La réhabilitation de l'habitat ancien, amélioration et rénovation : AJPI 1981, p. 13. – Saint-Alary, Les opérations de réhabilitation de l'habitat existant (Problème de droit privé) : Dr. et ville 1979, n° 8, p. 79. ↩
- Pour une étude complète voire : Bernard et Zalewski, La rénovation et le choix du contrat de vente après la loi ENL : Administrer janv. 2007, p. 29. – Golfier, Vente d'immeubles à construire et vente d'immeubles à rénover : RDI 2007, p. 31. – Herrnberger, La vente à rénover. Enfin un statut légal : JCP N 2006, n° 47, 1357. – Mallet-Bricout, Le nouveau contrat de vente d'immeubles à rénover : RDI 2007, p. 17. – Périnet-Marquet, Le nouveau régime de la vente d'immeuble à rénover : RDI 2006, p. 329. – Sizaire, Vente d'immeuble à rénover : Constr.-Urb. 2006, chron. 11. – Delesalle, Réflexions autour de la vente d'immeuble à rénover : JCP N 2008, n° 37, 1280. ↩
- Rapp. de la première commission du 93e Congrès, p. 94. ↩
- V. O. Herrnberger et T. Delesalle, Analyse thématique et approche pratique du décret n° 2008-1338 du 16 décembre 2008 relatif à la vente d'immeuble à rénover : JCP N 2009, n° 15-16, 1133. ↩
- Les développements qui vont suivre représentent, pour l'essentiel, l'opinion d'Olivier Herrnberger, exprimée dans l'article : Est-il pertinent de laisser la VIR et la VEFA coexister au sein d'une même opération immobilière ? : RDI 2024. ↩
- V. Les développements qui vont suivre représentent, pour l'essentiel, l'opinion d'Olivier Herrnberger, exprimée dans l'article : Est-il pertinent de laisser la VIR et la VEFA coexister au sein d'une même opération immobilière ? : RDI 2024. ↩
- V. Les développements qui vont suivre représentent, pour l'essentiel, l'opinion d'Olivier Herrnberger, exprimée dans l'article : Est-il pertinent de laisser la VIR et la VEFA coexister au sein d'une même opération immobilière ? : RDI 2024. L’opinion de l'auteur rejoint celle de Zalewski-Sicard : Les ventes d'immeubles à construire et à rénover : Ellipses, 2e éd., n° 52. ↩
- J.-L. Sourioux, Le rôle de la formule notariale en droit positif, thèse 1965. ↩
LES ARTICLES
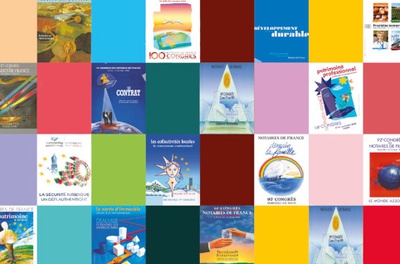
Introduction générale - Le notaire et la loi : « Et voudriez-vous… »
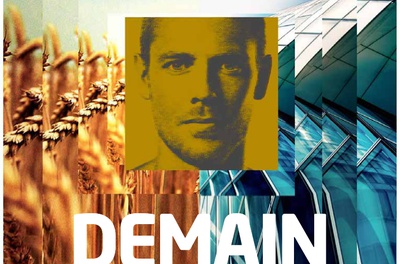
Introduction générale sur la famille
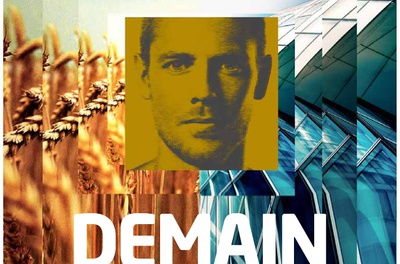
La contribution du notariat à l’amélioration du PACS
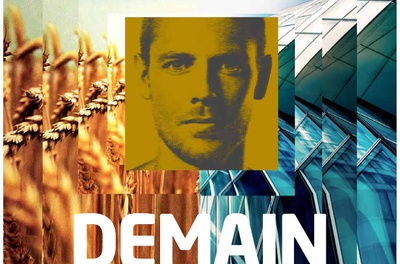
Les personnes vulnérables : quelles suites pour les propositions adoptées ?
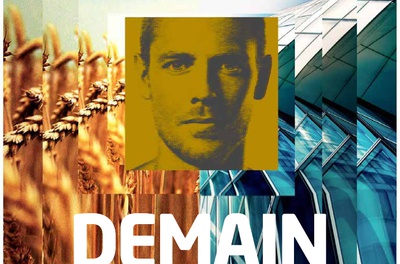
Libéralités graduelles et résiduelles : des solutions à ne pas oublier pour les personnes vulnérables
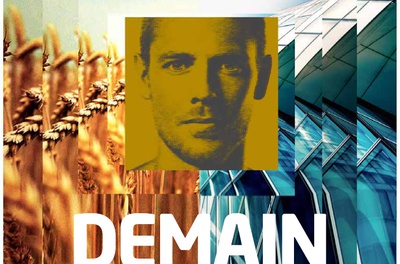
La renonciation à l'action en réduction des articles 929 et suivants du Code civil
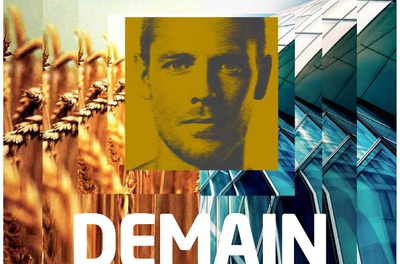
La vocation successorale égalitaire de tous les enfants
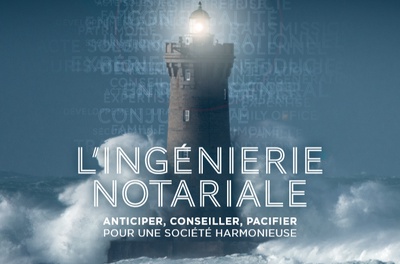
Introduction générale sur l’immobilier
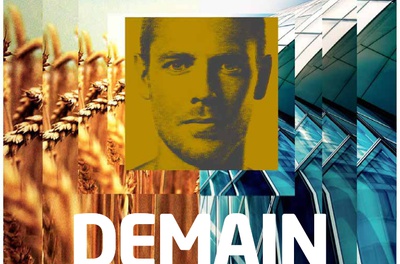
La vente d'immeuble à rénover : la suite de trois Congrès…
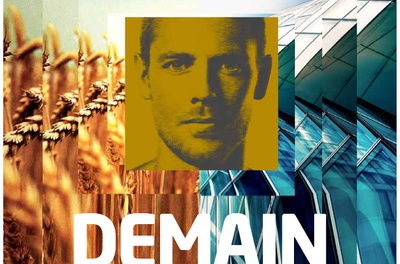
La vente en l’état futur d’achèvement : l’héritage des notaires bâtisseurs
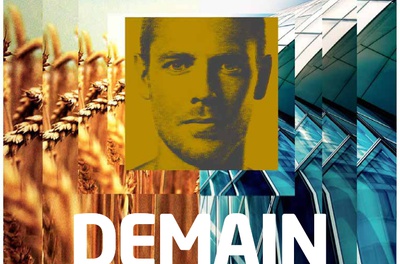
La division en volumes : l’inventivité notariale au service d’une nouvelle utilisation de l’espace
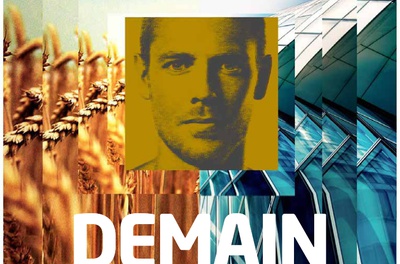
La reconnaissance par le droit de l’urbanisme du mécanisme de la prescription extinctive (C. urb., L. 421-9)
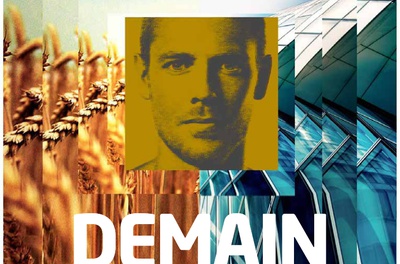
Le transfert par subrogation des accessoires garantis par l’inscription d’origine
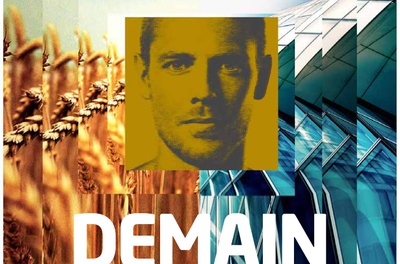
Introduction générale sur le droit public
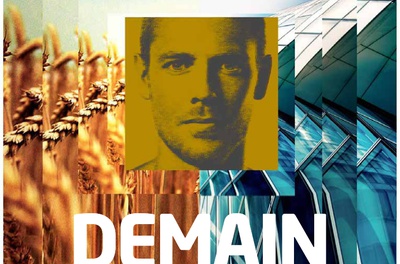
L'extension du déclassement par anticipation
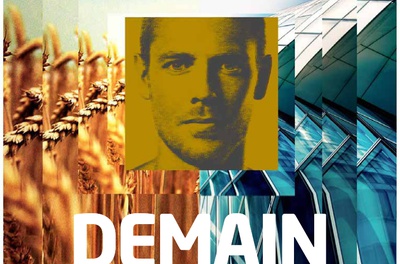
La sécurisation des droits du commerçant exploitant sur le domaine public
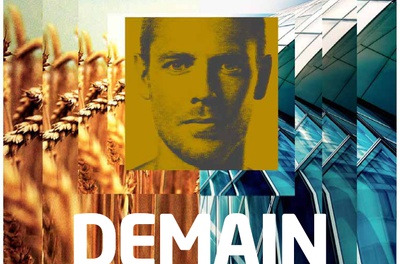
La sanction des clauses non conformes par le réputé non-écrit
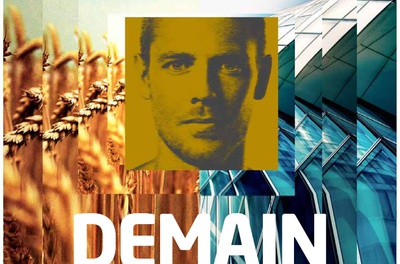
Entretien avec Jean-François Pillebout