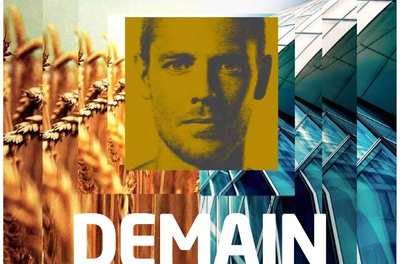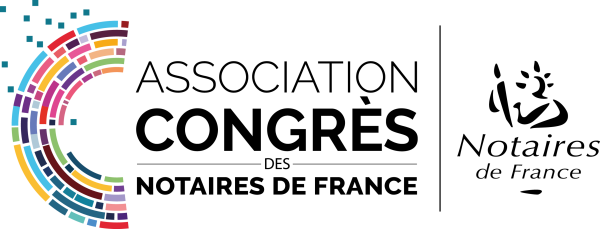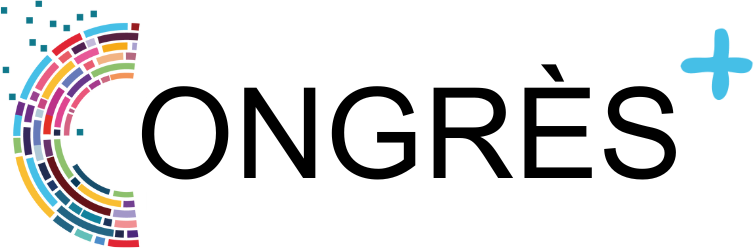Introduction générale - Le notaire et la loi : « Et voudriez-vous… »
Les apports des Congrès des notaires de France au droit
Plus de 200 textes législatifs et près de 130 règlementaires
inspirés des Congrès des notaires de France
La sécurisation des droits du commerçant exploitant sur le domaine public
109e Congrès des notaires de France, Lyon 2013
1 - Valoriser le patrimoine des personnes publiques. –Les travaux de la 3e commission du 109e Congrès des notaires de France, menés avec ma présidente Marie-Hélène Pero Augereau-Hue, sont partis d’un constat : alors que les finances publiques se dégradent, il est nécessaire que les personnes publiques valorisent leur patrimoine le plus efficacement possible.
Incontestablement titulaires d’un droit de propriété sur leurs biens, consacré par le Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) en 2006, les collectivités publiques doivent toutefois composer avec les contraintes imposées par les règles protectrices de la domanialité publique visant à protéger l’affectation principale d’un bien à l’utilité publique.
2 - Relation collectivité territoriale-commerçant exploitant. –Nos travaux ont montré que ces contraintes pouvaient être moins fortes lorsque les transferts de propriété et/ou de jouissance se produisaient entre personnes publiques. Ils ont également cherché à analyser comment s’organisaient les rapports juridiques entre une personne publique et une personne privée sous le prisme des règles de la domanialité publique.
Très vite, la relation contractuelle entre une collectivité territoriale et un commerçant exploitant son activité sur le domaine public a retenu notre attention. La différence de traitement entre celui qui vend dans un local privatif et celui qui vend sur un marché sautait en effet aux yeux :
- dans le premier cas, le commerçant est propriétaire de son fonds de commerce, son activité a une valeur économique et il peut la céder librement à son successeur dans le commerce ;
- dans le second, les choses étaient plus compliquées. Pour des raisons évidentes de bonne gestion des propriétés publiques, les collectivités qui délivrent un titre d’occupation du domaine public doivent pouvoir le retirer à tout moment dans l’intérêt général. Elles doivent conserver la libre administration de leurs biens et n’autoriser une occupation privative par un commerçant qu’à condition qu’elle soit compatible avec l’affectation à l’utilité publique. Ce qui exclut par exemple qu’un bail commercial puisse être conclu sur le domaine public.
3 - Le caractère précaire et révocable rendant instable le titre d’occupation, il apparaissait délicat pour le commerçant d’imaginer pouvoir céder son activité. Certains lui déniaient ce droit en l’absence de réelle valeur économique de son activité, d’autres en raison de son impossibilité à s’assurer que son successeur pourrait se voir délivrer le même titre d’occupation que lui.
Ce sont donc sur ces deux axes que se sont concentrées nos propositions, afin d’offrir un cadre juridique plus stable et plus sécurisant au commerçant exerçant entièrement son activité sur le domaine public.
1. La reconnaissance de l’existence d’un fonds de commerce sur le domaine public
4 - Définir le fonds de commerce. –Pour apprécier si un fonds de commerce pouvait exister sur le domaine public, il convenait au préalable de tenter de donner une définition de ce terme. La loi n’en donne aucune1. C’est dans la jurisprudence et la doctrine que l’on trouve des éléments permettant de le caractériser. Ainsi, certains auteurs ont pu définir le fonds de commerce comme un « ensemble des biens mobiliers affectés à l'exercice de l'activité commerciale »2.
La stabilité du titre d’occupation de l’exploitant apparaît comme un des éléments susceptibles de caractériser l’existence d’un fonds de commerce. Or, le bail commercial ne peut pas exister sur le domaine public et le titulaire d’une autorisation d’occupation domaniale ne bénéficie pas de la propriété commerciale. Son titre est précaire et c’est ce qui fondait, selon la jurisprudence traditionnelle du Conseil d’État, le refus de considérer qu’un fonds de commerce puisse exister sur le domaine public3.
Pourtant, d’autres décisions du juge administratif ont reconnu directement4 ou indirectement5 l’existence d’un fonds de commerce sur le domaine public.
5 - Une existence possible sur le domaine public. –Bien que le Conseil d’État soit ensuite revenu à une position de plus grande fermeté6, la réalité économique devait conduire à reconsidérer la possible existence d’un fonds de commerce sur le domaine public. Juridiquement, limiter la notion de fonds de commerce à un titre d’occupation stable serait erroné. En effet, comme nous l’avons indiqué ci-dessus, la définition du fonds de commerce recouvre en pratique des éléments très variés et le juge judiciaire a régulièrement reconnu l’existence d’un fonds de commerce sans qu’existe un droit au bail. À cet égard, il convient de souligner l’évolution jurisprudentielle de la notion et des éléments susceptibles de caractériser l’existence d’un fonds de commerce. Ainsi, après avoir longtemps considéré le droit au bail comme un élément essentiel du fonds de commerce, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu en affirmé : « quelle que soit son importance, le droit au bail ne constitue pas, de plein droit, un élément nécessaire du fonds qui peut exister en dehors de lui »7.
6 -Nécessaire clientèle propre. –Selon le juge civil, ce qui caractérise réellement et de façon constante le fonds de commerce, c’est l’existence d’une clientèle propre à l’exploitant. Il n’y a pas de fonds de commerce s’il n’y a pas ou plus de clientèle8.
La question rebondissait donc : l’exploitant d’une activité commerciale sur le domaine public est-il propriétaire de sa clientèle ?
La réponse à cette question dépend nécessairement des éléments de fait. Par exemple, « il semble difficilement contestable qu'une simple buvette installée dans l'enceinte d'une gare ne dispose pas d'une clientèle distincte de celle de la gare. Mais il est tout aussi indiscutable que tel grand restaurant, installé gare de Lyon, attire par ses qualités intrinsèques, attestées le cas échéant par sa notation dans les guides gastronomiques, une clientèle qui lui est personnelle »9.
Remarque
En pratique, une telle difficulté peut être rencontrée à propos des bancs des halles ou des emplacements de marché. Si la clientèle dispose d’un choix entre plusieurs professionnels, il apparaît qu’elle choisit l’un d’entre eux et qu’elle est donc attachée à ses qualités. C’est ce qu’a considéré le juge civil qui a eu l’occasion de reconnaître l’existence d’un fonds de commerce exploité sur le domaine public à propos d’emplacements sur des marchés municipaux10.
C’est ainsi que je n’avais de cesse d’expliquer à notre rapporteur général, Marc-Henri Louvel, que l’un des poissonniers exerçant sous les halles de Cholet jouissait d’une très grande notoriété et qu’il concentrait la grande majorité des clients malgré la concurrence d’autres poissonniers présents sous les mêmes halles ! Cet exemple tiré de ma pratique l’a tellement marqué qu’il m’en parle encore !
Fin remarque
7 - Malgré l’absence de bail commercial et en raison de la possible reconnaissance d’une clientèle propre à l’exploitant, il apparaissait donc envisageable de reconnaître plus généralement l’existence d’un fonds de commerce sur le domaine public. Une telle reconnaissance apparaissait comme une avancée en termes de sécurité juridique pour les exploitants ainsi que leurs conseils.
Cette solution avait d’ailleurs été dégagée pour les exploitants dans les marchés d’intérêt national. En effet, le droit d’occupation privative desdits exploitants pouvait être inclus dans le nantissement d’un fonds de commerce (C. com., art. L. 761-9).
8 - Spécificités du fonds de commerce sur le domaine public.– L’existence d’un fonds de commerce sur le domaine public nécessitait bien entendu une adaptation de nos pratiques à la spécificité de la situation. Ainsi, le caractère personnel et précaire de l’autorisation d’occupation domaniale est un paramètre intangible dont le notaire doit tenir compte. En pratique, la cession du fonds de commerce intervient sous la condition suspensive de la délivrance, au profit du cessionnaire, d’une nouvelle autorisation par la collectivité publique.
Il résultait de ce raisonnement que la reconnaissance de l’existence d’un fonds de commerce sur le domaine public n’était pas insurmontable juridiquement. Cela contribuait à permettre aux exploitants de revendiquer une indemnisation plus importante en cas de retrait de leur autorisation d’occupation du domaine public. Cela permettait en parallèle aux collectivités publiques d’inciter les commerçants à s’installer et à dynamiser le territoire. Indéniablement, toute l’économie locale y trouvait un intérêt. Enfin, la redevance domaniale due par l’occupant étant proportionnelle aux avantages de toute nature dont il bénéficie, l’amélioration de sa situation juridique ne pouvait qu’entraîner une augmentation de la redevance et assurer une meilleure valorisation du patrimoine des collectivités publiques.
9 - C’est ce qui nous a conduits à proposer en séance « que le titre d’occupation délivré à un commerçant exploitant son activité en totalité sur le domaine public soit reconnu comme un élément constitutif d’un fonds de commerce, dès lors que l’existence de ce fonds est caractérisée par une clientèle propre à l’exploitant ».
Cette proposition a été bien accueillie par nos confrères présents à Lyon. Par leurs interventions, ils ont confirmé que la valeur économique d’une activité exploitée sur le domaine public était une réalité en pratique et qu’il convenait de la consacrer juridiquement. Ils ont même regretté pour certains que cette proposition n’aille pas plus loin, notamment en l’étendant aux activités rurales. D’autres ont confirmé notre analyse en souhaitant un rapprochement avec la situation existant sur les marchés d’intérêt national.
Les praticiens et la doctrine semblant unanimes, il n’a pas fallu attendre longtemps avant que le législateur ne consacre l’essentiel de cette proposition.
L’article 72 de la loi n° 2014-626 du , dite « loi Pinel », introduisit presqu’un an jour pour jour après notre Congrès les articles L. 2124-32-1 et suivants dans le CGPPP.
La rédaction de l’article L. 2124-32-1 n’est d’ailleurs pas sans rappeler les termes de notre proposition : « Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre ».
On le voit, la loi ne va pas jusqu’à reconnaître que le titre d’occupation est un élément de ce fonds de commerce comme nous le demandions11. A fortiori, elle ne prévoit pas qu’il puisse être donné en nantissement.
10 - Toutefois, d’autres dispositions de cette loi sont venues conforter les praticiens en permettant notamment au candidat acquéreur de ce fonds de commerce de solliciter la délivrance d’un titre d’occupation du domaine public de manière anticipée, permettant ainsi de sécuriser la cession du fonds de commerce conclue sous condition suspensive de cette délivrance (CGPPP, art. L. 2124-33).
Ces éléments allaient dans le sens de l’autre branche de notre proposition visant à faciliter la transmission du titre d’occupation du domaine public par l’exploitant.
2. La possibilité de présenter son successeur à l’Administration
11 - Faciliter et sécuriser la cession du fonds. –Notre proposition ne visait pas seulement à reconnaître l’existence d’un fonds de commerce sur le domaine public, elle avait également pour objectif d’en faciliter et d’en sécuriser la cession.
C’est pourquoi, elle se poursuivait ainsi : « que dans cette situation, le titre d’occupation du domaine public puisse être cédé au successeur dans le commerce, sous réserve d’un agrément préalable délivré par la collectivité propriétaire ».
Nous poursuivions ainsi notre logique d’alignement du régime du commerçant exploitant son activité sur le domaine public sur celui applicable dans les marchés d’intérêt national.
12 - Possibilité de présenter le successeur…– En effet, il était déjà admis que les commerçants puissent présenter un successeur à l’agrément de l’administration dans ces marchés particuliers12.
L’exposé des motifs de notre proposition rappelait cependant que la personne publique devait pouvoir, pour un motif lié à l’intérêt du domaine occupé, conserver la faculté de s’opposer au renouvellement du titre, ainsi qu’à sa cession, et le retirer à tout moment.
Nous n’avions pas pour objectif de remettre en cause le caractère précaire et révocable de ladite autorisation d’occupation du domaine public, qui par définition, est temporaire.
C’est l’article 71 de la loi Pinel, codifié à l’article L. 2224-18-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), qui a consacré notre proposition dans les termes suivants : « sous réserve d'exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de trois ans, le titulaire d'une autorisation d'occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. Cette personne, qui doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, est, en cas d'acceptation par le maire, subrogée dans ses droits et ses obligations ».
13 - … Limité au cas de la halle ou du marché. –Alors que nous proposions que cette faculté soit offerte à tous les commerçants justifiant de l’existence d’un fonds de commerce sur le domaine public, la loi a limité cette possibilité de présenter son successeur à l’agrément de l’Administration aux seules personnes exerçant dans une halle ou un marché.
Lorsque l’activité commerciale n’est pas exploitée dans une halle ou un marché, l’exploitant ne peut pas invoquer ce texte. Il peut en revanche conseiller à son cessionnaire de solliciter la délivrance anticipée d’un titre d’occupation dans les conditions évoquées ci-dessus.
Les règles de 2014, adoptées dans la foulée de notre Congrès, n’étaient pas en tous points conformes à nos attentes. Toutefois, elles nous donnaient entière satisfaction en offrant les outils juridiques nécessaires à la reconnaissance du fonds de commerce sur le domaine public et à sa cession sécurisée.
14 - Nouvelles règles depuis 2017. – C’était sans compter sur les normes européennes qui ont amené la France à modifier en profondeur les modalités de délivrance des titres d’occupation sur le domaine public lorsqu’il est le siège d’activités commerciales.
Les nouvelles règles, issues de l’ordonnance n° 217-562 du 19 avril 2017, sont désormais codifiées aux articles L. 2122-1-1 à L. 2122-1-4 au CGPPP.
Lorsque le titre d’occupation a pour but de permettre l’utilisation d’une dépendance du domaine public en vue d’une exploitation économique (activité génératrice de recettes), « l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ».
15 - Cette nouvelle procédure n’est toutefois pas applicable aux activités foraines de courte durée (moins de 4 mois)13, quand le nombre de titres disponibles n’est pas limité, lorsque l’urgence le justifie (dans ce cas la durée du titre ne peut excéder un an) ou encore lorsque le titre a pour seul objet de proroger une autorisation existante.
De la même façon, l’article L. 2122-1-3 du CGPPP vise certaines hypothèses dans lesquelles cette procédure n’a pas à être respectée, dans la mesure où elle est impossible ou non justifiée. Ces situations, au nombre de cinq, ne sont pour autant pas limitatives. On peut citer par exemple le cas où le pétitionnaire est le seul en droit d’occuper la dépendance concernée ou lorsque la première publicité est restée infructueuse. Il s’agit bien d’une situation exceptionnelle dans l’esprit du législateur qui impose dans cas à la personne publique de justifier des circonstances expliquant l’absence de respect de la procédure de mise en concurrence.
Enfin, lorsque la délivrance du titre fait suite à une sollicitation spontanée d’une personne, l’article L. 2122-1-4 du CGPPP prévoit que la personne publique ne peut le conférer qu’après s’être assuré au moyen d’une publicité adéquate que personne d’autre n’est susceptible d’être intéressé.
16 - Combinaison des règles de 2014 et 2017 : difficulté pratique. –Nous sommes désormais confrontés à une nouvelle difficulté pratique : combiner les règles de 2014 avec celles postérieures de 2017. Le gouvernement affirme que les règles issues de l’ordonnance de 2017 ne doivent pas faire obstacle à la procédure applicable dans les halles et marchés qui permet à l’exploitant de présenter son successeur à l’Administration14, dans la mesure où le successeur est ici subrogé dans les droits du titulaire de l’autorisation15, et à condition bien entendu que le cédant dispose d’une clientèle qui lui est propre16. Il en va différemment à notre sens du cas de la cession d’un fonds de commerce exploité sur le domaine public mais hors des marchés et halles. Ici, le successeur est simplement habilité à solliciter par anticipation une nouvelle autorisation et il ne semble pas possible de s’exonérer des règles de mise en concurrence.
Nous pouvons au mieux nous trouver dans un cas où la procédure est allégée parce que l’on considère que le successeur dans le commerce agit par « sollicitation spontanée ».
Remarque
On le voit, le diable se niche dans les détails ! Même si notre Congrès a sans doute contribué à faire évoluer favorablement les textes, il faut sans cesse remettre l’ouvrage sur le métier et poursuivre nos efforts pour alerter le législateur sur les effets méconnus des textes qui percutent notre pratique…
Fin remarque ▪
L’essentiel à retenir
- Avant le 113e Congrès des Notaires de France, l’exploitation d’une activité commerciale sur le domaine public était source de précarité.
- Notre proposition visait à reconnaître l’existence d’un fonds de commerce en présence d’une clientèle propre à l’exploitant.
- La loi Pinel du 18 juin 2014 a consacré cette reconnaissance d’un fonds de commerce à certaines conditions.
- Les droits patrimoniaux des commerçants s’en sont trouvés sécurisés sans renier le contrôle exercé par la personne publique.
- Notre proposition soutenait également la possibilité pour le commerçant de présenter son successeur à l’Administration.
- La loi a toutefois limité cette faculté aux commerçants exploitant dans une halle ou un marché.
- Les règles en vigueur depuis 2017 réformant la procédure de délivrance des autorisations d’occupation du domaine public posent de nouvelles difficultés pratiques.
Mots-clés : Domaine public - Fonds de commerce - Congrès des notaires
Notes
- J. Mestre et M.-E. Pancrazi, Droit commercial : LGDJ, 28e éd., 2009, n° 686, p. 583. ↩
- CE, 28 avr. 1965, Sté X. : « Considérant qu'eu égard notamment au caractère précaire et révocable de ladite autorisation [d'occupation temporaire du domaine public], dont le retrait pourrait contraindre le requérant à mettre fin sans indemnité à l'exploitation de l'établissement litigieux, celui-ci ne saurait être regardé comme un fonds de commerce dont la société X. serait propriétaire » : D. 1965, p. 655. ↩
- CE, 20 janv. 2005, n° 276475 : JurisData n° 2005-067925, Cne Saint-Cyrpien : en l’espèce, les juges constatent que l’occupant du domaine public avait perdu sa clientèle du fait de la fermeture de son établissement et que son fonds de commerce n’avait donc plus aucune valeur indemnisable. ‒ CE, 21 déc. 2006, n° 268575, Lemonnier. ↩
- CE, 25 nov. 1981, Cne La Roche-sur-Foron : JurisData n° 1981-041367. ‒ Un exploitant d’un cinéma situé dans une salle des fêtes dépendant du domaine public a cédé son fonds de commerce à un nouvel exploitant. Ce dernier n’ayant pas signé de nouvelle convention d’occupation du domaine public avec la commune propriétaire de la salle, doit être considéré comme un occupant sans titre. La cession du fonds de commerce n’est pas contestée en tant que telle. ↩
- CE, 19 janv. 2011, Cne Limoges : JurisData n° 2011-000410. ‒ « Considérant, d'une part, qu'eu égard au caractère révocable, pour un motif d'intérêt général, d'une convention portant autorisation d'occupation du domaine public, ainsi que du caractère personnel et non cessible de cette occupation, celle-ci ne peut donner lieu à la constitution d'un fonds de commerce dont l'occupant serait propriétaire ». ↩
- Cass. com., 27 avr. 1993, Cts Schertzer c/ Walter : RTD com. 1993, p. 488, obs. J. Derruppé. ↩
- Cass. com., 31 mai 1988 : JurisData n° 1988-001987. – 105e Congrès des Notaires de France, Les propriétés incorporelles, Lille 2009, art. 4224 et s. ↩
- O. de David Beauregard Berthier, Fonds de commerce et domaine public : AJDA 2002, p. 790. ↩
- CA Poitiers, 3 juill. 1963, Beaufils c/ Mainson : D. 1964, Somm., p. 23. ↩
- C’est ce que rappelle expressément la circulaire n° EINI1514436C du 15 juin 2015 visant à détailler les modalités d’application pratique de cette loi. ↩
- D. n° 2007-431, 25 mars 2007, art. 3, modifiant le décret du 19 décembre 2005 relatif aux marchés d'intérêt national. ↩
- Instr. n° INTA1919298J, 22 juill. 2019. ↩
- Présentation qui ne peut être informelle ou tacite. En ce sens : CAA Bordeaux, 6 juill. 2023, n° 21BX01996 : JCP A 2023, 2325, note C. Roux. ↩
- Rép. min., 4 déc. 2018 : JOAN, p. 11021. ↩
- TA Lyon, 6 juill. 2020, n° 1800990 : JurisData n° 2020-012357. ↩
LES ARTICLES
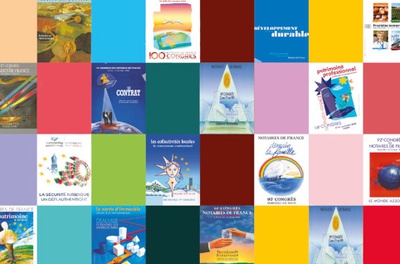
Introduction générale - Le notaire et la loi : « Et voudriez-vous… »
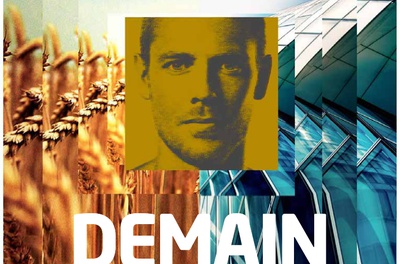
Introduction générale sur la famille
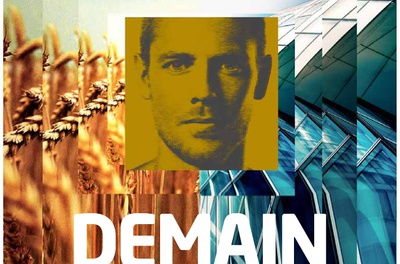
La contribution du notariat à l’amélioration du PACS
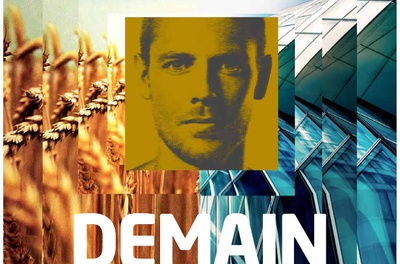
Les personnes vulnérables : quelles suites pour les propositions adoptées ?
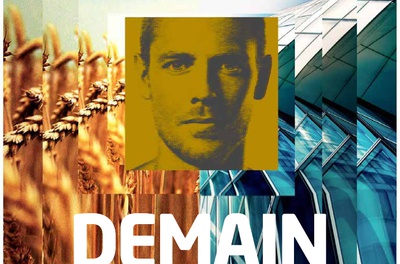
Libéralités graduelles et résiduelles : des solutions à ne pas oublier pour les personnes vulnérables
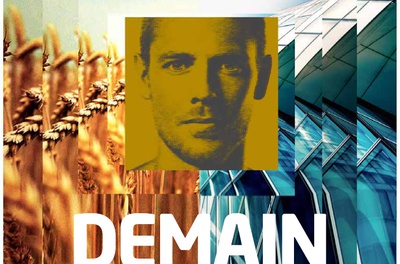
La renonciation à l'action en réduction des articles 929 et suivants du Code civil
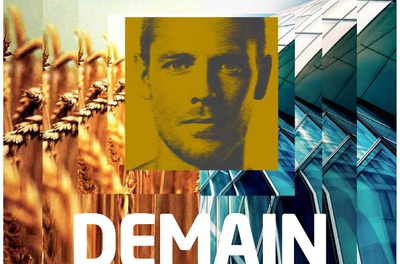
La vocation successorale égalitaire de tous les enfants
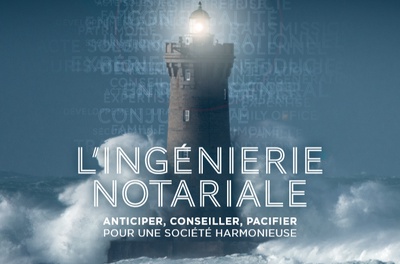
Introduction générale sur l’immobilier
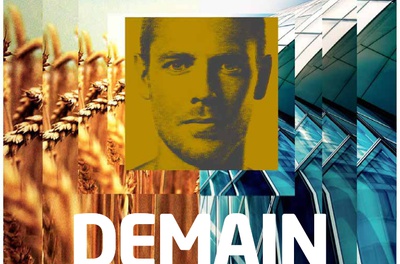
La vente d'immeuble à rénover : la suite de trois Congrès…
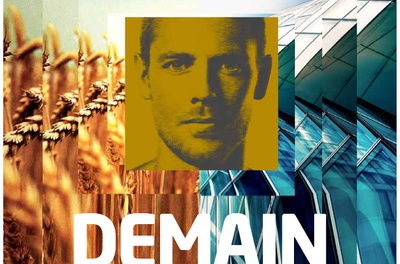
La vente en l’état futur d’achèvement : l’héritage des notaires bâtisseurs
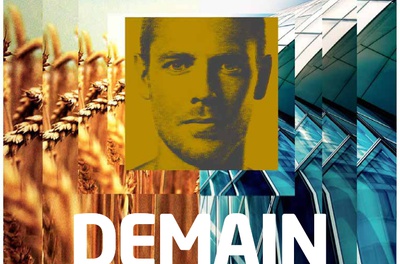
La division en volumes : l’inventivité notariale au service d’une nouvelle utilisation de l’espace
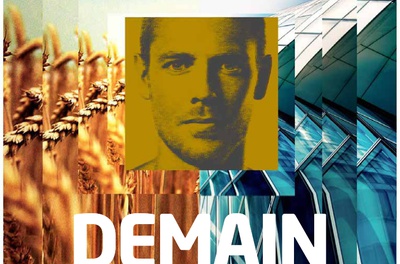
La reconnaissance par le droit de l’urbanisme du mécanisme de la prescription extinctive (C. urb., L. 421-9)
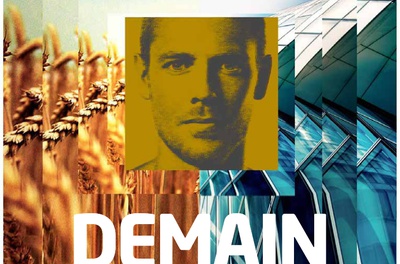
Le transfert par subrogation des accessoires garantis par l’inscription d’origine
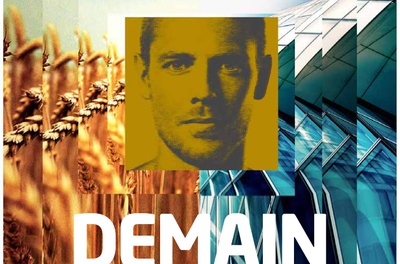
Introduction générale sur le droit public
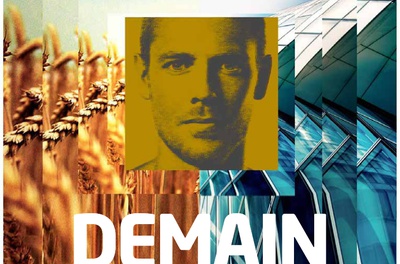
L'extension du déclassement par anticipation
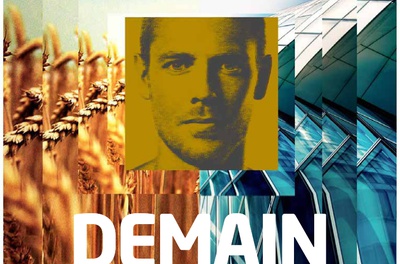
La sécurisation des droits du commerçant exploitant sur le domaine public
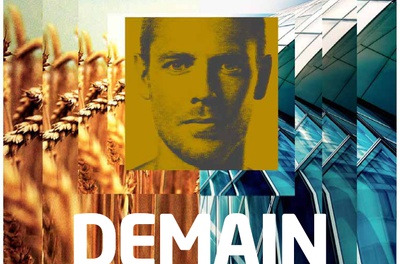
La sanction des clauses non conformes par le réputé non-écrit
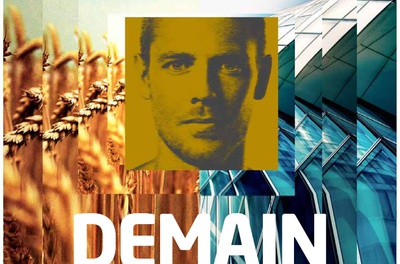
Entretien avec Jean-François Pillebout