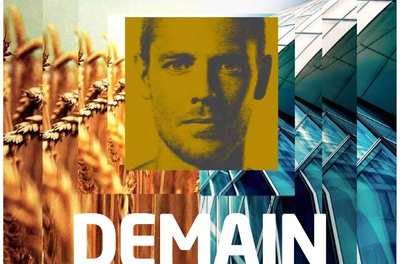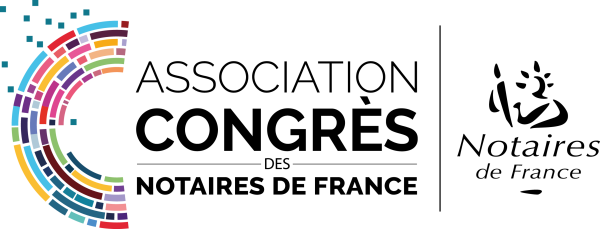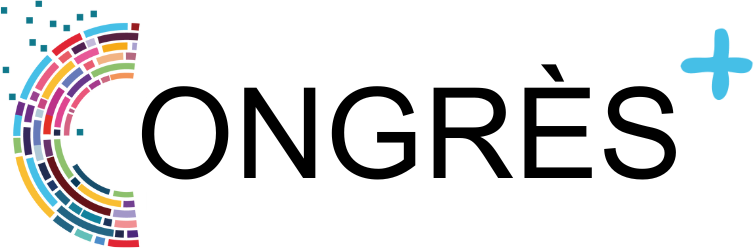Introduction générale - Le notaire et la loi : « Et voudriez-vous… »
Les apports des Congrès des notaires de France au droit
Plus de 200 textes législatifs et près de 130 règlementaires
inspirés des Congrès des notaires de France
La division en volumes : l’inventivité notariale au service d’une nouvelle utilisation de l’espace
103e Congrès des notaires de France, Lyon, 2007 | 112e Congrès des notaires de France, Nantes, 2016
1 -Contexte. – La division d’un immeuble en volumes constitue l’un des exemples les plus marquants du fruit des réflexions nées de la pratique notariale au cours du siècle passé. Deux noms sont gravés sur l’édifice juridique de la volumétrie : Claude Thibierge, notaire à Paris1 et Jean Cumenge, directeur juridique de l’Établissement public pour l’aménagement de la région de la défense (EPAD). Tous deux ont été confrontés, avec d’autres2, à des difficultés juridiques d’une ampleur nouvelle lors de l’aménagement du quartier d’affaires de l’ouest parisien au début des années 1960. C’est en effet au cours de cette période qu’ont fleuri des opérations immobilières d’un nouveau genre et d’une ampleur inédite. Paris est ainsi le témoin de plusieurs grands chantiers. Outre le quartier de La Défense, une opération immobilière d’envergure est engagée au carrefour des 6e, 14e et 15e arrondissements de Paris avec l’aménagement du secteur Maine-Montparnasse, qui accueillera notamment la Tour Maine-Montparnasse, inaugurée le 18 juin 1973.
2 -Problématiques. – Les difficultés se sont présentées avec une acuité particulière à La Défense. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer la situation telle qu’elle existe aujourd’hui. Comment organiser juridiquement cet enchevêtrement et superposition de routes, d’autoroutes, de plusieurs lignes de train, RER, métro, de parkings, de voies piétonnes, d’écoles, de crèches, de commissariats, de centres commerciaux, d’entrepôts, d’immeubles de bureaux, d’immeubles d’habitation et de toutes leurs dépendances ? Comment concilier sur une même assiette foncière des droits de propriété de nature différente, des biens appartenant au domaine public, des biens appartenant à des personnes privées, différentes copropriétés d’immeubles bâtis dont les usages sont multiples ? En somme, quelle organisation juridique retenir pour une utilisation optimisée d’un espace contraint ?
3 -Une réponse : la division en volumes. – Dans un certain silence des textes et face à l’inadéquation des outils existants, sous la plume de notaires au rang desquels le premier fut Claude Thibierge, est né la volumétrie encore appelée division en volumes. Réponse de la pratique notariale à un nouveau besoin d’organisation juridique des centres urbains de plus en plus denses, cette technique est aujourd’hui devenue un incontournable pour tout professionnel du droit immobilier. Elle s’est considérablement développée au cours de ces dernières décennies3. Au gré des besoins, des actes notariés et des propositions du Congrès des notaires de France, la technique s’est forgée et précisée. Pour comprendre la naissance de ce nouveau régime juridique, un retour aux origines est nécessaire (1). Il permettra ainsi de mieux cerner l’héritage de cette pratique notariale (2).
1. La naissance de la division en volumes
4 -Une conception horizontale du droit de propriété. – Pour offrir une nouvelle réponse aux différentes problématiques énoncées, concevoir différemment l’objet du droit de propriété immobilier a été nécessaire. Traditionnellement, le droit de propriété d’un bien immobilier était conçu pour s’exercer sur un terrain délimité que l’on peut encore appeler une parcelle, un clos, un fonds, un sol. Plusieurs synonymes pour exprimer une même idée : la chose immobilière s’identifie par les deux dimensions que sont la longueur et la largeur, autrement dit, par des mètres carrés. L’article 552 du Code civil, qui ouvre la section intitulée « Du droit d’accession relativement aux choses immobilières », commence par évoquer « la propriété du sol ». Cette conception horizontale du droit de propriété a été renforcée par la pratique de l’établissement de plans en deux dimensions. En réalité, cette représentation géométrique plane des biens immobiliers et leurs abstractions en numéros et chiffres sur un plan ne ressort pas d’une nécessité pratique mais d’un besoin fiscal. La pratique, en effet, se satisfaisait fort bien de limites de propriété ou plutôt de délimitations des terres entre voisins que le Code civil envisage sous le nom de bornage. Ces bornes n’étaient pas destinées à établir, par regroupement, des plans4. C’est le cadastre, document fiscal, qui, pour le calcul des impôts fonciers a progressivement porté sur un plan toutes les propriétés immobilières. La loi du 15 décembre 1807 a ainsi classé selon une nouvelle méthode les immeubles, dépassant leur réalité concrète pour les représenter par un numéro abstrait. Le cadastre napoléonien est ainsi né et fut ensuite rénové, remanié, informatisé5.
Remarque
La pratique notariale s’est arrogé cette nouvelle technique et, progressivement, des pans entiers du droit immobilier se sont appuyés dessus. En effet, le plan cadastral et ses références ont permis de réaliser la dernière réforme majeure de la publicité foncière, opérée par les décrets des 4 janvier et 14 octobre 1955. Depuis, les registres sont tenus par référence aux personnes mais aussi par référence aux parcelles cadastrales. Tout ceci a fini par faire oublier l’existence de la troisième dimension de l’objet du droit de propriété immobilier.
Fin remarque
5 -Le dépassement théorique : une conception horizontale et verticale. – Il serait faux d’affirmer que le Code civil de 1804 n’ait conçu l’objet du droit de propriété immobilier que par référence au sol. En effet, le code napoléonien ne s’arrête pas à cette considération horizontale de l’objet de la propriété immobilière. L’article 552 n’évoque pas que la propriété du sol. Mieux, il dispose que cette « propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ». Autrement dit, une troisième dimension est bien prise en compte puisque s’ajoute une appréhension de l’espace au-dessus du sol et en dessous. Il n’est pas question que de mètres carrés, il est aussi question de mètres cubes. Le doyen Savatier s’exprimait ainsi dès 1958 au sujet de l’article 552 : « Mathématiquement, la loi, par cette formule, substitue, à une surface, un volume : celui qu'enferme, selon les cas, une pyramide ou un cône dont le sommet se placerait au centre de la terre, et dont la section, au niveau de l'écorce terrestre, serait la parcelle cadastrale. Au-delà de l'écorce terrestre, cette pyramide ou ce cône se prolongerait indéfiniment dans l'espace »6.
6 - Toutefois, des limites à cette conception apparaissent immédiatement. Considérer l’espace de manière illimitée dépasse l’échelle humaine et le droit de « propriété de l’espace »7 n’a de réalité que lorsqu’il est matérialisé par des constructions qui donnent alors au droit de propriété un relief concret. Or, à la différence du sol, immuable et perpétuel que l’on peut représenter géométriquement sur un plan ayant les mêmes caractéristiques, le doyen Savatier soulignait que les constructions, qui sont par nature éphémères, ne sont pas représentées en pratique avec la même méthode géométrique que le sol, méthode qu’il qualifie même « d’idéale ». Il ne s’était pas résigné à cette situation de fait puisqu’il considérait qu’il ne s’agissait là que de contraintes matérielles de représentation de l’espace et des objets immobiliers. Précurseur, il affirmait alors en 1958 qu’on « pourra, si des lois ne s'y opposent pas, acquérir l'habitude de traiter l'espace comme une sorte de chose susceptible d'être appropriée et vendue “au cubage”, étant individualisée sur une figure de géométrie cotée ou descriptive, établie à partir du sol. Cette individualisation de l'espace permettraitainsi de l'assimiler à un corps certain. Le propriétaire de la parcelle cadastrée sur le sol se mettrait alors à vendre des mètres cubes d'espace au-dessus et au-dessous des parcelles qui lui appartiennent, mètres cubes que les parties délimiteraient sur plans, à la verticale et à l'horizontale. Une telle évolution n'a rien d'impossible ».
7 -Un précédent : le régime de la copropriété des immeubles bâtis. – La matérialisation en deux dimensions des objets immobiliers depuis le début du XIXe siècle ne veut pas dire pour autant qu’il n’ait jamais été question de considérer plusieurs droits de propriété sur une construction établie sur un même sol. Répondant au besoin de répartir en milieu urbain la propriété d’un même immeuble, la copropriété des immeubles bâtis, déjà connue à Babylone8, en témoigne. Plus précisément, il est question de la représentation qui est faite de l’objet du droit de propriété. Dans le régime de la copropriété, les différents droits de propriété ont été répartis par étages, puis par appartements, puis par lots, mais toujours selon une considération de la construction en deux dimensions et avec une répartition plus ou moins scrupuleuse de ce qui est privatif et commun. Le sol doit lui rester commun à tous les copropriétaires. La propriété des structures et superstructures n’est alors considérée en pratique, dans les états descriptifs de division, que par référence à des constructions bien identifiées.
La répartition de plusieurs droits de propriété sur une même assiette foncière était donc déjà connue par la figure de la copropriété, réglementée sommairement par l’ancien article 664 du Code civil en 1804, abrogé par la loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartements, lui substituant un régime plus complet, lui-même perfectionné par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, telle que nous la connaissons aujourd’hui9.
Remarque
Ce régime de la copropriété, même sommaire au lendemain de l’adoption du Code civil, a toujours aménagé les dispositions de l’article 552 avec deux particularités notables10 :
1° chaque copropriétaire ne dispose que de droits indivis sur le sol ;
2° le droit d’accession généré par la propriété indivise du sol s’opère non pas abstraitement pour une quote-part de toutes les constructions mais à titre privatif sur une partie définie conventionnellement. Ce système a pu être qualifié « d’accession organisée »11.
Fin remarque
8 -Un précédent inadapté. – Dans ce cadre, pourquoi le notariat n’a tout simplement pas appliqué le régime de la copropriété aux nouveaux ensembles immobiliers complexes ? Pour s’en tenir au cas de La Défense, cette technique juridique présentait au moins deux inconvénients majeurs qui ne pouvaient pas être surmontés par de simples aménagements du régime existant de la copropriété.
Le premier obstacle consiste en l’imbrication de propriétés privées et de propriétés dépendantes du domaine public sur une même assiette foncière. En effet, les programmes immobiliers privés du centre du quartier d’affaires ont été édifiés en même temps et parfois par superposition sur des équipements affectés à l’usage du public tels que les dalles piétonnes, les routes, les transports en commun, les écoles, etc. qui sont demeurés la propriété d’une personne publique (initialement l’EPAD) et rattachés au domaine public puisque affectés à l’usage du public ou à un service public12. Il était déjà acquis que les règles de droit privé de la copropriété étaient incompatibles avec les règles de la domanialité publique. Le domaine public étant inaliénable et imprescriptible, il ne pouvait être question de répartir la propriété du sol de manière indivise entre le domaine public et des propriétaires privés.
La seconde contrainte tient à ce que la définition et la répartition des parties communes et des parties privatives s’impose avec une certaine précision dès la naissance de la copropriété, c’est-à-dire, au jour où le propriétaire initial n’est plus le seul maître à bord. Cela ne veut pas dire que le statut de la copropriété n’est adapté qu’aux immeubles déjà bâtis. Il est tout à fait possible d’anticiper l’application de ce régime juridique pour des immeubles à construire. Mais il faut alors établir un état descriptif de division suffisamment précis dès l’origine et avoir fixé de manière définitive les caractéristiques des constructions à édifier13.
En particulier, il faut pouvoir dresser des plans matérialisant avec précision la répartition des lots et, selon leur consistance, la quote-part de parties communes pourra être déterminée. Or, pour le centre du quartier de La Défense, imaginer dès la cession du premier lot et dans les détails la consistance de chaque immeuble à l’avance était impossible. Ceux-ci ont été adaptés au fur et à mesure des cessions et des constructions, par chaque opérateur privé. Autant dire qu’il était matériellement impossible de prévoir un état descriptif de division de l’ensemble des constructions à venir, sauf à déterminer de manière arbitraire et contestable les lots et les quotes-parts des parties communes. Seul un cadre était prévu par les cahiers des charges pour les constructions. Le contenu des constructions s’est précisé au fur et à mesure de leur réalisation.
9 - La solution : la division en volumes. – C’est pour cet ensemble de raisons que le régime juridique de la copropriété a dû être écarté et qu’il a fallu en trouver un autre pour scinder dans l’espace l’objet du droit de propriété. Ce nouveau régime de division de l’immeuble est la volumétrie. Elle a pour trait caractéristique de se détacher de toute référence au sol et se garder de créer une quelconque indivision ou démembrement de propriété entre les lots de volume. L’objet du droit de propriété est alors appréhendé comme un ou plusieurs cubes, pouvant se superposer les uns aux autres comme l’imaginait Savatier. Ces espaces en trois dimensions sont libres de tout contenu et définis librement par la volonté des parties grâce à un système de cotes altimétriques et planimétriques.
10 - Le fondement de la division en volumes. – Le fondement communément admis de la division en volumes est constitué par l’article 552 du Code civil14. Le texte établi le principe de l’accession qui consiste à faire dépendre la propriété des constructions de la propriété du sol lui-même. Il s’agit même d’une présomption : par principe, les constructions appartiennent au propriétaire du sol. Mais il peut en aller conventionnellement autrement, la liberté contractuelle des parties étant de mise. Ainsi que le rappellent les travaux de la deuxième commission du 103e congrès des notaires : « le principe de l'accession de l'article 552 du Code civil est une présomption simple ; les articles 553 à 555 prévoient certaines dérogations consacrant ce que l'on appelle communément le droit de superficie. C’est sur le droit de superficie, par dérogation à l'article 552 du Code civil, qu'est fondée la division en volumes »15.
11 - La mise en application pratique. – Les fondations conceptuelles et théoriques étant posées, il restait à mettre en œuvre ces principes, alors novateurs au début des années 1960. Ce fut l’œuvre de Claude Thibierge qui eut à rédiger les premiers actes notariés dans le cadre de l’aménagement de La Défense à l’initiative de l’Établissement public pour l’aménagement de la région de La Défense (EPAD). Cette mise en application fut réalisée en plusieurs temps. D’abord, un cahier des charges du lotissement identifiant horizontalement plusieurs parcelles, appartenant alors à l’EPAD, fut rédigé en 1962 sous sa plume. Ensuite, les lots du lotissement, considérés horizontalement, ont pris un relief au gré des cessions consenties par l’EPAD aux différents promoteurs privés. Il ne s’est pas agi de céder simplement les parcelles du lotissement mais plutôt des volumes définis par un « seuil haut » et un « seuil bas », avec des références aux dalles, comme on peut le lire dans un cahier des charges complémentaire de 1965. Ce dernier concerne la zone dénommée « A », c’est-à-dire celle qui a concentré les difficultés, car se trouvant à l’intérieur de l’actuel boulevard Patrick Devedjian entourant le centre le plus dense du quartier d’affaires. Les états descriptifs de division en volumes, définis par références à des dalles, elles-mêmes cotées dans l’espace au moyen de la norme NGF16 furent ainsi déclinés au gré des cessions. Une association syndicale urbaine fut également constituée pour compléter le montage, avec constitution de diverses servitudes (passage, accroche, écoulements, etc.).
Comme le souligna André Pône, notaire de la rue d’Astorg ayant exercé entre 1982 et 2015, Claude Thibierge et Jean Cumenge « ont eu à mettre au point la technique de la “division en volumes”, jusqu’alors ponctuellement et souvent maladroitement appliquée, pour l’imposer à titre de principe général de l’organisation juridique de cette opération d’ampleur demeurée unique qu’est le quartier de La Défense. Ils ont ainsi donné ses lettres de noblesse à un système dont l’usage est à présent aussi courant que celui du traditionnel statut de la copropriété »17. Ainsi la volumétrie est née. Il convient désormais d’en présenter l’héritage.
2. L’héritage de la division en volumes
12 -Double héritage. – En réalité, cet héritage se dédouble, il est d’abord et évidemment technique. D’une réflexion doctrinale et notariale est né ce nouveau mode d’organisation des ensembles immobiliers complexes qu’est la division en volumes. Il est également méthodique car cet exemple rappelle à quel point l’inventivité notariale peut être fructueuse et doit le demeurer.
13 -Une technique éprouvée. – Les bases de la division en volumes ayant été posées, cette technique particulière d’organisation de la propriété à plusieurs a été plus qu’éprouvée au cours des dernières décennies. La jurisprudence ne s’y est jamais opposée. En filigrane, dès 1969, la Cour de cassation a laissé entendre qu’il est possible que des constructions puissent appartenir à une personne autre que le propriétaire du sol et sans qu’il soit nécessaire d’appliquer le régime de la copropriété18. Elle ne s’est pas pour autant prononcée spécialement sur la technique de la volumétrie. Plus nettement ensuite, en présence de fractions d’immeubles hétérogènes, définis par des volumes, la Cour de cassation a retenu qu’il était possible pour les parties d’opter pour une organisation juridique différente de celle de la copropriété19.
La doctrine s’est également largement intéressée à cette nouvelle technique20. Sizaire en a donné une définition en 1988, unanimement reprise ensuite : « La division en volumes est une technique juridique consistant à diviser la propriété d'un immeuble en fractions distinctes, sur le plan horizontal comme sur le plan vertical, à des niveaux différents, qui peuvent se situer au-dessus comme endessous du sol naturel, chaque fraction s'inscrivant, respectivement, dans l'emprise de volumes définis géométriquement (en trois dimensions, par référence à des plans, des coupes et des cotes NGF), sans qu'il existe de parties communes entre ces différentes fractions ou volumes »21. Les conditions ont également été affinées au gré des solutions jurisprudentielles qui n’ont jamais remis en cause les bases théoriques de cette technique22.
Enfin et surtout, c’est la pratique notariale qui prît en main ce nouvel outil et l’a mis en œuvre dans une multitude de situations. Que l’on songe à la sortie d’une indivision successorale ou à l’aménagement d’un quartier d’affaires, la volumétrie peut constituer une réponse. Plus généralement, chaque fois que le régime de la copropriété paraît moins approprié et/ou qu’il est question d’assurer une compatibilité du droit de propriété de l’article 544 du Code civil avec des équipements du domaine public, la division en volumes doit être considérée.
14 -Unnouveau remède aux difficultés des copropriétés existantes. – Sans doute, les réflexions communes et partagées de la doctrine, de la jurisprudence et de la pratique notariale ont permis de repousser les frontières d’application de la volumétrie.
Une hypothèse particulière mérite d’être signalée. Elle concerne la scission d’une copropriété existante en plusieurs volumes. Comme cela a été déjà souligné, l’intérêt de la volumétrie est parfois d’évincer l’application du régime de la copropriété lorsque la configuration des constructions et leurs usages sont hétérogènes. Bien entendu, rien n’interdit ensuite d’organiser au sein d’un ou plusieurs volumes créés des copropriétés soumises à la loi du 10 juillet 1965.
Dans ce cadre, la question a été la suivante : si la volumétrie n’a pas été prévue dès l’origine, est-il possible de scinder une copropriété existante en plusieurs volumes, autrement que par une division horizontale du sol ? Autrement dit, peut-on faire marche arrière et créer des volumes pour remplacer en tout ou partie une copropriété existante ?
Le 103e congrès des notaires de France avait émis dès 2007 une proposition en ce sens, destinée à résoudre, par la volumétrie, les difficultés de copropriétés existantes. Il avait ainsi été proposé par la quatrième commission de « modifier l’art. 28 de la loi du 10 juillet 1965, en permettant la scission d'une copropriété en volumes distincts, sans contrevenir aux dispositions de l’art. 1 de la loi du 10 juillet 1965 ». Ce fut chose faite par loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR qui a modifié, par son article 59, l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965. Il dispose désormais, en son IV, que la procédure de scission d’une copropriété existante « peut également être employée pour la division en volumes d'un ensemble immobilier complexe comportant soit plusieurs bâtiments distincts sur dalle, soit plusieurs entités homogènes affectées à des usages différents, pour autant que chacune de ces entités permette une gestion autonome. La procédure ne peut en aucun cas être employée pour la division en volumes d'un bâtiment unique ».
Cette réforme majeure a trouvé rapidement une application concernant l’ensemble immobilier de la Tour-Maine-Montparnasse, aménagé également dans le courant des années 1960 et 1970. À la différence du quartier de La Défense, il n’avait pas été fait application de la division en volumes mais simplement de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis. Réunissant près de 2600 lots avec 280 copropriétaires, cet ensemble immobilier se singularise par sa taille importante et ses usages multiples : du métro parisien, aux différents bureaux, en passant par les parkings, complexes sportifs, voies d’accès ouvertes au public23. La difficile gestion de cet ensemble immobilier hétérogène a justifié qu’une scission en volumes soit mise en œuvre. Après accord de la mairie de Paris et de la préfecture, une décision des copropriétaires du 17 décembre 2020 approuva la scission en volumes avec prise d’effet du 1er avril 202124. Une solution a ainsi pu être apportée pour donner un nouveau souffle à cet ensemble immobilier complexe.
15 - La division en volumes : l’exemple d’une méthode. – En matière d’ensembles immobiliers complexes, le notariat, épaulé par la doctrine, a contribué aux bouleversements juridiques rendus nécessaires par les évolutions de la société, sans qu’il ne soit toujours nécessaire d’attendre l’intervention du législateur. Au sujet de la propriété de l’espace, Savatier concluait ainsi son propos en 1965 : « Toujours, en effet, au bout des calculs, le droit revient à l’humain ! Il s'agit, en définitive, par les techniques, de lui adapter la construction et l'urbanisation, en permettant, à chaque ménage, de peupler l'espace qu'il aura en propre. Ce sont sa vie, ses enfants, ses occupations, ses souvenirs, ses espoirs, qui animeront l'espace approprié ! ».
16 - Conclusion. – Fort heureusement, le principe de la liberté, décliné avec la liberté contractuelle et la liberté de création des droits réels25, offre encore de belles perspectives d’évolution. Si des contraintes d’un autre temps peuvent constituer un frein au développement de nouvelles techniques plus adaptées aux besoins du moment, alors la voix des notaires devra continuer de s’élever pour les faire tomber. L’« ingénierie notariale »26 n’est probablement pas un long fleuve tranquille mais un fleuve semé d’embûches dont on ne perçoit pas toujours l’issue. Pourtant, les notaires ne doivent pas redouter d’embarquer, et, pour traverser les tempêtes, mieux vaut-il être accompagné. C’est pourquoi il est ô combien important que les réflexions nourries des congrès annuels des notaires de France se poursuivent, tous comme les liens de proximité entre l’Université et le Notariat. Les précédents étudiés au travers de ces lignes en sont les témoins : c’est la rencontre des esprits de tous bords qui permettra de former le droit de demain au service de la société. ▪
L'essentiel à retenir
- La division en volumes est née de la réflexion notariale pour répondre à la complexité d’une organisation juridique des centres urbains denses, en particulier dans des contextes comme le quartier de La Défense.
- Son fondement juridique repose sur l’article 552 du Code civil et les dérogations via le droit de superficie, permettant, par convention, de dissocier la propriété des constructions de celle du sol.
- La technique, d’abord développée par Claude Thibierge et renforcée par Jean Cumenge et d’autres, s’est imposée progressivement comme une solution éprouvée face aux limites du régime de copropriété, aussi bien pour des constructions nouvelles que pour la restructuration de copropriétés existantes.
Mots-clés : Division en volumes - Propriété
Notes
- Les procès-verbaux des réunions d’étude des problèmes juridiques et fiscaux de l’établissement public de la Défense d’octobre 1962 à juin 1963 mentionnent en outre les noms de MM. Boistière, Rivaille, Monicard, Filipi, Peron, Bouton, Lagier, Mirabeau, Monicart, Thuillier, Agnès (principal Clerc de maître Thibierge) et Mme Dronne. On y apprend également la participation de géomètres, fiscalistes et membres des services du cadastre et de la publicité foncière (anciennement conservation des hypothèques). ↩
- 103e Congrès des notaires de France, La division de l’immeuble, le sol, l’espace, le bâti, Lyon, 23-26 sept. 2007, ACNF, p. 448, n° 2254 et s. ↩
- R. Savatier, Vers de nouveaux aspects de la conception et de la classification juridique des biens corporels : RTD civ. 1958, p. 1, n° 2. ↩
- Avec notamment la loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général de l'exercice 1930-1931,le décret n ° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation du cadastre et la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 sur la mise à jour périodique de valeurs locatives servant de base aux impositions directes locales. ↩
- R. Savatier, Vers de nouveaux aspects de la conception et de la classification juridique des biens corporels : RTD civ. 1958, p. 1., n° 8. ↩
- La formule est également empruntée à René Savatier : R. Savatier, La propriété de l'espace : D. 1965, p. 213. ↩
- C. Michalopoulos, Origines de la copropriété et évolution de la notion de destination de l’immeuble : RDI 1995, p. 409. ↩
- Rapport au président de la République relatif à Ord. n° 2019-1101, 30 oct. 2019, portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis. ↩
- A. Pône, Volumes immobiliers et droit de propriété (Libres et périlleuses réflexions), in Liber amicorum Georges Daublon : Defrénois 2001, p. 232. ↩
- A. Pône, Volumes immobiliers et droit de propriété (Libres et périlleuses réflexions), in Liber amicorum Georges Daublon : Defrénois 2001, p. 232. ↩
- CGPPP, art. L. 2111-1. ↩
- La technique du lot transitoire, qui peut aujourd’hui répondre en partie à la difficulté, n’était pas utilisée à l’époque. Sa validité fut reconnue seulement par un arrêt de principe la Cour de cassation du 14 novembre 1991 (Cass. 3e civ., 14 nov. 1991, n° 89-21.167, Bull. civ. III, n° 275 : JurisData n° 1991-002840; D. 1992, p. 277, rapp. P. Capoulade, obs. D. Tomasin ; Défrenois 1992, p. 803, obs. Souleau ; Administrer mai 1972, p. 27, obs. Guillot ; JCP 1992, I, 3560, obs. C. Giverdon ; JCP 1992, I, 3560 ; IRC 1992, 48, obs. P. Capoulade). ↩
- R. Savatier, Vers de nouveaux aspects de la conception et de la classification juridique des biens corporels : RTD civ. 1958, p. 1., n° 8. ↩
- 103e Congrès des notaires de France, La division de l’immeuble, le sol, l’espace, le bâti, Lyon, 23-26 sept. 2007, ACNF, n° 2257. ↩
- Nivellement Général de la France, désignant un ensemble de repères altimétriques sur l’ensemble du territoire français, géré par l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN). ↩
- A. Pône, Volumes immobiliers et droit de propriété (Libres et périlleuses réflexions), in Liber amicorum Georges Daublon : Defrénois 2001,p. 230. ↩
- Cass. 3e civ., 11 déc. 1969, n° 68-10.985 : Bull. civ. III, n° 832. ↩
- Cass. 3e civ., 17 févr. 1999, n° 97-14.368, Bull. civ. III, n° 42, p. 28:; JurisData n° 1999-000683; JCP N 1999, n° 46, p. 1639, obs. D. Sizaire ; Defrénois 1999, p. 796, note Atias ; Administrer juin 1999, p. 39, obs. P. Capoulade ; JCP G 1999, I, 175, n° 12, obs. H. Périnet-Marquet ; Loyers et copr. 1999, comm. 104, obs. G. Vigneron ; AJDI 1999, n° 901, obs. C. Giverdon ; JCP N 2000, n° 37, p. 1311, obs. A. Fournier et D. Sizaire. Solution confirmée ensuite par d’autres arrêts. ↩
- En témoigne la bibliographie importante sur le sujet, V. not. : M.-J. Aglaé, Division en volumes et propriété privée sur le domaine public : RDI 1993, p. 313. - D. Sizaire, Division et volumes : JCP N 1998, n° 11, p. 388. -Ph. Malinvaud (dir.), Les ouvrages immobiliers complexes, Colloque CERCOL et AFDC du 24 septembre 1999 : RDI 1999, p. 487. - G. Daublon, Droit de superficie et état description de division : Defrénois 15 janv. 2000, n° AD2000DEF21N1, p. 21 ; État descriptif de division et “volumes” : désignation des lots, éléments rédactionnels : Defrénois 15 mai 2000, n° AD2000DEF558N1, p. 558. - J. Lafond, Volumes et copropriété : JCP N 2007, n° 37, 1246. - Ch. Atias, Guide de la propriété en volumes immobiliers : Edilaix, coll. Point de droit, 2012. - J.-M. Roux, Brèves remarques sur les rapports entre copropriété et volumes, in Mél. J.-L. Bergel : Bruylant, 2013, p. 677. - V. Michaud, Étude et suivi de l’évolution des premières « divisions en volumes » : analyse de l’organisation de la propriété complexe, CNAM ESGT, HAL dumas-01179344, 2014. - Ph. Dupichot, Propriété, possession et détention dans l'avant-projet de réforme du droit des biens, in Mél. P. Le Cannu : LGDJ, 2014, p. 529. -M. Faure-Abbad, La propriété d'un volume. Le proprietà - Les propriétés, 12e journées d’étude Jean Beauchard Poitiers-Roma Tre, hal-02114777, 2014. - D. Richard, De la propriété du sol en volumes, th. dactyl. Paris Panthéon-Assas, 2015 ; La division en volumes renforcée depuis la loi ALUR : Opérations imm. 2016, dossier 23. - H. Palud, Un rapide aperçu sur 35 ans de pratique de la division en volumes à la Défense, in Études offertes à J. Combret : Defrénois, 2017. - H. Dalbin, L’application de la technique de la division en volumes rencontre-t-elle des usages abusifs ?, dactyl. CNAM ESGT, 2019. - A. Fournier, Divisions en volumes : histoire d'un partenariat exemplaire entre conservateurs des hypothèques et notaires : JCP N 2019, n° 6, 231. - F. Vern, Les objets juridiques. Recherches en droit des biens : Dalloz, coll. Nouvelles bibliothèque de thèses, 2020, spéc. n° 133. - A. Adam, J.-F. Dalbin, A. Lebatteux, M. Raunet, Recourir à la division en volumes en cas d'immeuble bâti unique : Actes prat. ing. immobilière 2023, n° 2, 12. ↩
- D. Sizaire, Division en volumes et copropriété des immeubles bâtis : JCP G 1988, I, 3367. ↩
- Pour un détail de la mise en œuvre, V. N. Le Rudulier, JCl. Notarial Formulaire, fasc. 10 : Division en volumes. - Nature et principes; JCl. Notarial Formulaire, fasc. 20 : Division en volumes. - Construction et gestion- V. également : J. Lafond, Préparer une division en volumes, JCl. Pratique notariale - Les actes, n° 1655. ↩
- P. Dablin, Scission d’un grand ensemble initialement sous le régime de la copropriété en une division en volumes, Sciences de l’environnement, ffdumas-01631746f, 2015, p. 9. ↩
- Comme l’indique un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 septembre 2023 (CA Paris, pôle 4, ch. 5, 20 sept. 2023, n° 22/11793). ↩
- Sur cette question, V. not. N. Kilgus, Le droit réel sui generis : plaidoyer pour une utilisation décomplexée... et raisonnée : RTD civ. 2022, p. 515. ↩
- Pour reprendre l’expression du 118e Congrès des notaires de France (118e Congrès des notaires de France. L’ingénierie notariale. Anticiper, conseiller, pacifier pour une société harmonieuse, Marseille 2022, ACNF). ↩
LES ARTICLES
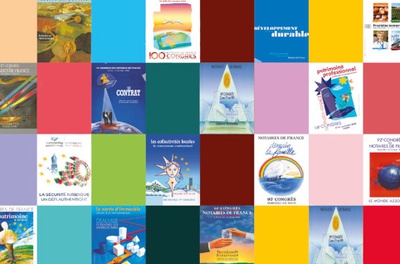
Introduction générale - Le notaire et la loi : « Et voudriez-vous… »
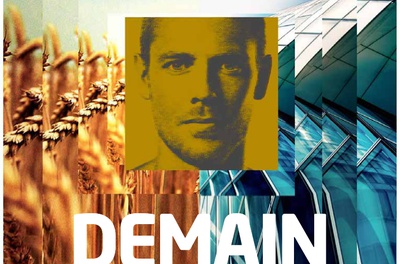
Introduction générale sur la famille
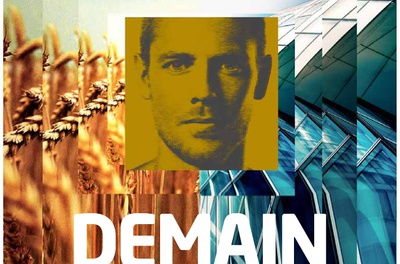
La contribution du notariat à l’amélioration du PACS
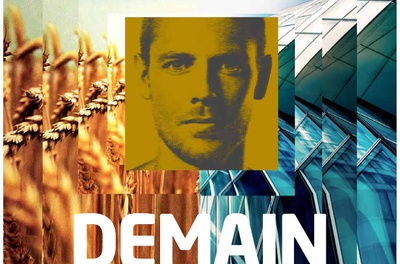
Les personnes vulnérables : quelles suites pour les propositions adoptées ?
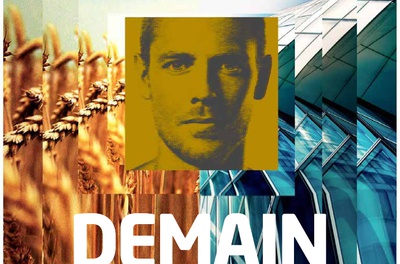
Libéralités graduelles et résiduelles : des solutions à ne pas oublier pour les personnes vulnérables
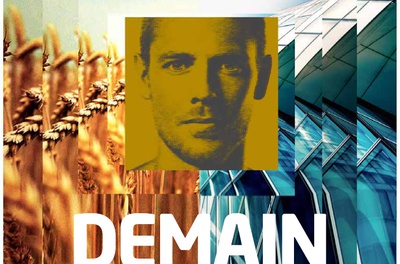
La renonciation à l'action en réduction des articles 929 et suivants du Code civil
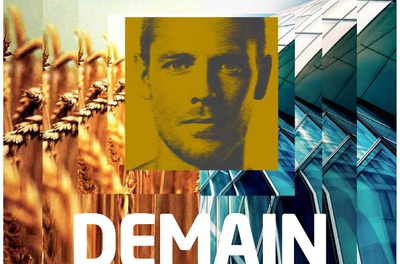
La vocation successorale égalitaire de tous les enfants
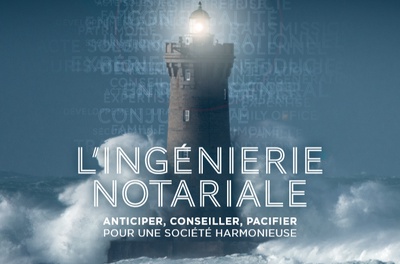
Introduction générale sur l’immobilier
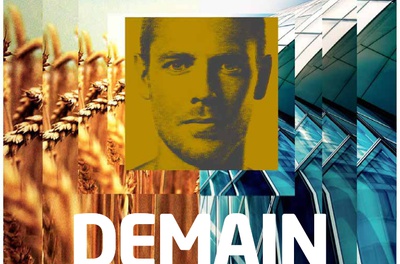
La vente d'immeuble à rénover : la suite de trois Congrès…
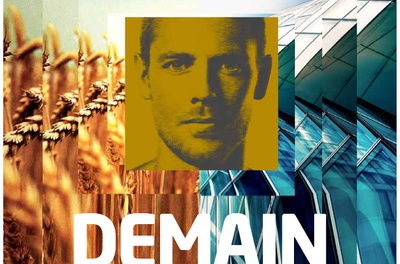
La vente en l’état futur d’achèvement : l’héritage des notaires bâtisseurs
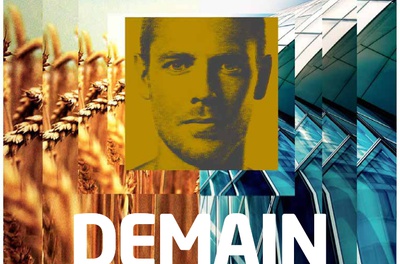
La division en volumes : l’inventivité notariale au service d’une nouvelle utilisation de l’espace
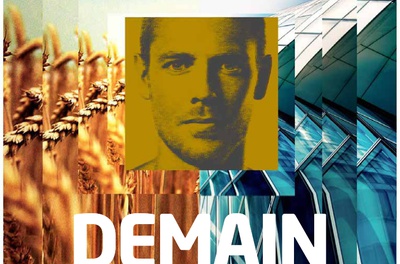
La reconnaissance par le droit de l’urbanisme du mécanisme de la prescription extinctive (C. urb., L. 421-9)
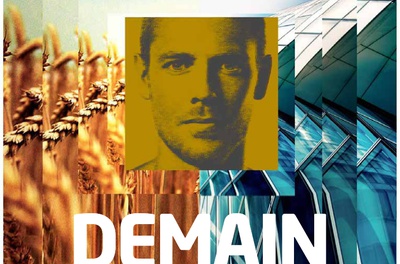
Le transfert par subrogation des accessoires garantis par l’inscription d’origine
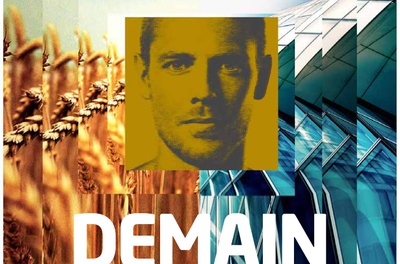
Introduction générale sur le droit public
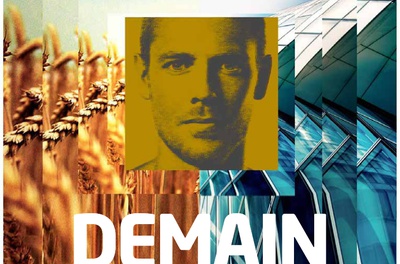
L'extension du déclassement par anticipation
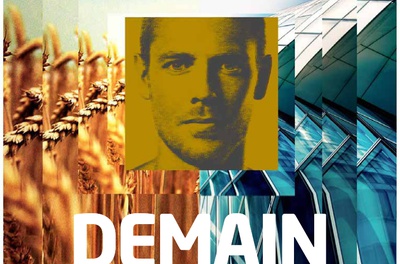
La sécurisation des droits du commerçant exploitant sur le domaine public
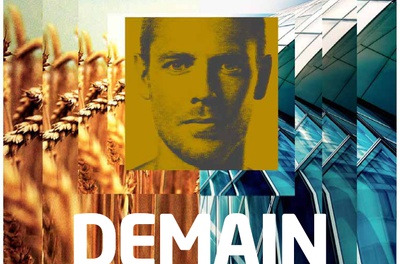
La sanction des clauses non conformes par le réputé non-écrit
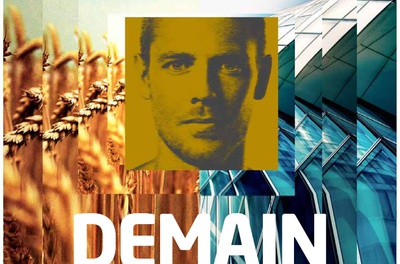
Entretien avec Jean-François Pillebout