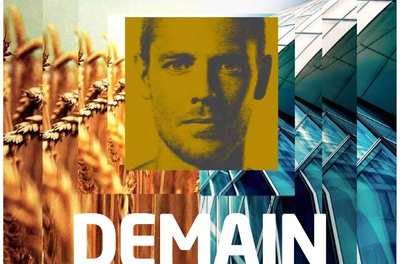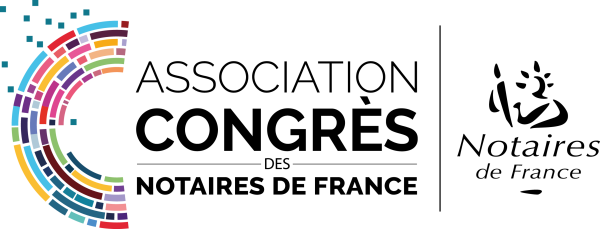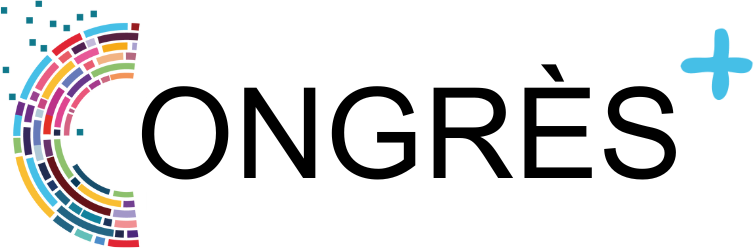Introduction générale - Le notaire et la loi : « Et voudriez-vous… »
Les apports des Congrès des notaires de France au droit
Plus de 200 textes législatifs et près de 130 règlementaires
inspirés des Congrès des notaires de France
La contribution du notariat à l’amélioration du PACS
100e Congrès des notaires de France, Paris 2004
1 - 2004 : centenaire du Congrès des notaires. – C’est à Paris en 2004 que le Congrès des notaires de France, présidé par Sophie Chaine, a soufflé ses 100 bougies avec un thème magnifique : le bicentenaire du Code civil.
La quatrième commission, dont j’étais le rapporteur sous la présidence de Didier Coiffard, était consacrée à l’étude de l’évolution de la famille constitutive de l’une des transformations sociales les plus importantes depuis la naissance du Code civil.
C’est le couple, premier maillon de la famille, que nous avons d’abord analysé sous toutes les coutures.
2 - Réflexion centrée sur le Pacs. – C’est rapidement sur le Pacs issu de la loi du 15 novembre 19991 et encore peu connu de la pratique notariale, que nous avons concentré notre réflexion.
Analysés à l’époque par la majorité de la doctrine comme un simple contrat patrimonial étranger à l’état des personnes2, nous avons rapidement acquis la conviction que le Pacs était bien plus qu’un contrat ; il constituait un nouveau mode de conjugalité avec une forte dimension institutionnelle relevant bien de l’état des personnes, intermédiaire entre le concubinage et le mariage. Il est vrai que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 9 novembre 19993, laissait entrevoir cette approche en précisant que le Pacs nécessitait une vie de couple.
3 - Trois modes de conjugalité… – Avec le Pacs, c’était désormais trois modes de conjugalité distincts qui coexistaient. Nous avons clairement pris le parti de défendre la voie du pluralisme juridique avec un traitement différencié pour chacun.
Ce pluralisme n’était cependant concevable qu’à la condition d’avoir une approche globale et cohérente de la conjugalité où chacune des trois formes de vie à deux devait être autonome et en harmonie avec sa philosophie propre.
4 - … avec chacun son équilibre. – La recherche de la cohérence a débouché sur un principe général : il faut un équilibre entre les avantages et les contraintes. Ainsi, les avantages de chaque mode de conjugalité, en particulier sur le plan patrimonial, doivent toujours être corrélés aux obligations personnelles. La forme de conjugalité qui comporte les obligations personnelles les plus nombreuses doit conférer au couple les garanties les plus importantes sur le plan patrimonial. C’est cet équilibre qui assure l’autonomie de chacune des figures et la cohérence de l’ensemble.
5 - Le mariage et le concubinage. – D’un côté, le mariage fondé sur l’engagement s’inscrit encore aujourd’hui, et malgré le mouvement de libéralisation dont il est l’objet, dans la durée. Il revêt à ce titre une utilité sociale car il demeure la forme de conjugalité la plus stable. En tant que premier élément constitutif de la famille, il est légitime que l’État lui garantisse le statut patrimonial le plus attractif.
Il doit ainsi être doté d’un régime stable et protecteur qui permet la fusion patrimoniale la plus aboutie avec suffisamment de souplesse pour adapter voire anticiper la gestion des biens des époux dans la durée. De l’autre côté se trouve le concubinage, fondé sur le principe de liberté sans aucune obligation personnelle et qui est dépourvu de toute garantie sur le plan patrimonial.
6 - Le Pacs : une position intermédiaire. – Pour que le Pacs trouve sa place dans le paysage de la conjugalité, il doit nécessairement occuper une position intermédiaire qui offre aux partenaires des garanties moindres que celles du mariage, car il ne s’inscrit pas dans le long terme et peut être rompu unilatéralement. Doté d’un statut personnel plus limité, il doit offrir aux partenaires sur le plan patrimonial un régime moins attractif que celui du mariage, qui doit rester le mode le plus complet et le plus protecteur pour le couple.
7 - Même si nous constatons aujourd’hui un rapprochement entre les trois formes de conjugalité, résultat de la convergence de deux mouvements – la libéralisation du mariage et la normalisation du concubinage4 –, le droit du couple actuel repose sur une diversité des formes de conjugalité dont le maintien suppose une hiérarchie entre les trois régimes juridiques, du plus léger au plus abouti.
8 - Conférer aux partenaires de Pacs des avantages sur le plan patrimonial équivalents, voire supérieurs, à ceux qu’offre le mariage, c’est porter atteinte à l’autonomie du Pacs par rapport au mariage, mais c’est surtout fragiliser la cohérence du droit de la conjugalité.
On ne peut pas cumuler les avantages que le Pacs emprunte au concubinage sur le plan personnel (la rupture unilatérale et instantanée) et lui attribuer ceux du mariage sur le plan patrimonial (par des avantages pacsimoniaux qui permettraient par exemple de modifier le périmètre de l’indivision ou encore d’attribuer les acquêts au survivant) sans les obligations personnelles et les contraintes d’un statut complet. Car ainsi doté d’un régime patrimonial avantageux sans aucune contrainte personnelle (puisque les obligations personnelles peuvent cesser instantanément par une décision unilatérale), le Pacs exercerait inévitablement une attractivité pour les couples sans les bienfaits pour la société du principe d’engagement qui est spécifique au mariage et l’inscrit dans la durée ; une telle attractivité du Pacs risquerait de déboucher à terme sur la fusion des formes de conjugalité. Or, la diversité des modes de conjugalité doit être préservée car elle garantit finalement la liberté de choix de tous les couples.
9 - Le Pacs, pas un simple contrat. – L’argument de la liberté contractuelle pour justifier que les partenaires de Pacs puissent aménager et optimiser leur régime patrimonial comme des époux, voire plus facilement qu’eux, n’est pas pertinent car l’analyse de la nature du Pacs et de son régime juridique ne se conçoit que par référence aux autres formes de conjugalité. Le Pacs n’est pas un simple contrat et la limitation de la liberté contractuelle des partenaires, pas une incohérence. Bien au contraire, c’est la dimension institutionnelle et la place nécessairement encadrée du Pacs dans le droit de la conjugalité qui le soumettent à un dirigisme contractuel marqué par l’ordre public.
10 - Un partenariat institutionnel. – La loi du 23 juin 2006 a consacré cette thèse du partenariat institutionnel et ancré définitivement le Pacs dans le paysage de la conjugalité.
Cette vision de la conjugalité portée par le 100e Congrès des notaires de France, il y a déjà 20 ans, était audacieuse. Force est de constater qu’elle est aujourd’hui devenue une évidence pour tous et la majorité de la doctrine approuve désormais la thèse du dirigisme contractuel5.
Remarque
Le nombre de Pacs est en constante augmentation chaque année et se rapproche du nombre de mariages, lequel est relativement stable, ce qui démontre que le Pacs est un mode de conjugalité alternatif ou préalable au mariage et répond à un réel besoin6.
Fin remarque
11 - Conçu comme nouvelle forme de conjugalité, le Pacs méritait, il y a 20 ans, de voir son régime juridique amélioré, celui issu de la loi du 15 novembre 1999 étant unanimement critiqué7. Deux propositions portées par la quatrième commission du 100e Congrès se sont inscrites dans cet objectif :
• a première proposition était relative à l’amélioration des conditions de forme du Pacs pour permettre au notaire d’en être le rédacteur afin d’éclairer les futurs partenaires et corriger ainsi une aberration de la loi ;
• la seconde était relative au fond pour clarifier un régime des biens complexe et dangereux.
1. Le Pacs éclairé
12 - C’est une véritable aberration que le 100e Congrès des notaires de France a souhaité corriger en redonnant au notariat une place dans l’élaboration des conventions de Pacs.
A. -Une aberration dans la loi du 15 novembre 1999
13 - L’article 515-3 du Code civil dans sa version issue de la loi du 15 novembre 1999 prévoyait que « à peine d’irrecevabilité, elles [les partenaires de Pacs] produisent au greffier la convention passée entre elles en double original… ».
14 - Impossible d’établir le Pacs par acte notarié. – En exigeant ainsi la production de deux originaux, le législateur avait, probablement involontairement, exclu la possibilité d’établir la convention de Pacs par acte notarié, ce dernier se caractérisant par son unicité.
Remarque
Cette absurdité a été unanimement critiquée8. Non seulement le législateur de 1999 n’avait pas jugé opportun de réserver au Pacs les vertus d’une authenticité obligatoire, mais bien plus, il l’en avait volontairement privé et ce au détriment des concubins. Cette impossibilité de recourir à la forme notariée constituait un précédent ; pour la première fois, un contrat, de surcroît dans le domaine du droit des personnes, ne pouvait être établi en la forme notariée.
La volonté politique à l’époque constamment affichée de ne pas faire du Pacs un mariage bis n’avait sans doute pas milité en faveur d’un formalisme identique à celui applicable au contrat de mariage.
Pourtant nombreuses sont les raisons qui justifient, dans l’intérêt des consommateurs de droit, le recours sinon obligatoire, en tout cas optionnel à l’acte authentique ; une proposition du 100e Congrès des notaires de France s’imposait.
Fin remarque
B. -Une proposition évidente pour la supprimer
15 - Un conseil notarial nécessaire. – Sur le fond, priver le Pacs de l’authenticité, c’était d’abord priver les futurs partenaires du conseil notarial nécessaire à un consentement éclairé s’agissant d’un contrat dont « les embûches sont légion entre les lignes d’une loi faussement simplette »9.
Sur la forme, l’authenticité supprimait le risque de perte ou de modification frauduleuse, la minute étant conservée par le notaire qui en délivre des copies authentiques10.
16 - Une proposition a ainsi été portée et très largement adoptée par le congrès relatif à la nécessaire modification de l’article 515-3 du Code civil et de ses décrets d’application afin que la convention de Pacs, ou toute convention modificative, puisse être conclue par acte authentique ou par acte sous seing privé.
C’est la loi du 23 juin 2006 qui intègre cette proposition dans le droit positif en modifiant l’article 515-3 du Code civil.
2. Le Pacs clarifié
17 - En retenant le régime de l’indivision, le législateur de 1999 a sans doute voulu doter les partenaires de Pacs d’un régime patrimonial simple. En réalité, ce régime s’est avéré complexe avec un système de présomption différent selon les biens concernés et risqué pour les partenaires souhaitant conserver une autonomie patrimoniale.
A. - Un régime patrimonial complexe dans la loi du 15 novembre 1999
18 - Deux présomptions d’indivision. – L’article 515-5 issu de cette loi disposait que « les partenaires d’un pacte civil de solidarité indiquent, dans la convention visée au deuxième alinéa de l’article 515-3, s’ils entendent soumettre au régime de l’indivision les meubles meublants dont ils feraient l’acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte. À défaut, ces meubles sont présumés indivis par moitié. Il en est de même lorsque la date d’acquisition de ces biens ne peut être établie. Les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si l’acte d’acquisition ou de souscription n’en dispose autrement ».
Ce texte instaurait donc deux présomptions d’indivision, l’une relative aux meubles meublants qui étaient automatiquement indivis par moitié sauf mention contraire expresse dans la convention, et l’autre relative aux autres biens, indivis sauf stipulation contraire de l’acte d’acquisition ou de souscription.
19 - Rôle de la volonté des partenaires. – Un rôle décisif était ainsi attribué à la volonté des partenaires :
• pour les meubles meublants, la présomption d’indivision pouvait être seulement écartée une bonne fois pour toutes dans la convention de Pacs ;
• pour les autres biens, les plus importants, elle ne pouvait être écartée définitivement, mais seulement ponctuellement par le partenaire acquéreur à l’occasion de chaque achat, à condition qu’il donne lieu à l’établissement d’un acte d’acquisition ou de souscription. Que l’acquisition ne donne lieu à aucun acte ou que le partenaire acquéreur omette de porter une mention d’exclusion (ou ignore l’intérêt d’une telle mention) et le bien était automatiquement indivis par moitié entre les deux partenaires !
Remarque
La preuve contraire n’étant pas admise11, le Congrès en avait déjà déduit à l’époque que la seule analyse cohérente de cette présomption était de la considérer non pas comme une mode de preuve, mais comme un nouveau mode d’acquisition de la propriété avec enrichissement conjoint des deux partenaires quel que soit le mode de financement, de la même nature qu’un acquêt de communauté pour deux époux mariés sans contrat. Pour la première fois, nous avions utilisé l’expression « acquêts de Pacs » devenue courante par la suite12.
Fin remarque
20 - Un régime incohérent et dangereux. – Ce régime, apparemment simple et équilibré pour les partenaires, était en réalité incohérent et dangereux.
Incohérent par rapport au régime de la communauté entre époux dans lequel ces derniers n’ont pas la possibilité de faire varier le périmètre de la communauté alors que dans le régime originaire du Pacs, les partenaires pouvaient librement alimenter ou non la masse indivise lors de leurs différents investissements. En dotant le Pacs d’une souplesse patrimoniale totale sans les contraintes personnelles, c’est la cohérence de ce dernier par rapport au mariage qui se trouvait remise en cause.
Dangereux ensuite, parce que ce régime patrimonial souffrait d’un formalisme très contraignant pour les partenaires désireux d’investir séparément. Le défaut de mention entraînait automatiquement le jeu de la présomption d’indivision, le Pacs apparaissant ainsi comme une machine à créer des biens indivis souvent dans l’ignorance totale des partenaires.
Dans ces conditions c’est logiquement qu’une proposition de modification du régime patrimonial du Pacs a été présentée par le 100e Congrès des notaires de France.
B. -Une proposition logique pour le clarifier
21 - Régime de la séparation de biens. – L’objectif était de clarifier et de simplifier le régime patrimonial pour permettre aux partenaires le souhaitant de conserver une indépendance patrimoniale en toute sécurité.
Il suffisait de permettre aux partenaires d’exclure expressément, dans la convention initiale ou dans toute convention modificative, la présomption d’indivision pour tous les biens. Cette possibilité permettait ainsi aux partenaires souhaitant conserver une indépendance patrimoniale d’adopter, une bonne fois pour toutes, le régime de la séparation de biens.
Pour les partenaires qui n’auraient pas exclu la présomption d’indivision, cette dernière devait alors concerner tous les biens acquis postérieurement au Pacs, à l’exception des deniers, des biens créés pendant le Pacs ainsi que des biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement au Pacs ou reçus par donation ou succession.
Cette proposition fut également très largement adoptée par le Congrès.
22 - Un choix à disposition des partenaires. – Cette proposition a également été reprise par la loi du 23 juin 2006 qui a réformé profondément le régime patrimonial du Pacs et l’a doté du régime de la séparation de biens. Comme pour les époux, un choix clair s’offre désormais aux partenaires :
• pour ceux qui souhaitent rester indépendants, la loi prévoit le régime de la séparation de biens qui s’applique par défaut ;
• et pour ceux qui désirent, au contraire, une solidarité patrimoniale, ils peuvent opter dans la convention de Pacs pour un régime « communautaire », celui de l’indivision des acquêts de la même essence que le régime issu de la loi de 1999.
Remarque
Comme entre époux, il existe désormais une option entre un régime séparatiste et un régime communautaire, mais le dispositif est inversé : dans le pacs, c’est la séparation de biens qui est le régime supplétif alors que dans le mariage, c’est le régime communautaire.
Bien que la dimension statutaire du Pacs sorte renforcée de cette réforme, le Pacs demeure un mode de conjugalité marqué par la liberté individuelle des partenaires qui conservent en particulier la faculté de le dissoudre unilatéralement. C’est donc naturellement le régime séparatiste qui a été retenu comme régime de référence.
Dans le mariage, c’est la solidarité patrimoniale, prolongement de l’engagement personnel, qui domine : le régime légal est le régime communautaire, la séparation des patrimoines supposant un choix exprès dans un contrat de mariage.
Fin remarque
23 - Indivision forcée : bien indivis par moitié. – Dans le régime optionnel de l’indivision forcée des acquêts, les biens acquis ensemble ou séparément sont indivis par moitié entre les partenaires sans recours de l’un contre l’autre au titre d’une contribution inégale (C. civ., art. 515-1). Cette mention expresse d’absence de recours confirme l’analyse retenue par le 100e Congrès du régime initial de l’indivision issu de la loi du 15 novembre 1999. Le bien acquis par un partenaire et financé par des deniers empruntés ou économisés après l’enregistrement du Pacs constitue un acquêt définitivement destiné à un partage égalitaire. Le partenaire non-acquéreur tient son droit de propriété directement de sa qualité de partenaire pacsé. Le rapprochement avec le mariage est sur ce point manifeste ; c’est parce que le Pacs est un véritable mode de conjugalité que le législateur l’a doté d’un régime patrimonial original permettant un enrichissement égalitaire entre les deux membres du couple.
24 - Périmètre de l’indivision. – Quant à la question du périmètre de l’indivision forcée, il est d’ordre public sans possibilité de le moduler à la baisse ou à la hausse.
Remarque
Il serait inopportun d’offrir cette possibilité aux partenaires de Pacs, car ce serait leur permettre d’avoir tous les atouts en mains : souplesse patrimoniale et liberté personnelle et ce serait, à coup sûr, une remise en cause de la nécessaire différenciation qui doit exister entre les modes de conjugalité, laquelle garantit leur coexistence dans la durée.
Fin remarque
25 - En offrant aux partenaires la possibilité d’opter pour le régime de l’indivision, le législateur a souhaité offrir une alternative claire et stable aux partenaires ayant une approche communautaire de leur patrimoine. C’est une quasi-communauté que le législateur a mise en place avec l’indivision des acquêts de Pacs. Comme sous le régime de la communauté légale entre époux, ce sont, sauf les exceptions légales, tous les biens acquis par l’un ou par l’autre qui sont indivis sans recours mais sans la possibilité de moduler le périmètre de l’indivision forcée ou de prévoir des transferts d’actifs au profit du survivant comme peuvent le faire en revanche les personnes mariées.
Remarque
Vingt après, une réforme du régime communautaire du Pacs est peut-être souhaitable notamment pour clarifier le statut, personnel ou indivis, des biens des partenaires dans certaines situations : bien partiellement acquis au moyen de deniers personnels, échange, bien créé, bien licité, etc.13
Mais si une nouvelle réforme devait être aujourd’hui envisagée, c’est bien au regard de son impact sur tout le droit de la conjugalité que la réflexion devra être menée.
Le 100e Congrès des notaires de France pensait dès 2004 que le Pacs avait sa place dans le droit de la conjugalité : toute sa place, comme mode intermédiaire entre le concubinage et le mariage mais rien que sa place, en préservant son autonomie et sa cohérence par rapport au mariage.
Fin remarque ▪
L'essentiel à retenir
- 25 ans après sa création, le Pacs est aujourd’hui un mode de conjugalité à part entière, alternatif au mariage et adopté par de nombreux couples.
- Le régime juridique initial du Pacs issu de la loi du 15 novembre 1999 était perfectible et le 100e Congrès des notaires de France a contribué à son amélioration tant sur la forme, en proposant la possibilité de conclure la convention par acte notarié, que sur le fond, en simplifiant le régime des biens pour permettre la séparation des patrimoines.
- Intermédiaire entre le concubinage, fondé sur le principe de liberté et le mariage, fondé sur le principe d’engagement, le régime patrimonial actuel du Pacs peut, sans doute, être encore amélioré mais en maintenant des différences claires avec le mariage pour respecter la cohérence d’ensemble.
Mots-clés : Pacs -Modes de conjugalité -Régime de l’indivision
Notes
- H. Fulchiron, Le nouveau Pacs est arrivé ! : Defrénois 200, art. 38471. ↩
- Cons. const., 9 nov. 1999 : JO 16 nov. 1999, p. 16962 et s. ↩
- Rapp. 100e Congrès des Notaires de France – 4e comm. – p. 603 et s. ↩
- P. Murat, Les régimes matrimoniaux et les régimes « pacsimoniaux » à l’épreuve de la rupture des couples : JCP N 2011, n° 25, 1206. ‒ S. de Benalcazar, Éloge de la raison juridique, ou la remontée des enfers. Sur la réforme du régime légal du Pacs : Dr. famille 2007, étude 2. ‒ M. Lebeau, Brèves remarques sur la nature de l’indivision d’acquêts des partenaires liés par un Pacs : Defrénois, 30 nov. 2010, n° 20, p. 2189. ‒ M. Grimaldi, 9es États généraux du droit de la famille – Les biens du couple : GPL 30 mars 2013, n° 125c7. ‒ Pour une position plus nuancée : A. Tani, Le pacs et la liberté contractuelle : un régime patrimonial au menu ou à la carte ? Les vingt ans du Pacs : le droit du couple et ses (r)évolutions : LexisNexis, p. 45-62. ↩
- Année 2023 : 204 000 Pacs – 242 000 mariages (source : Insee). ↩
- G. Champenois, Les présomptions d’indivision dans le pacs, in Études offertes à J. Rubellin-Devichi : Du concubinage – Droit interne, droit international, droit comparé : Litec, 2002, p. 86. ↩
- H. Lécuyer, Le Pacs désormais sous toutes ses coutures : Dr. famille 2000, chron. 1. ‒ B. Beignier, Le notaire évincé : Dr. famille 2001, comm. 13. ‒ J. Combret, Point de vue d’un notaire : Dr. famille H.S. déc. 1999, p. 54. ↩
- P. Catala, Critique de la raison médiatique : Dr. famille, H.S. déc. 1999, p. 63. ↩
- Aux termes de l’article 515-3 ancien du Code civil, le greffier visait et datait les deux exemplaires originaux de la convention qui étaient restitués aux partenaires. Ainsi, l’un des partenaires pouvait, en fraude de droits de l’autre, modifier à sa guise son exemplaire sans aucune possibilité pour l’autre de prouver que son exemplaire faisait foi. ↩
- Cons. const., 9 nov. 1999 : JO 16 nov. 1999, p. 16962 et s. ↩
- Rapp. 100e Congrès des Notaires de France – 4e comm. – p. 758. ↩
- L’article 515-5-2 du Code civil est imprécis et crée un risque en pratique qui pousse les praticiens à conseiller le régime de la séparation de biens. ↩
LES ARTICLES
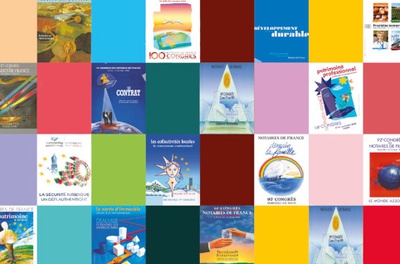
Introduction générale - Le notaire et la loi : « Et voudriez-vous… »
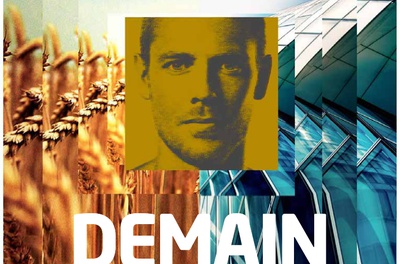
Introduction générale sur la famille
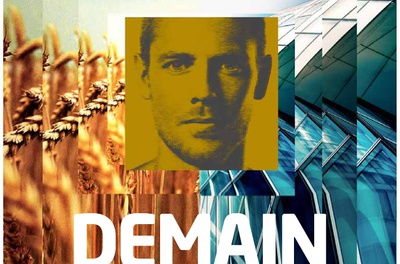
La contribution du notariat à l’amélioration du PACS
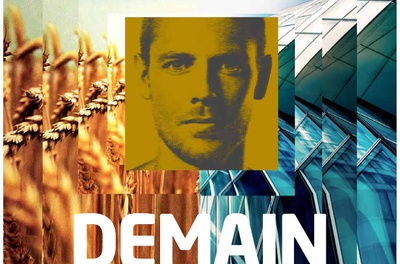
Les personnes vulnérables : quelles suites pour les propositions adoptées ?
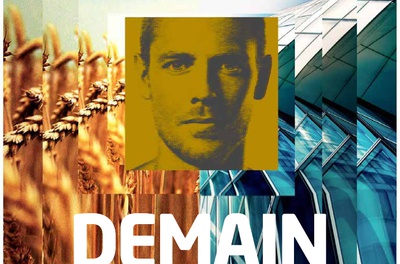
Libéralités graduelles et résiduelles : des solutions à ne pas oublier pour les personnes vulnérables
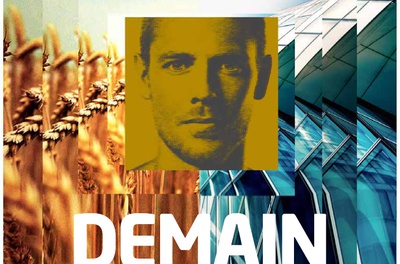
La renonciation à l'action en réduction des articles 929 et suivants du Code civil
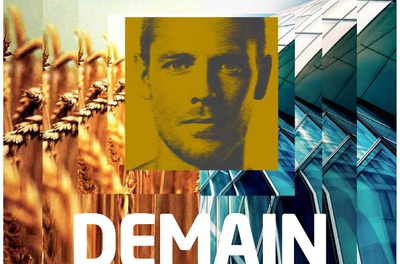
La vocation successorale égalitaire de tous les enfants
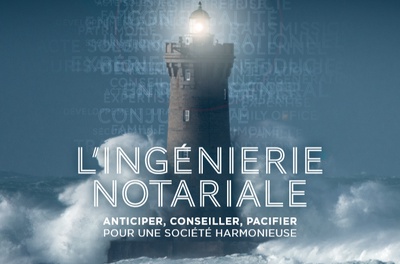
Introduction générale sur l’immobilier
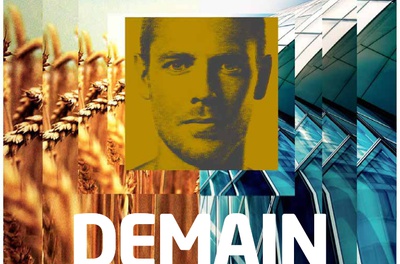
La vente d'immeuble à rénover : la suite de trois Congrès…
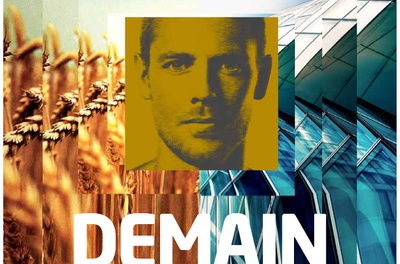
La vente en l’état futur d’achèvement : l’héritage des notaires bâtisseurs
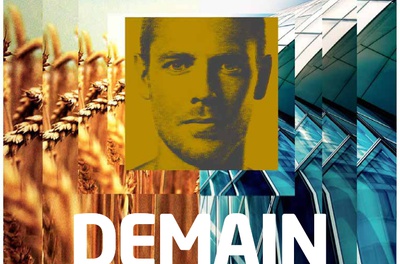
La division en volumes : l’inventivité notariale au service d’une nouvelle utilisation de l’espace
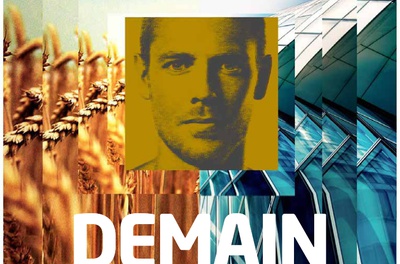
La reconnaissance par le droit de l’urbanisme du mécanisme de la prescription extinctive (C. urb., L. 421-9)
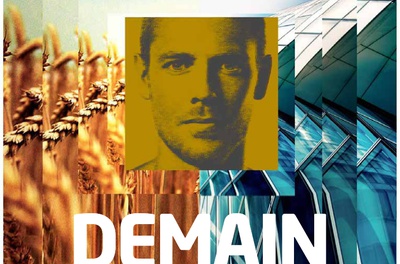
Le transfert par subrogation des accessoires garantis par l’inscription d’origine
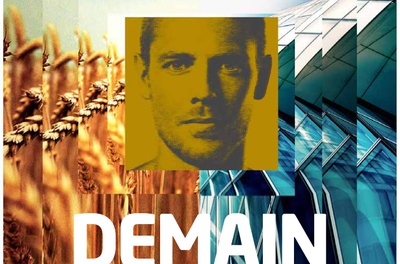
Introduction générale sur le droit public
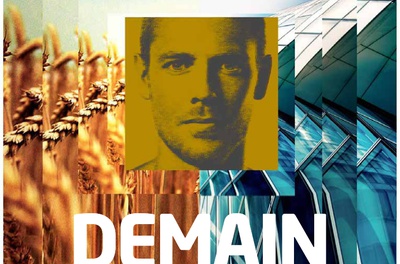
L'extension du déclassement par anticipation
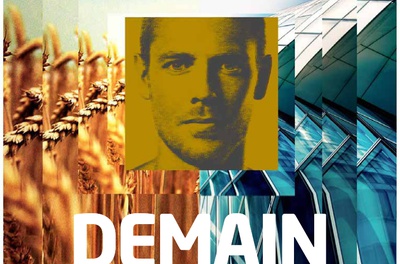
La sécurisation des droits du commerçant exploitant sur le domaine public
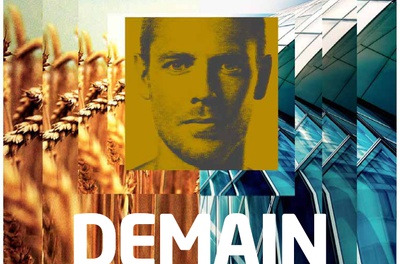
La sanction des clauses non conformes par le réputé non-écrit
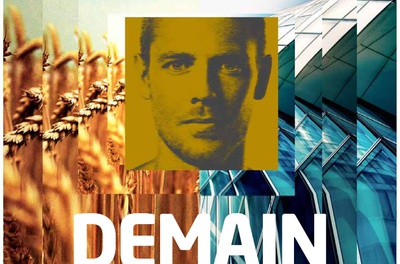
Entretien avec Jean-François Pillebout