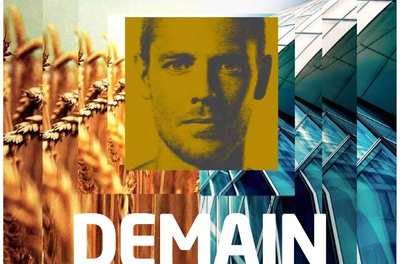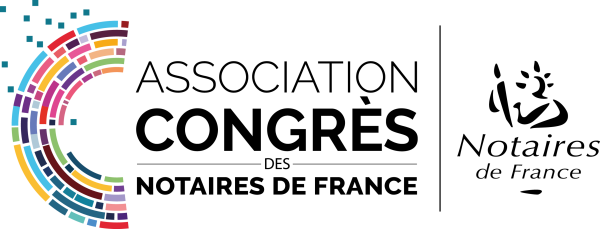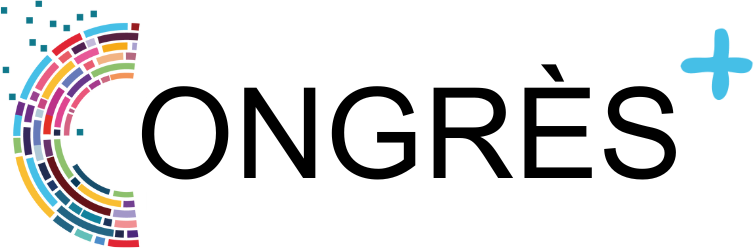Introduction générale - Le notaire et la loi : « Et voudriez-vous… »
Les apports des Congrès des notaires de France au droit
Plus de 200 textes législatifs et près de 130 règlementaires
inspirés des Congrès des notaires de France
Introduction générale sur le droit public
121e Congrès des notaires de France
1 - On oppose de manière traditionnelle le droit public au droit privé. Le droit public visant à faire prévaloir l’intérêt général sur les intérêts privés défendus par le droit privé. Cette summa divisio qui structure notre système juridique a fait et fait toujours l’objet de débats doctrinaux récurrents.
2 - Interpénétration croissante du droit public et du droit privé. – Il ne s’agit pas ici d’entrer dans ce débat conceptuel sans fin mais de constater que, dans notre pratique quotidienne, cette distinction est inopérante. La distinction entre droit privé et droit public n’a jamais été nette et, depuis quelques années, il existe une interpénétration croissante du droit public et du droit privé. Il s’agit d’ailleurs d’une des évolutions les plus importantes de notre système juridique qui accompagne les transformations profondes de l’État et de la société.
Le Code de la construction et de l’habitation en est une démonstration. Le champ couvert par ce code est très vaste et contient un corps de règles transversales relevant à la fois du droit privé et du droit public.
3 -Droit public et notariat. – Ainsi, si le notaire est habituellement présenté comme exerçant principalement dans le domaine du droit privé, il n’en demeure pas moins que son activité s’articule étroitement avec les règles et institutions du droit public. Notre statut lui-même emprunte simultanément aux caractéristiques de l’officier public investi d’une mission de service public et de la profession libérale.
Ne pas s’intéresser au droit public en tant que notaire est donc chose impossible du fait de notre statut mais aussi parce que nous sommes le conseil « (…) des personnes physiques ou morales de droit privé et de droit public et le rédacteur impartial de leurs volontés. »1. Le notaire est ainsi amené à connaître, à la fois par son statut et par son activité, des imbrications du droit public et du droit privé.
L’équipe du 120e Congrès des notaires de France2 qui s’est tenu à Bordeaux en septembre 2024 a mis en évidence l’imprégnation du droit de l’environnement dans notre droit civil, notamment au travers des obligations réelles environnementales (ORE).
Chaque jour, le notaire applique et met en œuvre des exigences de droit public dans des actes qui relèvent fondamentalement du droit privé. L’illustration la plus marquante en est la vente immobilière entre personnes privées. La vente immobilière est à la « croisée des chemins » du droit privé (droit des obligations et des biens, droit de la famille et des personnes, droit des sociétés, droit des sûretés, droit des assurances …) et des diverses branches du droit public avec le droit de l’urbanisme, le droit de la santé et de l’environnement (les diagnostics immobiliers et études de sols, la réglementation des ICPE….), le droit fiscal (droits d’enregistrement, TVA…) et le droit pénal (lutte contre les « marchands de sommeil » et l’habitat indigne, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme).
Cette illustration démontre qu’il n’y a pas d’un côté le droit privé et de l’autre côté le droit public, il y a seulement une réalité juridique quotidienne qu’il est nécessaire d’appréhender globalement.
4 - « Publicisation » du droit privé et limitation de l’autonomie de la volonté. – L’on constate ainsi que, depuis quelques années, l’imbrication du droit public et du droit privé laisse place progressivement à une publicisation renforcée du droit privé liée à une prolifération de règles impératives qui, dans un but d’intérêt général, restreignent l’autonomie de la volonté et l’espace dédié à la liberté contractuelle. L’affirmation est particulièrement vraie en matière de propriété privée immobilière3. Ainsi, dans le domaine du logement, la réglementation d’ordre public foisonne afin de permettre au pouvoir public d’intervenir dans la gestion de la propriété privée et de limiter les droits du propriétaire dans le but affiché de lutter contre les inégalités d’accès au logement et plus généralement à la crise du logement.
Le constat n’est pas nouveau mais un juste équilibre (droit privé/droit public) doit être trouvé afin que ces contraintes au droit de propriété des personnes privées n’entravent pas la circulation des biens, leur financement et, en conséquence, la fluidité du marché.
5 - Privatisation de la propriété immobilière publique. – À l’opposé, et conscient de la nécessité économique et financière de valoriser les biens des personnes publiques, un mouvement de privatisation de la propriété immobilière publique s’est mis en place progressivement à partir des années 1980 pour aboutir à l’édiction d’un Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP ou CG3P)4. La thèse de l’existence d’un droit de propriété des personnes publiques s’est donc imposée.
La dégradation des finances publiques qui impacte les budgets locaux nécessite que les collectivités puissent optimiser la gestion de leur patrimoine. Les techniques de droit privé et les droits réels issus du droit de propriété sont alors apparus comme étant les plus à même de répondre à cet impératif de valorisation économique sans pour autant exclure le régime protecteur attaché à la domanialité publique. Un régime étroitement lié à la notion d’affectation qui concrétise celle du service public et plus généralement celle de l’intérêt général qui doit orienter l’action publique.
6 - Domanialité publique et protection de l’affectation. – Le régime de la domanialité publique est donc un régime fonctionnel de protection de l’affectation et non de propriété. Il doit ainsi avoir pour seul objet de neutraliser ou d’adapter l’exercice de certains attributs du droit de propriété dès lors qu’il existe une affectation à protéger.
Dans cette rubrique « droit public », les deux propositions5 qui vous sont présentées dans ce dossier par mes co-équipiers du 109e Congrès des notaires de France de 2013 « Propriétés publiques, quels contrats pour quels projets ? » participent à la recherche de cet équilibre de « protection valorisante » : la valorisation grâce à une approche fondée sur le droit de propriété et la protection par le maintien des règles liées à la domanialité publique (inaliénable, insaisissable et imprescriptible), lesquelles doivent cesser lorsqu’il n’y a plus d’affectation à protéger.
Mots-clés : Immobilier
Notes
- 120e Congrès des Notaires de France, Bordeaux 2024 « Vers un urbanisme durable – Accompagner les projets face aux défis environnementaux ». ↩
- 112e Congrès des notaires de France, Nantes 2016 « La propriété immobilière : entre liberté et contraintes ». ↩
- Ce code a été créé par l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 et est entré en vigueur le 1er juillet 2006. ↩
- « L’extension du déclassement par anticipation » et « La sécurisation des droits conférés au commerçant sur le domaine public ». ↩
LES ARTICLES
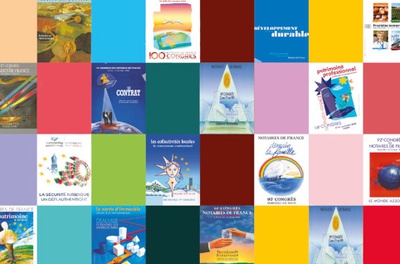
Introduction générale - Le notaire et la loi : « Et voudriez-vous… »
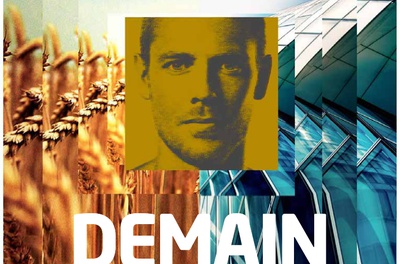
Introduction générale sur la famille
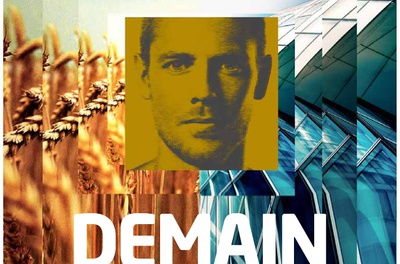
La contribution du notariat à l’amélioration du PACS
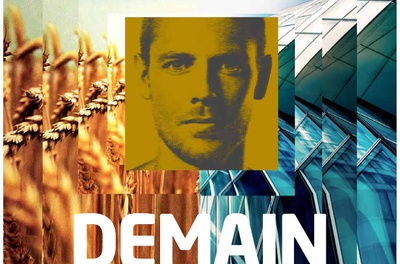
Les personnes vulnérables : quelles suites pour les propositions adoptées ?
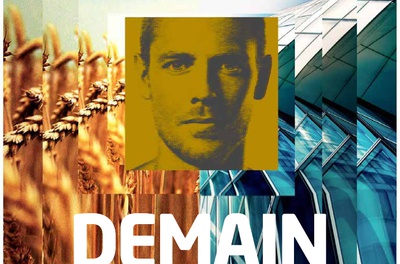
Libéralités graduelles et résiduelles : des solutions à ne pas oublier pour les personnes vulnérables
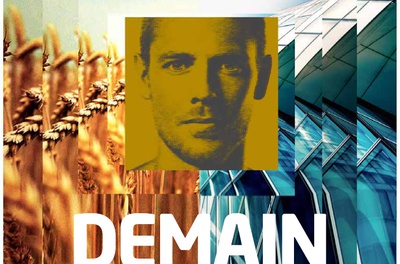
La renonciation à l'action en réduction des articles 929 et suivants du Code civil
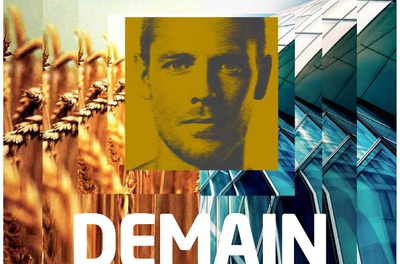
La vocation successorale égalitaire de tous les enfants
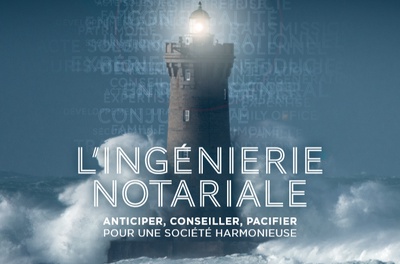
Introduction générale sur l’immobilier
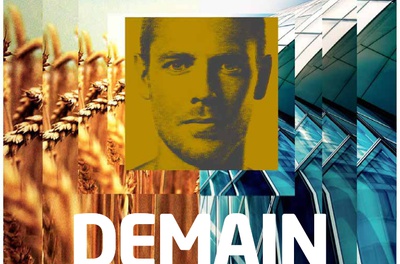
La vente d'immeuble à rénover : la suite de trois Congrès…
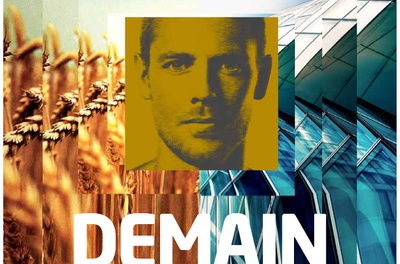
La vente en l’état futur d’achèvement : l’héritage des notaires bâtisseurs
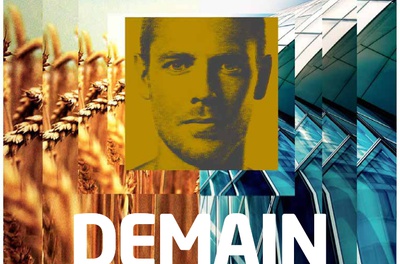
La division en volumes : l’inventivité notariale au service d’une nouvelle utilisation de l’espace
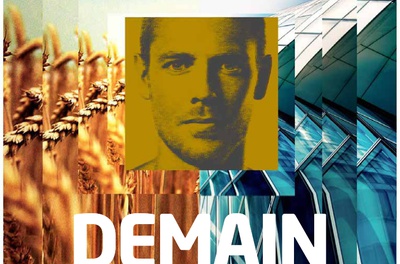
La reconnaissance par le droit de l’urbanisme du mécanisme de la prescription extinctive (C. urb., L. 421-9)
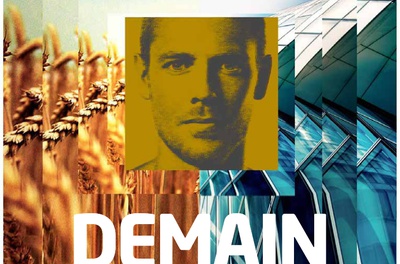
Le transfert par subrogation des accessoires garantis par l’inscription d’origine
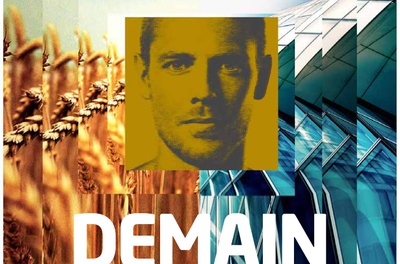
Introduction générale sur le droit public
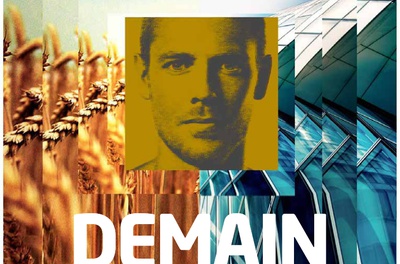
L'extension du déclassement par anticipation
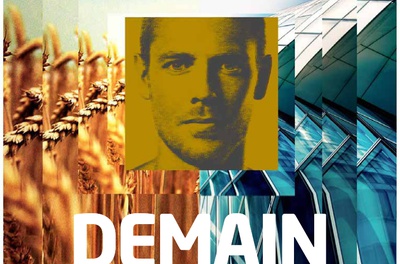
La sécurisation des droits du commerçant exploitant sur le domaine public
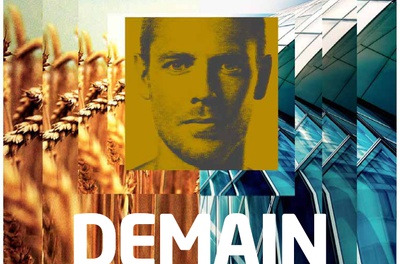
La sanction des clauses non conformes par le réputé non-écrit
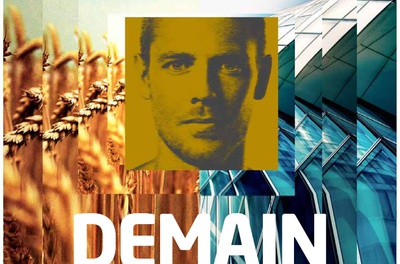
Entretien avec Jean-François Pillebout