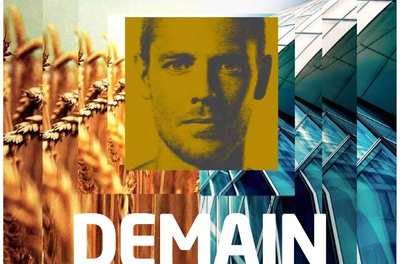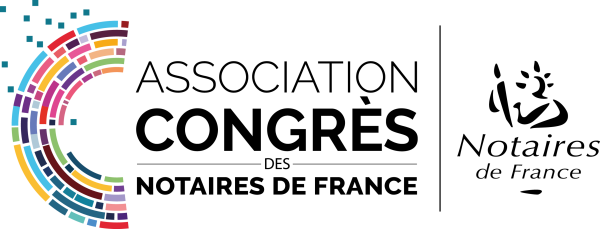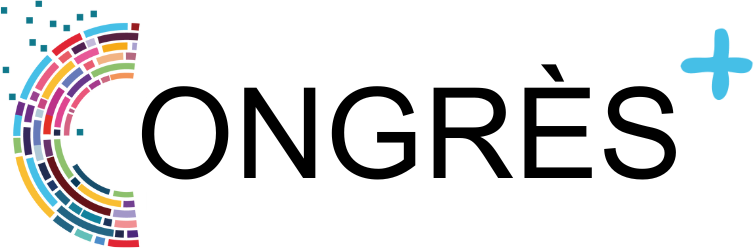Introduction générale - Le notaire et la loi : « Et voudriez-vous… »
Les apports des Congrès des notaires de France au droit
Plus de 200 textes législatifs et près de 130 règlementaires
inspirés des Congrès des notaires de France
Introduction générale - Le notaire et la loi : « Et voudriez-vous… »
1 - Chaque année, depuis 1891, des notaires, pourtant en pleine activité dans leurs offices respectifs, se réunissent pour former une équipe qui réfléchit sur un sujet à la fois notarial et sociétal. Ils invitent à un Congrès l'ensemble des notaires de France et d'Outre-Mer, de nombreux notaires étrangers issus du droit latin. Ils se donnent sans compter pour établir un rapport souvent de mille pages qui réalise un diagnostic du sujet choisi, le divise et l'ordonne suivant la belle méthode de Descartes, et en trace ses possibles évolutions en lien avec le changement sociologique inexorable de notre société. En couronnement de cet important travail, des propositions législatives1, appelées autrefois des vœux, sont faites en Congrès, votées ou refusées à la majorité par les notaires en exercice, puis, lorsqu'elles sont adoptées, transmises au ministère de la Justice, après visa du Conseil supérieur du notariat.
L'équipe est animée par un président, choisi par ses pairs et prédécesseurs, qui définit le thème retenu, en trace le périmètre, et décide de son orientation philosophique, politique et juridique. L'équipe est composée d'une vingtaine de membres, tous bénévoles. Les travaux sont dirigés par un rapporteur général qui coordonne les travaux de chacun, le tout sous l'aimable surveillance de la Faculté, incarnée par un ou une professeur(e) de droit, officialisé(e) rapporteur(e) de synthèse, qui tire à l'issue du Congrès les principales conclusions.
L’activité est coordonnée depuis 1999 par l’Association congrès des notaires de France (ACNF) dont l’objet est ainsi défini : « Les congrès ont pour but d’étudier tous problèmes d’ordre juridique, économique ou technique en rapport avec l’activité notariale. Leur action se manifeste par tous moyens et notamment par la rédaction de rapports scientifiques, l’adoption de propositions et de recommandations à l’intention des pouvoirs publics, la présentation de communications, la délivrance de formations, l’organisation d’une exposition et de manifestations destinées à soutenir et promouvoir les thèmes et réflexions du congrès ».
Chaque année, le Congrès des notaires de France est une œuvre scientifique, mettant en relief des sujets d'actualité, puisés dans l'immense expérience des offices notariaux, et proposant des adaptations ou des transformations de notre droit positif, aux termes d'une analyse rigoureuse et exhaustive.
Son succès n'est jamais démenti. Il est le plus ancien en Europe, l'un des plus anciens au monde. Chaque année, il regroupe environ 5 000 participants, 60 intervenants sur scène, 80 journalistes y participent, et l'on compte, en termes médiatiques, en général 200 retombées dans la presse.
2 - Pourquoi des professionnels comme les notaires s'inventent-ils des profils de législateur, alors qu'ils n'en ont pas la fonction, au prix de sacrifices personnels et familiaux2, et alors qu'ils pourraient se contenter d'appliquer une législation et une réglementation qu'ils ont apprises et qu'ils sont chargés de mettre en œuvre ?
Il convient de chercher la réponse à cette question à la fois dans la mission statutaire du notaire définie par les pouvoirs publics et dans la raison d'être de la fonction qu'il représente et qu'il exerce.
Stigmatisons ainsi le rôle social du notaire tel qu'il lui est assigné :
• une fonction multiséculaire et grossissante : une mission de service public ;
• un état d'esprit multiséculaire : exercer sa fonction dans un esprit public ;
• un créateur multiséculaire de lois entre les parties : lex est quod notamus.
1. Une mission de service public
3 - Même dans un État libéral, l'État n'est pas cantonné à l'exercice de fonctions régaliennes. En dehors des missions de sécurité intérieure et extérieure des individus, de justice, d'éducation et de santé publique, il a deux autres missions essentielles qui le caractérisent :
• sur la forme, faire en sorte que les relations humaines, familiales, économiques, financières et patrimoniales soient certaines et vraies, c’est-à-dire authentiques, car on ne bâtit pas une société sur du sable ;
• sur le fond, veiller à une équité et un équilibre sur ces relations entre le fort et le faible, le puissant et le misérable, l'innocent ou le sage et le cupide ou l'intrigant.
Or, dans le domaine qui est le sien, le notaire délivre l'authenticité, et sur le fond, il met en œuvre dans son champ d'exercice des politiques publiques de l'État.
A. - Le notaire délivre l'authenticité
4 - Exposer un fait juridique, un acte juridique, ou bien encore une relation juridique à des tiers, c'est prendre un risque de contestabilité, quant à la forme et au fond, lequel risque engendre aussitôt un risque plus grand, celui d'insécurité juridique.
5 - Histoire de l’authenticité. – La notion d'authenticité n'est pas ancienne à l'échelle de l'histoire3. Elle est apparue en Italie du Nord, puis dans la France méridionale et enfin dans tout le royaume de France, au XIe et XIIe siècle, sous l'effet du développement des échanges économiques. Ceux-ci ne peuvent s'appuyer que sur une situation vraie, excluant la contrefaçon et la falsification, c’est-à-dire une situation incontestable. Il est alors apparu une juridiction volontaire ou gracieuse, d'abord opérée par les magistrats eux-mêmes avant d'être confiée à des notaires publics, dont les actes, qui tirent leur autorité de la qualité de leur auteur, se verront progressivement reconnaître la foi publique et la force exécutoire.
L'authenticité est alors consubstantiellement attachée à ses trois attributs qui la caractérisent et la définissent : la force probante, la force exécutoire et la date certaine. Elle répond ainsi à un besoin de sécurité juridique.
6 - Un besoin de sécurité qui traverse les siècles. – Ce besoin anthropologique universel depuis le XIIe siècle n'a pas évolué et est toujours prégnant dans les relations humaines et économiques. Il s'est même affirmé, au regard de la multiplicité des échanges d'une population qui a grossi, et plus récemment avec la multiplication des technologies nouvelles et notamment avec sa confrontation au monde numérique, où la virtualité ne doit pas exclure la sincérité, et doit conserver quelque chose de tangible en appelant un certificateur public.
Il est même possible d'ajouter que l'histoire de l'authenticité se répète et se renouvelle à l'épreuve des échanges internationaux et de la mondialisation.
Le vrai est toujours une composante de la sécurité juridique. Les conventions internationales entre États, bilatérales ou multilatérales, le répètent à l'envie, lorsqu'on parle de légalisations, ou d'apostille. Seules les signatures publiques franchissent les frontières et sont reconnues. Et lorsque des conventions internationales ou règlements européens suppriment toutes exigences de légalisation ou d'apostille, par exemple la Convention de Bruxelles du 25 mai 1987, ou le règlement européen n° 2016/1191 du 6 juillet 2016, seuls les actes publics sont concernés.
L'authenticité est également liée à la qualité de son auteur, l'autorité publique ou son délégataire, qui inspire la certitude et la confiance. La Cour de justice des communautés européennes l'a affirmé sans ambiguïté dans un arrêt de principe du 17 juin 19994. Il est normal qu'elle soit dédiée au notaire, une autorité publique parmi d'autres, dans le domaine qui est le sien.
B. - Le notaire met en œuvre des politiques publiques de l'État
7 - L’activité du notaire a beaucoup changé. Le récit des œuvres actuelles du notaire est connu, mais souvent occulté ou oublié. La liste faite ci-après, sans caractère d'exhaustivité, se veut combler ce qui parfois est une lacune.
1° Il collecte des recettes fiscales
8 - À l'occasion de chaque acte qu'il reçoit, il collecte l'ensemble des droits et taxes dont est l'objet l'acte en question, et ce gratuitement.
2° Il assure la sécurité des transactions financières en participant activement à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
9 - La profession y a répondu en élaborant un plan d'actions préparant et formant les notaires aux obligations de vigilance qui sont les leurs, mettant en place des procédures internes, et prévoyant des déclarations à Tracfin, en cas de soupçon.
3° Il participe à l'aménagement du territoire
10 - Le domaine de l'aménagement du territoire, et plus particulièrement celui de l'urbanisme, au-delà des autorisations qui doivent être délivrées pour diviser un sol, exige lui aussi un agent de surveillance de la bonne application de ces autorisations. Avant que ne soient reçus les actes de vente des lots à bâtir par un lotisseur, le notaire vérifie que la procédure d'aménagement du lotissement a été parfaitement instruite et exécutée, que les voies de recours et de retrait sont expirées, que les travaux prescrits ont été réalisés, que la déclaration d'achèvement et de conformité de ces travaux a été déposée. En un mot, il assure la sécurité juridique d'un accédant à la propriété d'un terrain à bâtir. Plus largement, à l'occasion de chaque division de sol, le notaire a l'obligation de rappeler toutes les autorisations administratives qui ont précédé la division, leur effectivité, et leur caractère définitif, afin de s'assurer de la régularité des procédures engagées ou de veiller à ce que l'on ne les oublie pas.
4° Il veille à la régularité des constructions nouvelles
11 - On observera la même démarche dans le domaine du droit de la construction et plus particulièrement, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement. Lors de la signature de l'acte de vente sur plans, le notaire vérifie la délivrance du permis de construire, de ses éventuels modificatifs, de la purge du délai de recours des tiers et du délai de retrait, de la fourniture d'une garantie extrinsèque d'achèvement, de la souscription d'une police d'assurance dommages-ouvrages et d'une assurance responsabilité décennale, de l'échelonnement du paiement du prix au fur et à mesure de l'avancement des ouvrages de construction. Là encore, le notaire garantit l'acquéreur qui achète un bien immobilier sur plans, à partir d'une présentation numérique ou sur papier, qu'il ne découvrira dans sa réalité tangible qu'une fois la construction achevée, bien après la signature de l'acte d'acquisition.
12 - Plus largement encore, chaque fois qu'il reçoit un acte de mutation immobilière, il rappelle, lorsque la prescription trentenaire n'est pas acquise, toutes les autorisations administratives qui ont pu être délivrées sur des constructions nouvelles, agrandissements, extensions, surélévations… etc., engageant parfois les parties concernées à régulariser leur situation en cas d'omission.
Mais le notaire n'est pas qu'un contrôleur de procédures. Il est également un acteur actif de la politique de l'environnement.
5° Il participe à la transition écologique
13 - Changement de paradigme. – Autrefois, notamment après les deux guerres mondiales du XXe siècle, la politique d'aménagement du territoire était essentiellement gouvernée par un besoin rapide et efficace de reconstruction. Aujourd'hui, les paramètres qui régissent cette politique sont nombreux et variés et répondent à des exigences multiples de démographie, d'immigration, de risques naturels et technologiques sévères, de changement climatique, d'esthétisme naturel ou historique au regard de la qualité d'un site, de la nature du sol ou sous-sol, de la raréfaction ou de la nocivité de certaines ressources. Il en résulte diverses réglementations qui obéissent à ces exigences et qui concernent le notaire à l'occasion de chaque mutation immobilière. On ne compte plus les divers diagnostics qui doivent être réalisés dans le cadre d'une vente immobilière, les diverses informations à communiquer aux acquéreurs afin qu'ils puissent agir, en tant que propriétaire, en connaissance de cause, les diverses précautions dont il doit s'entourer pour des dispositions de gestion du bien immobilier qu'il acquiert. Autant dire également que le devoir de conseil du notaire s'étend en proportion des lois et règlements qui régissent la matière, dans le maquis juridique du droit de l'urbanisme, de la construction, et de l'environnement.
14 - Un défi notarial. – Le défi de l'environnement dont la société s'empare progressivement est aussi le défi du notaire dans cette responsabilité accrue qu'il encourt, dans l'exercice de sa profession, et dans ce changement de paradigme qu'évoque Mathieu Fontaine, en charge de la communication du 120e Congrès des notaires de France qui s'est tenu à Bordeaux en 2024. Les commissions qui se sont succédé sont évocatrices du rôle à venir du notariat dans le droit de l'urbanisme et de la construction qui est devenu plus généralement le droit de l'environnement : anticiper les impacts des risques environnementaux, préparer l'acceptabilité et la sécurité des projets, placer l'environnement au cœur des projets, telles sont bien résumées les missions publiques qui sont également confiées aux notaires dans ce domaine et qui élargiront encore, par induction, les activités traditionnelles d'expertise, de négociation et de rédaction dans le domaine de l'immobilier.
6° Il participe à la protection des personnes dans une relation juridique
15 - Élargissons encore notre regard pour rappeler l'intervention du notaire dans le droit des personnes et rappelons les actes qu'il est susceptible de recevoir : la reconnaissance d'un enfant, la réception du consentement à adoption des différentes parties prenantes, du consentement requis dans le cadre d'une procréation médicale assistée, le régime juridique d'un pacte civil de solidarité, le mariage d'un couple en organisant son régime matrimonial, le divorce d'un couple dans le cadre d'une procédure extra-judiciaire où il donne la force exécutoire, tel un jugement. La liste n'est pas exhaustive, mais elle démontre l'étendue de l'intervention du notaire chargé par l'État de structurer les relations humaines, afin qu'il soit donné une explication, un sens et une autorité sur ces différentes procédures.
16 - Pensons aussi au droit des personnes vulnérables où la demande de protection est encore plus aiguë. Si le personnage central de cette procédure est le juge des tutelles, le notaire reste encore un acteur, certes discret mais déterminant dans le déroulement des autorisations données : avis de valeur des biens immobiliers qui doivent être vendus, attestation d'un actif dépassant le passif pour l'acceptation pure et simple d'une succession etc. Le notaire est encore actif dans l'ouverture des mesures de protection, car bien souvent il en est à l'origine, tel un témoin d'alerte.
Et que dire du mandat de protection future reçu en la forme notariée où le notaire efface cette fois-ci d'une façon significative le rôle du juge et se substitue presqu'à lui ?
17 - Enfin, et encore, il est le chef d'orchestre d'une transmission de patrimoine, à la fois par tradition et par les multiples actes obligatoires qui lui sont confiés (dévolution successorale, attestation immobilière après décès, partage immobilier, partage anticipé, testament authentique, renonciation anticipée à l'action en réduction…etc.).
7° Des missions plus nouvelles apparaissent dans la fonction notariale
18 - Notaire et philanthropie. – L'assistance dans le monde de la philanthropie en est un premier volet. Le notaire n'y a jamais été étranger et les multiples associations et fondations philanthropiques le savent bien lors de chaque Congrès des notaires, lorsqu'il s'agit de conseiller des personnes qui veulent établir des testaments ou des donations au profit d'œuvres caritatives de leur choix, suivant leur volonté et leurs affinités. Mais aujourd'hui encore, le monde de la philanthropie est devenu un monde pluriforme et complexe qui requiert un accompagnement personnalisé et une expertise juridique et fiscale particulière. Qu'il s'agisse des différentes structures juridiques possibles pour recevoir des libéralités (fondations – associations – fonds de dotation…), qu'il s'agisse des différents actes juridiques ou techniques juridiques possibles (donations – testament – libéralités graduelles ou résiduelles – pactes familiaux ou renonciations anticipées à l'action en réduction,…), le notaire devient un acteur incontournable et même un catalyseur de philanthropie suivant la belle expression d'un auteur et confrère5.
19 -Notaire et médiation. – Le domaine de la médiation devient également un domaine de prédilection du notariat. Comme aime à le rappeler le Conseil supérieur du notariat par la voix de ses représentants, l'amiable fait partie de notre ADN. Il est donc normal de retrouver le notaire acteur de la justice déjudiciarisée, en lien d'ailleurs avec les magistrats et les autres professions du droit.
Remarque
Ces illustrations témoignent de la diversité des tâches du notaire et de la variété de ses fonctions, et toutes se concentrent sur un seul objectif convergent : assurer la paix des familles, préserver la paix sociale, exercer une justice préventive qui épargne à moindre coût le contentieux. Dans ce cadre, le notaire exécute une délégation de service public.
Fin remarque
C. - Le statut du notaire est à l'image de sa fonction
20 - Obligations déontologiques. – Le notaire remplit toutes les conditions nécessaires à son image publique, conditions qu'il n'est pas inutile de rappeler. Toutes les facettes de ce statut sont présentées dans le Code de déontologie des notaires et le règlement professionnel du notariat, issus tous deux du décret n° 2023-1297 du 28 décembre 2023.
On ne s'invente pas notaire, il faut être nommé par le ministre de la Justice. Le notaire est sous l'autorité du procureur de la République de son ressort. Son office fait l'objet d'une inspection annuelle.
Il agit sous le sceau de l'État, et a l'obligation d'apposer un panonceau, symbole de l'État et de la puissance publique, qui ne peut être assimilé ni à une enseigne, ni à un dispositif publicitaire. Il prête serment et s'engage également devant ses pairs. Le lieu d'exercice de sa profession est contrôlé. L'office est en principe domicilié dans un seul local. Les locaux annexes ou accessoires ne sont admis que sous certaines conditions très strictes. Le notaire accueille sa clientèle et ne reçoit ses actes à titre habituel que dans ces seuls locaux. Le notaire s'abstient de toute démarche à caractère publicitaire, impliquant une communication de masse indifférenciée et générale, pour proposer ses services à un large public, et ce sous quelque forme que ce soit.
21 - Une activité encadrée. – Son activité est strictement encadrée :
• il reçoit ses actes en personne, que ce soit en présentiel ou en visioconférence ;
• la sous-traitance est parfaitement définie, et l'activité notariale ne peut être externalisée ;
• certaines activités lui sont interdites : il ne peut exercer des fonctions de juge, de greffier, de commissaire de justice, commissaire du Gouvernement etc. Il ne peut exercer d'activité commerciale ni s'immiscer dans la direction ou la gestion d'une entreprise de commerce. Il ne peut recevoir d'actes dans lesquels des parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus, sont parties ou intéressés ou qui contiennent une disposition en leur faveur. La même interdiction s'étend quand l'acte contient un intérêt personnel pour le notaire ;
• il est tenu au secret professionnel ;
• il se conforme aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et des textes pris pour son application relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu'à celles du règlement général sur la protection des données (RGPD) ;
• il tient une comptabilité au jour le jour où la couverture des fonds clients doit être assurée en permanence. Il fait l'objet d'une inspection de son office chaque année ;
• il a une obligation de conservation de ses actes et de ses dossiers pendant une durée de 75 ans ;
• il a une obligation de respecter le tarif qui fixe sa rémunération, hors activités concurrentes définies par les pouvoirs publics, ce qui garantit un accès notarial égal à tous les usagers, quel que soit leur domicile ;
• il doit se soumettre à des attributions impératives de plume et de partage d'émoluments en présence de plusieurs confrères notaires de chaque partie ;
• diverses règles fixent le fonctionnement des instances et organismes statutaires du notariat ;
• il engage sa responsabilité disciplinaire et pénale pour chacun de ses faits et actes.
22 -Et voudriez-vous qu'au regard de toutes les missions qui lui sont confiées, de son statut strict et rigoureux, et en définitive de sa qualité indéniable d'acteur public de l'État, lui soit refusée une force de proposition législative et réglementaire ?
Le notaire a au contraire toute sa légitimité d'autorité publique pour accomplir ce rôle d'aide à la législation et au règlement, lui qui doit connaître les règles qui encadrent cette action publique dont il est un auxiliaire important.
23 - Mais cette force sera encore plus démonstrative si l'on relève par ailleurs l'esprit qu'inculquent sa mission et son statut. La qualification d'autorité publique donne à son titulaire qui en est investi un esprit public sur lequel il est utile maintenant d'insister. La mission de service public inspire à celui ou celle qui en est dépositaire un esprit public.
2. L'esprit public de la profession
24 - On rappellera tout d'abord la lumineuse explication du conseiller Réal au sortir de la période révolutionnaire sur l'utilité du notaire dans une société nouvelle, naissante, qui a besoin de s'organiser6. Le notaire est ainsi défini : « à côté des fonctionnaires qui concilient et qui jugent les différends, la tranquillité appelle d'autres fonctionnaires, qui, conseils désintéressés des parties, aussi bien que rédacteurs impartiaux de leur volonté, leur faisant connaître toute l'étendue des obligations qu'elles contractent, rédigeant ces engagements avec clarté, leur donnant le caractère d'un acte authentique et la force d'un jugement en dernier ressort, perpétuant leur souvenir et conservant leur dépôt avec fidélité, empêchent les différends de naître entre les hommes de bonne foi et enlèvent aux hommes cupides avec l'espoir du succès, l'envie d'élever une injuste contestation. Ces conseils désintéressés, ces rédacteurs impartiaux, cette espèce de juges volontaires qui obligent irrévocablement les parties contractantes, sont les notaires. Cette institution est le notariat ».
La formule n'a pas pris une ride.
25 - Dans le code de déontologie des notaires, tel qu'il résulte du décret n° 2023-1297 du 28 décembre 2023, la raison d'être du notariat est ainsi définie, sans doute avec moins de lyrisme, mais en des termes aussi concis et évocateurs :
« Sous le sceau de l'État,
Conseiller avec rigueur et impartialité,
Accompagner avec humanité et discrétion,
Exprimer l'équilibre des volontés dans le cadre fixé par la loi,
Conserver les actes pour toujours,
Et agir ainsi pour la paix au cœur de la société ».
Une formule encore plus lapidaire résume cette raison d'être : le notaire doit avoir en réalité un esprit public, qui lui impose essentiellement des devoirs. Cette servitude en fait cependant sa grandeur, car cet esprit public se décline en diverses qualités qui le caractérisent : un esprit libre des intérêts particuliers, un esprit pédagogique, un esprit global.
A. - D'abord des devoirs
1° Des devoirs envers la société et les pouvoirs publics
26 - L'article 3 du Code de déontologie énonce les principaux devoirs du notaire. Il explique la loi et en assure l'application. Il assure la moralité et la sécurité de la vie contractuelle. Il accomplit sa mission avec loyauté, neutralité, impartialité, probité et délicatesse. Il doit loyauté et respect aux autorités publiques et fait preuve de diligence et de courtoisie envers les professionnels avec lesquels il est en relation. Tous actes contraires à la loi lui sont interdits. Il consacre l'essentiel de son temps à l'exercice de son activité professionnelle.
Au regard de ces missions, le notaire prête serment devant la cour d'appel de son ressort, puis devant ses pairs. Il veille à donner par son comportement la meilleure image de la profession tant dans l'exercice de sa fonction que dans sa vie privée. Il ne peut renoncer à son indépendance et à sa neutralité en toute circonstance. Il est tenu au secret professionnel. Il veille à sa propre formation en la renouvelant, ainsi qu'à celle de ses collaborateurs.
27 - Il ne peut refuser ses services à tout client qui le sollicite et a l'obligation d'instrumenter, en présence de personnes jouissant de leur libre arbitre, et pour des actes qui ne sont pas contraires à la loi, frauduleux ou qu'il sait inefficaces ou inutiles.
2° Des devoirs envers ses clients
28 - Le notaire leur doit tout d'abord la liberté de choix, et lorsqu'il est choisi, il leur doit toute sa conscience professionnelle, ses égards, l'impartialité, la probité, le conseil adapté à sa situation et l'information la plus complète. L'intérêt du client prime toujours le sien.
3° Des devoirs envers ses confrères
29 - L'article 26 du Code de déontologie résume au mieux cette obligation. Les notaires se doivent assistance, courtoisie et délicatesse réciproques. Ils s'abstiennent, en toutes circonstances, de toute parole blessante, de toute attitude malveillante, de tout écrit public ou privé, de toute démarche ou manœuvre, susceptible de nuire à la situation de leurs confrères et à la réputation du notariat.
L'ensemble de ces devoirs ci-dessus énumérés engendre assurément pour le notaire des contraintes d'exercice dans son ministère, mais en même temps, dans ce carcan d'obligations éthiques et professionnelles, ils lui ouvrent une très grande liberté qu'il convient de décrire.
B. - Un esprit libre et donc impartial
30 -La liberté consiste également moins à faire sa volonté qu'à ne pas être soumis à celle des autres. Et c'est précisément ce statut protecteur qui renforce sa liberté d'instrumenter. Certes, le notaire a l'obligation de prêter son ministère, mais dans le cadre du Code de déontologie et de son règlement professionnel. Cette réserve ou cette sauvegarde lui ouvre cet espace de liberté dont il a besoin.
31 - Tarif des notaires. – Un point important doit être souligné sur ce sujet, c'est celui de sa rémunération. Chacun sait qu'elle est tarifée par le pouvoir exécutif réglementaire. Cette tarification procure trois services :
• un accès égal au service notarial pour tous, quel que soit le niveau de fortune du demandeur ;
• une indépendance totale du notaire qui n'est pas ainsi soumis à la pression de son client qui commande un service pour une rémunération que celui-ci choisit. C'est la raison pour laquelle les demandes de réduction d'honoraires sont également strictement encadrées ;
• une péréquation de la rémunération du service notarial, où en définitive un tarif bien pensé et bien construit permet de considérer que les gros actes en assiette rémunèrent les petits.
Remarque
Ce tarif est la pierre angulaire du système notarial, où il suffirait que l'on retire une de ces colonnes de construction pour anéantir le système tout entier. On objectera cependant que si ce principe de tarification est maintenu expressément, une part significative de cette rémunération subit désormais les lois de la concurrence, précisément là où le notaire intervient dans des domaines concurrentiels échappant à l'acte notarié obligatoire (sociétés, fonds de commerce, gestion et négociation immobilière, conseils notamment).
Fin remarque
C. - Un esprit pédagogique
32 - La qualité d'homme public du notaire par sa fonction et par ses actes l'oblige à donner sens aux réglementations qu'il applique. Il est un relais indispensable entre les gouvernants qui nous dirigent et les administrés qui reçoivent souvent ces normes avec incompréhension. Les notaires ont un rôle explicatif de la loi et du règlement. Le droit n'est appliqué que s'il est compris. Suivant la très belle formule d'un président honoraire du Conseil supérieur du notariat et aussi de Congrès, Jean-Paul Decorps, le notaire doit démonter des qualités d'instituteur de la loi. Un ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin confiait un jour aux notaires, lorsqu'il était en exercice, que les notaires étaient des intermédiaires de complexité. Toutes ces expressions sont justes et définissent parfaitement le rôle du notaire, corps intermédiaire d'État, dont il ne faut pas craindre la hauteur de cette ambition.
D. - Un esprit inventif
33 - Le notaire n'est pas qu'un contrôleur de procédures ou bien encore un répétiteur des lois et des règlements dans l'exercice de ses fonctions, soit un gardien du temple du droit. Il doit envisager son ministère comme un acteur public, fort de ses connaissances tout en les pratiquant avec humilité, attentif aux besoins juridiques de ses clients qui lui présentent une situation juridique particulière, de l'ordre de la famille, du patrimoine familial, de la vie économique, et à laquelle il doit répondre au plus juste avec la boîte à outils juridiques dont il dispose.
Les mécanismes juridiques qui lui sont familiers, les diverses techniques juridiques que le législateur a mis à sa disposition, ne sont là que pour permettre une solution qui répond au besoin exprimé. Y faillir, c'est manquer à son devoir.
Cet esprit inventif, dont l'expression peut parfois surprendre, est donc nécessaire pour construire et façonner, tel un sculpteur, le montage juridique adéquat. Louis Jouvet, dans l'inoubliable film de Marc Allégret, Entrée des artistes, où il joue un professeur de théâtre, recommandait à ses élèves de mettre de la vie dans leur art afin de mettre de l'art dans leur vie. Cette exhortation pourrait s'adresser au notaire. Cela suppose qu'il renouvelle régulièrement sa formation professionnelle. Cette formation doit d'ailleurs être entendue au-delà du strict exercice de sa profession. C'est une formation élargie dont il doit faire preuve en suivant avec application et assiduité, l'actualité politique, économique et sociale du pays dont il est ressortissant, de l'Europe et du Monde.
E. - Un esprit global
34 - Le propos précédent situe la dernière image du notaire que l'on veut mettre en exergue. Un notaire ne peut imaginer exercer sa fonction dans l'univers clos de son office, sous la protection des lois et des règlements qui nous gouvernent, de ses archives, et de son sceau.
Il est par définition un homme ou une femme ouvert au monde qui l'entoure, situant l'ensemble des sujets qui viennent à son attention, dans un contexte global politique, économique et social, national ou extérieur. Sans cette capacité permanente à comprendre la société dans laquelle il vit, le notaire réduit son image publique. Aux yeux du grand public, il doit être aperçu et considéré comme un agent public de l'État qui relaie sans cesse les politiques publiques mises en œuvre. Certains objecteront que les exigences pesant sur le notaire sont nombreuses, elles sont cependant consubstantiellement attachées à la compréhension de la profession et sa raison d'être. C'est sans doute pour cela que cette profession dure, traverse les crises de son existence, les soubresauts, voire les tumultes historiques, et ce depuis des siècles7.
35 - Et voudriez-vous qu'avec un tel esprit public que revendique le notaire et qui lui a été effectivement donné institutionnellement, nous n'ayons pas notre mot à dire sur les lois et règlements qui sont en gestation ?
Un dernier argument achèvera de démontrer la légitimité du notariat à être force de proposition. S'agissant de lois, le notaire n'y est pas étranger, car au quotidien il écrit précisément la loi des parties.
3. Un créateur de lois : lex est quod notamus
36 - Il n'est pas inutile de rappeler quelques principes fondamentaux qui éclaireront et gouverneront notre propos.
Tout acte juridique est l'œuvre d'une volonté, et même le plus souvent de plusieurs volontés à la fois. Un acte sans volonté est par définition un acte suspect et voué à l'inexistence, car si la volonté est absente ou même simplement viciée, par erreur, incapacité, dol ou violence, l'acte est nul. Voilà assurément une première grande règle de droit, mais elle doit être aussitôt complétée par une seconde grande règle, car à défaut nous restons cantonnés à la simple déclaration de volonté. Il faut conjuguer la volonté avec une autre valeur fondamentale qui est la liberté. Une volonté sans liberté est une volonté paralysée ou bâillonnée. La liberté doit être la règle afin que la volonté soit autonome. C'est ainsi que l'on parle d'autonomie de la volonté en matière contractuelle, matière par excellence des notaires. La liberté contractuelle ne se conçoit que si la volonté est autonome. C'est l'explication philosophique de la règle.
37 - Conciliation de la liberté contractuelle et de l’ordre public. – Ce rappel élémentaire fait apparaître aussitôt les limites bien comprises de ce principe. Deux forces contraires s'affrontent dans l'énoncé de ces deux règles, d'une part la nécessité d'une volonté, d'autre part le soutien ou l'appui de la liberté.
Dans une société démocratique, la loi doit respecter les volontés individuelles, parce que le droit individuel de s'engager est supérieur à la loi, relevant d'une liberté publique fondamentale. À ce titre on a pu parler au XIXe siècle d'individualisme libéral. C'est une première force incontestable. Mais elle en inspire une autre tout aussi incontestable.
Dans une société organisée et respectueuse des droits de chacun, la liberté contractuelle ne peut confiner à l'arbitraire, la domination de l'un sur l'autre, et à l'immoralité.
Le Code civil intègre ces deux jalons. D'un côté l'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. D'un autre côté, l'article 6 énonce qu'on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. Il en résulte que la volonté privée est autonome dans les limites fixées par la loi. Et c'est dans ce périmètre juridique que se joue et s'apprécie, chaque jour, l'autonomie de la volonté.
Dans les conventions, et plus largement dans les actes publics qu'il dresse, le notaire est le garant de cet équilibre, le doigt de l'État qui canalise la volonté conjuguée à la liberté. Il est ainsi à la fois le garant de cette liberté contractuelle et le garant du respect des lois et règlements qui régissent l'acte qu'il reçoit.
38 - Interventionnisme croissant de l’État. – Notre époque moderne, disons depuis la fin de la seconde guerre mondiale, a profondément brouillé ce savant équilibre décrit ci-dessus.
Deux marqueurs principaux résument l'interventionnisme de l'État sur la liberté contractuelle :
• un foisonnement de lois impératives qui brident la liberté contractuelle, que ce soit dans le domaine des ventes, des baux, des sociétés, et bien d'autres encore contrats spéciaux ;
• une judiciarisation massive des procédures, où la subordination des contrats à l'autorisation d'un juge est devenue une pratique courante, et a introduit l'idée dominante d'une justice gracieuse à côté d'une justice contentieuse.
À la vérité, le second marqueur fait l'objet ces dernières années d'un effacement progressif, sans doute moins pour des raisons de conviction, que pour des raisons budgétaires. Mais il n'y a pas lieu de s'en plaindre, tant le recours au juge révélait des procédures lourdes et lentes et parfois inutiles. Ceci d'autant plus que ce renoncement au corps juridictionnel s'accompagne le plus souvent d'un transfert des prérogatives au profit des notaires, dont la tâche ne s'est pas trouvée alourdie puisque l'intervention du notaire, sur laquelle s'appuyait déjà le juge, existait déjà dans les procédures aujourd'hui remaniées.
À l'inverse, le premier marqueur contient une encre de plus en plus indélébile, et l'intervention de l'État est loin de s'essouffler.
La liberté contractuelle existe-t-elle réellement dans un bail d'habitation, à moindre mesure dans un bail commercial, ou encore dans le domaine du droit rural ? Il y a parfois des coins de ciel bleu, notamment lorsqu'il s'agit de société par actions simplifiée, et la pratique des affaires s'y est d'ailleurs engouffrée, ce qui veut dire sans doute quelque chose. Et que dire de la politique énergétique et de la transition énergétique qui peut sembler, à certains égards, se transformer en écologie punitive, impactant les contrats concernés ? Et que dire de la fiscalité invasive qui s'introduit dans chaque matière patrimoniale et chaque fait juridique ?
39 - On comprend bien que la liberté contractuelle doit frayer dans les torrents et les gorges de l'ordre public et de la moralité. Elle doit même évoluer au fil du temps, des évènements conjoncturels (une guerre, un ordre international instable, une épidémie, un changement climatique, des mouvements démographiques importants, etc.). Tout ceci se comprend aisément. Il est d'ailleurs possible de repérer les balises de sa navigation :
• l'ordre moral en premier lieu, même s'il s'agit d'une notion subjective et donc variable selon les convictions de chacun ;
• tout ce qui touche à l'état et la capacité des personnes ;
• toutes les limitations au droit de propriété, qui en empêchent les abus ou favorisent l'intérêt public ;
• l'intérêt des tiers au contrat qui ne peuvent souffrir de conventions qui les exposent ;
• la protection des contractants qui est un des premiers devoirs de l'État ;
• et bien entendu cette notion envahissante d'ordre économique et social, qui est en même temps une idée politique, à géométrie variable par essence, s'exprimant par la norme et la fiscalité.
40 - Nécessité de préserver la liberté contractuelle. – La liberté contractuelle réside beaucoup dans cette notion très plastique, l'ordre économique et social, suivant les conceptions philosophiques et sociales successives du pouvoir législatif et exécutif en place, obéissant à des vérités diverses, mais sans doute jamais à une seule vérité. À vrai dire, ces vérités sont des vérités relatives. Souvenons-nous de l'expression de Pascal : « le contraire d'une vérité est une vérité contraire ». Aujourd'hui Edgar Morin ajoute : « il n'y a pas toujours une vérité s'opposant à l'erreur, parfois l'adversaire exprime un autre aspect de la réalité. Une bonne démocratie est celle dans laquelle on reprend de bonnes objections à l'adversaire pour les intégrer dans sa politique. Le jeu des antagonismes doit être producteur et non pas stérile » 8.
La liberté contractuelle doit selon nous voguer non dans un étatisme dévorant, mais dans un humanisme tolérant. Déjà Montaigne disait : « tout homme est mon compatriote ». Cet aphorisme devrait déjà suffire à border la liberté contractuelle. La loi soit se situer à cette confluence, comme la rivière se déverse dans le fleuve. La loi doit diriger la liberté contractuelle et non pas l'étouffer. À défaut, la liberté contractuelle n'a plus d'autonomie. Imaginons un seul instant, en forçant le trait, des contrats qui ne feraient que recopier la loi ! Les contractants seraient réduits à des sujets passifs qui représenteraient une société inerte. La loi est humaniste ou n'est pas. Une société humaine n'est pas une société où quelques-uns pensent pour tous les autres au nom d'un bien commun hypothétique. « L'humanisme se déploie comme respect de tout être humain », ajoute encore Edgar Morin. « Nos individualités dans leur singularité font partie de la communauté humaine ». Si la mondialisation a créé une communauté de destin, elle n'a pas effacé nos individualités. Chaque homme reste unique, et c'est cette singularité qui fait notre humanité.
41 -Et voudriez-vous que nous, notaires de France, qui croisons, recevons, entendons ces individualités, ces familles, ces entrepreneurs, répondons à leurs besoins personnels, familiaux, patrimoniaux, nous n'ayons pas notre mot à dire sur les lois telles qu'elles doivent être conçues ? Nous qui écrivons chaque jour la loi des parties dans le cadre légal assigné à la liberté contractuelle, sommes-nous incapables de concevoir ce que nous écrivons ? Au contraire, parce que nous écrivons au quotidien la loi des parties, nous pouvons au moins en avoir une idée.
Il faut aller encore plus loin et tirer les conclusions de cette légitimité notariale à proposer à nos parlementaires des évolutions législatives, là où nous sommes, à notre place et pas davantage. La loi pourrait alors dans le domaine des notaires porter le filigrane de ce qui serait possible d'appeler une empreinte notariale qui est notre sceau.
42 - Conclusion : l'empreinte notariale de la loi. – Le notaire inspire le législateur, tel qu'il voudrait que la loi fût, non pas parce qu'il le pense, ce qui peut aussi arriver, mais parce qu'il entend ses clients le lui dire.
43 - Qu’est-ce qu’une loi juste ? – Qu'est-ce qu'une loi juste ? Sur un plan général, il est possible d'ébaucher une réponse. Une loi comprise et acceptée par le peuple, mais ce débat n'est pas présentement notre sujet. On peut cependant proposer quelques critères qui la rendront comprise et acceptée.
– Une loi qui n'oublie pas la volonté et par conséquent la liberté, car ces deux notions sont intimement liées. Une loi incitative qui crée des espaces vides de dispositions impératives, pour laisser place à de seules orientations, ou des tendances où la libre volonté se love, afin de personnaliser des situations qui sont souvent, sinon toujours, particulières, car il faut adapter l'abstrait au concret, accorder la loi à la volonté, comme Mozart qui dans sa musique cherchait les notes qui s'aimaient.
– Une loi enfouissant sa vérité et sa légitimité dans la vraie vie, trempée dans l'encre de la vie et pas seulement la vérité des livres parfois dogmatiques fondée sur des idées conceptuelles ou idéologiques qui s'avèrent inexactes. L'histoire et l'actualité à la fois nous démontrent combien parfois avec le temps nos dirigeants politiques peuvent être idéologiquement éloignés des besoins concrets.
– Une loi par conséquent prudente dans l'appréciation d'une situation ou d'une tendance sociologique. La gestation d'une loi est comme la maïeutique pour un accouchement. Et s'il faut filer la même métaphore, la loi doit enfanter un épanouissement de l'individu et non un asservissement.
– Une loi intelligible, sobre et simple, dans son écriture et dans son contenu, qui épargne ses inévitables contours et déviations. Ce qui fait la richesse du droit, c'est son humilité et pas son ambition, et l'humilité réside dans la sobriété, s'exclamait Philippe Malaurie, illustre professeur de droit bien connu des notaires. Il ne faisait que reprendre René Descartes qui, 350 ans avant, s'exprimait ainsi : « la multitude des lois fournit des excuses aux vices, en sorte qu'un État est bien mieux réglé lorsque n'en ayant que fort peu, elles y sont fort étroitement observées ».
– Une loi dont il faut croire qu'elle peut toujours évoluer au gré des situations, des contextes et finalement peut-être au gré de l'humanité.
44 - Le droit n'est jamais figé. Il est à l'image du monde et de son évolution suivant une vision de Darwin. Le droit n'est que la façon du monde, un outil de civilisation subordonné à la conception de l'humanité de faire société. Le droit évolue alors, il est un lien présent entre le passé et l'avenir, à l'image de l'homme qui éprouve ce même besoin permanent d'évoluer lui aussi, de s'affranchir, malgré l'extrême fécondité de la transmission de ses aînés, des règles du passé devenant à la longue, ou du moins le croit-il parfois un peu trop, inadaptées ou conservatrices.
L'homme a besoin de racines mais il a aussi des ailes. Le droit est à son image. Il doit respirer.▪
Mots-clés : Notaire
Notes
- 1 400 environ depuis 1953, qui ont eu des suites pour 200 d'entre elles environ. ↩
- 1035 notaires investis depuis 1953. Chaque équipe de Congrès se réunit environ, en réunion plénière, 23 fois. L'Association congrès notaires de France (ACNF) compte à ce jour 9 salariés dans sa structure. ↩
- L'authenticité, (dir.) L. Aynes : La documentation française, p. 13. ↩
- CJCE, 17 juin 1999, aff. C-260/97, Unibank A/S c/ Flemming G. Christensen : JurisData n° 1999-612647. ↩
- J.-Fr. Sagaut : JCP N 2025, n° 3, act. 150, p. 7. ↩
- V. les débats de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat. ↩
- J. Fehrenbach, Précis d'histoire du notariat et du droit notarial. ↩
- E. Morin, Encore un moment : éd Folio, sept. 2024. ↩
LES ARTICLES
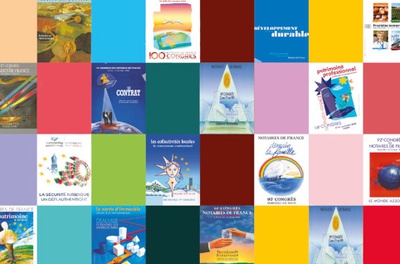
Introduction générale - Le notaire et la loi : « Et voudriez-vous… »
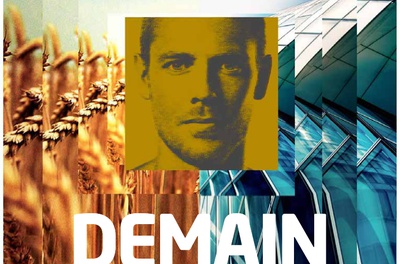
Introduction générale sur la famille
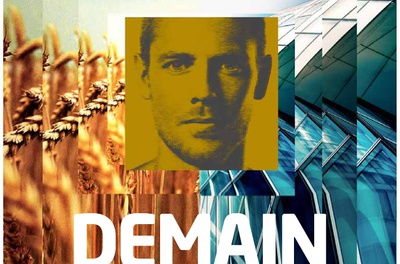
La contribution du notariat à l’amélioration du PACS
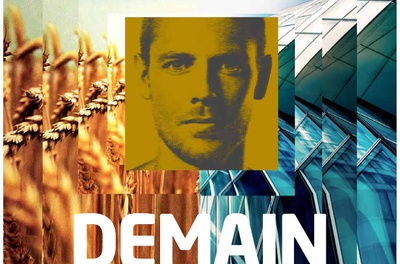
Les personnes vulnérables : quelles suites pour les propositions adoptées ?
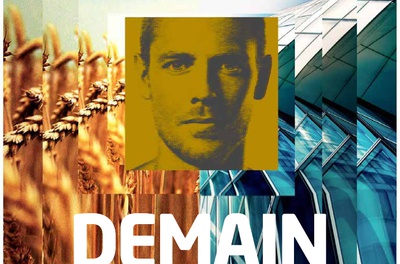
Libéralités graduelles et résiduelles : des solutions à ne pas oublier pour les personnes vulnérables
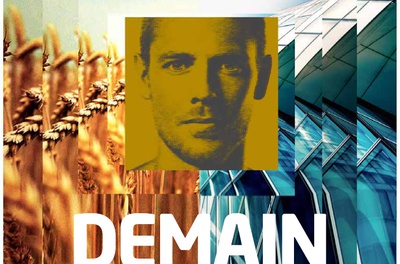
La renonciation à l'action en réduction des articles 929 et suivants du Code civil
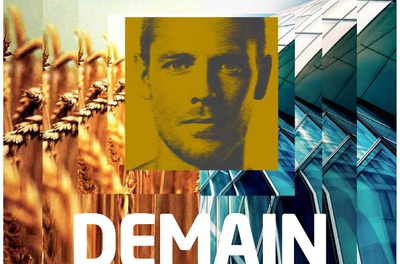
La vocation successorale égalitaire de tous les enfants
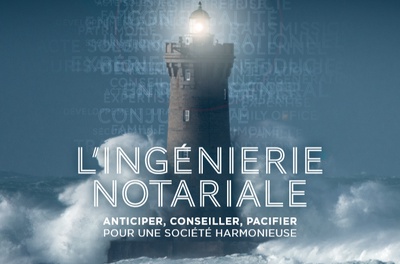
Introduction générale sur l’immobilier
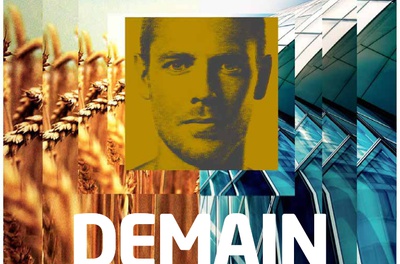
La vente d'immeuble à rénover : la suite de trois Congrès…
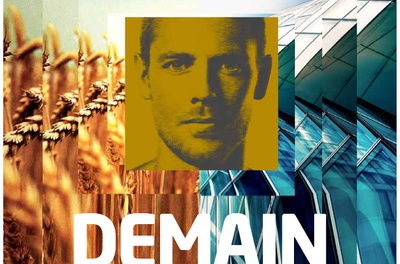
La vente en l’état futur d’achèvement : l’héritage des notaires bâtisseurs
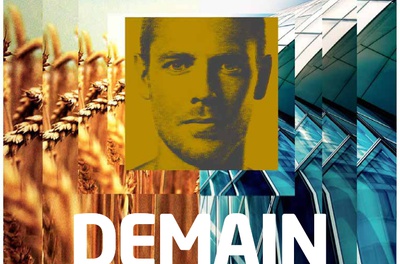
La division en volumes : l’inventivité notariale au service d’une nouvelle utilisation de l’espace
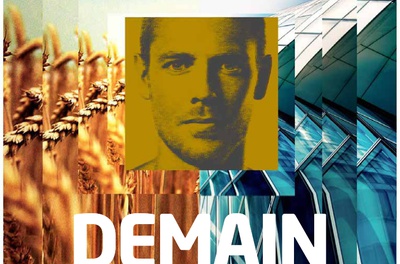
La reconnaissance par le droit de l’urbanisme du mécanisme de la prescription extinctive (C. urb., L. 421-9)
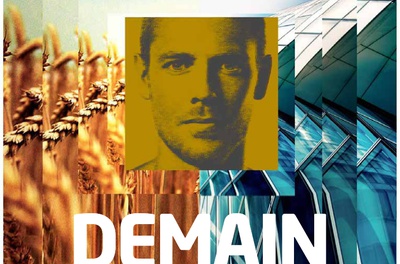
Le transfert par subrogation des accessoires garantis par l’inscription d’origine
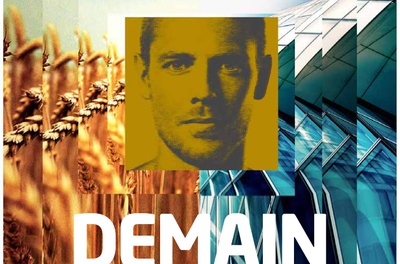
Introduction générale sur le droit public
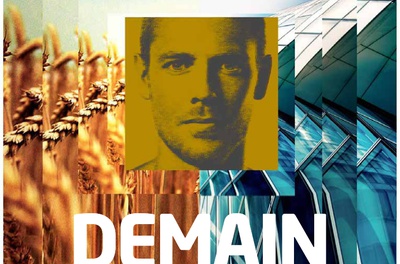
L'extension du déclassement par anticipation
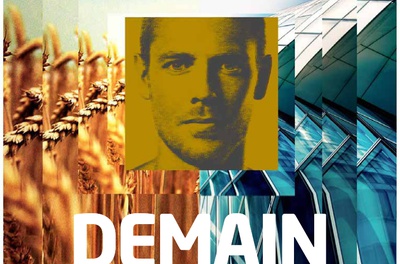
La sécurisation des droits du commerçant exploitant sur le domaine public
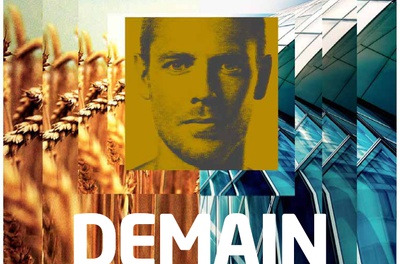
La sanction des clauses non conformes par le réputé non-écrit
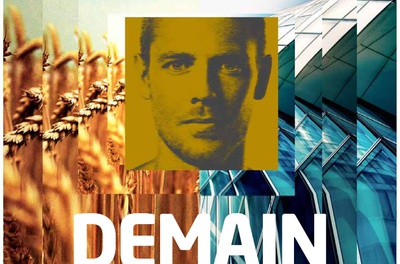
Entretien avec Jean-François Pillebout